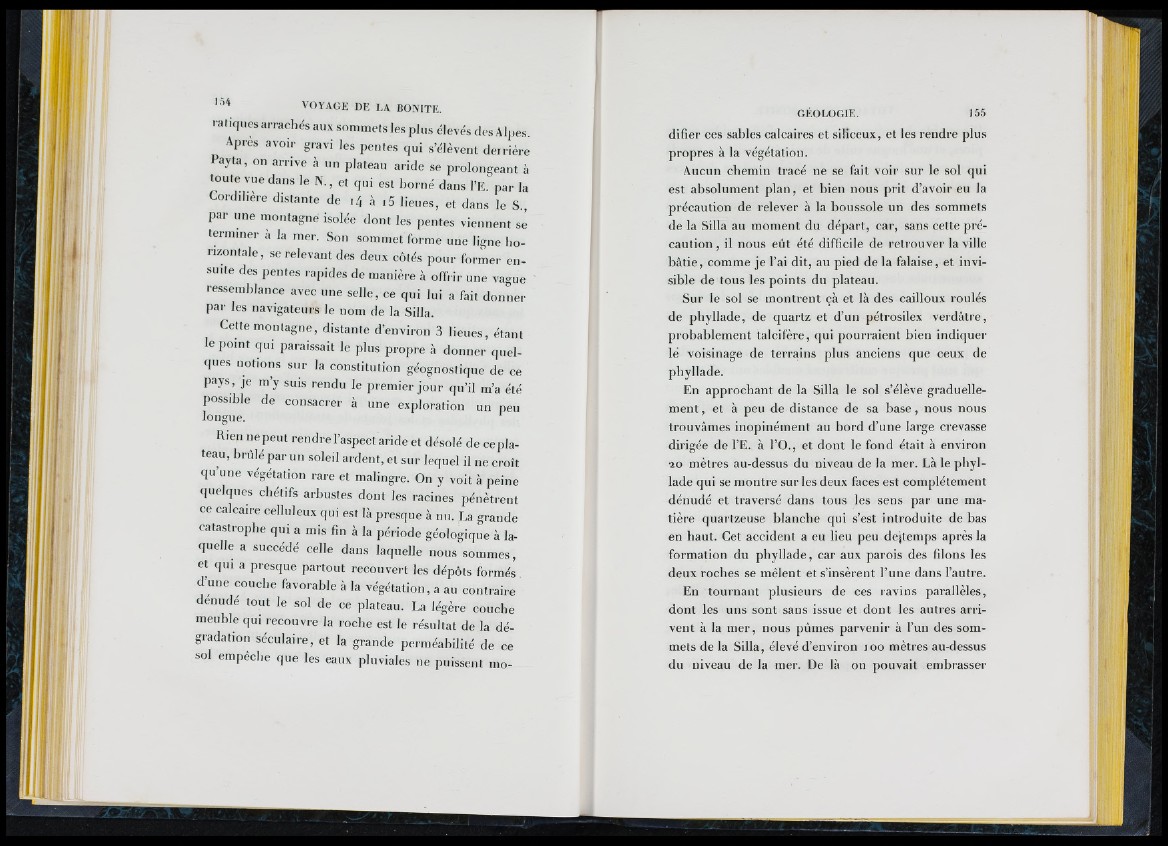
'54 v o y a g e d e l a b o n it e .
l atiqnes arracliés aux sommets les plus élevés des Alpes.
^ Après avoir gravi les pentes qui s’élèvent derrière
Payta, on arrive .à nn plateau aride se prolongeant à
toute vue dans le N., et qui est l,o,-né dans l’E. par la
Cordil.è,-e distante de ■/, à ,5 lieues, et dan.s le S.,
par une montagne i.solée dont les pentes viennent se
terminer à la mer. Son sommet forme une ligne horizontale,
se relevant des deux côtés pour former ensuite
des pentes rapides de manière à offrir une vague
ressemlilance avec une selle, ce qui lui a fait donner
par les navigateurs le nom de la Silla.
Cette montagne, distante d’environ 3 lieues, étant
le point qui paraissait le plus propre à donner quelques
notions sur la constitution géognostique de ce
pays, je m’y suis rendu le premier jour qn’il m’a été
possible de consacrer à une exploration un peu
longue.
Rien ne peut rendre l’aspect aride et désolé de ce plateau,
brûlé par un soleil ardent, et sur lequel il ne croît
qn’nne végétation rare et malingre. On y voit à peine
quelques chétifs arbustes dont les racines pénètrent
ce calcaire cellnlenx ipii est là presque à nn. La grande
catastrophe qui a mis fin à la période géologique à laquelle
a succédé celle dans laquelle nous sommes,
et qui a presque partout recouvert les dépôts formé!
d une couche favorable à la végétation, a au contraire
dénudé tout le sol de ce plateau. La légère coucbe
meuble qui recouvre la roche est le résultat de la dégradation
séculaire, et la grande perméabilité de ce
■sol empêche que les eanx pluviales ne puissent mo-
GÉOLOGIE. 155
difier ces sables calcaires et siliceux, et les rendre plus
propres à la végétation.
Aucun chemin tracé ne se fait voir sur le sol qui
est absolument plan, et bien nous piit d’avoir eu la
précaution de relever à la boussole nn des sommets
de la Silla au moment du départ, car, sans cette précaution
, il nous eût été difiicile de retrouver la ville
bâtie, comme je l’ai dit, au pied de la falaise, et invisible
de tous les points du plateau.
Sur le sol se montrent çà et là des cailloux roulés
de phyllade, de quartz et d’un pétrosilex verdâtre,
piobablement talcifère, qui pourraient bien indiquer
le voisinage de terrains plus anciens que ceux de
phyllade.
En approchant de la Silla le sol s’élève graduellement,
et à peu de distance de sa base, nous nous
trouvâmes inopinément au bord d’une large crevasse
dirigée de l’E. à l’O., et dont le fond était à environ
20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là le phyllade
qui se montre sur les deux faces est complètement
dénudé et traversé dans tous les sens par une matière
quartzeuse blanche qui s’est introduite de bas
en haut. Cet accident a eu lieu peu dejtemps après la
formation du phyllade, car aux parois des filons les
deux roches se mêlent et s’insèrent l’une dans l’autre.
En tournant plusieurs de ces lavins parallèles,
dont les uns sont sans issue et dont les autres arrivent
à la mer, nous pûmes parvenir à l’un des sommets
de la Silla, élevé d’environ loo mètres au-dessus
du niveau de la mer. De là on pouvait embrasser