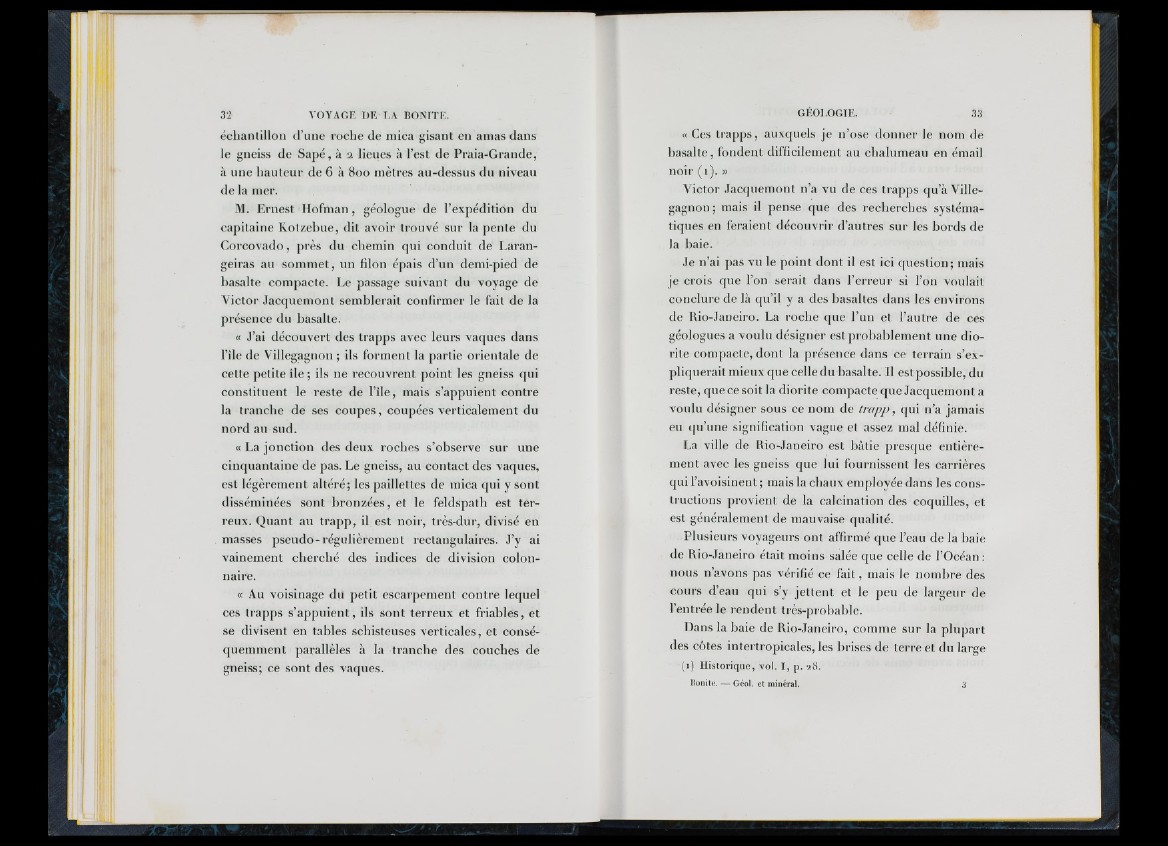
32 V O Y A G K D lî T,A liO N ITK.
écliantillon (l’iiiie roche de mica gisant en amas dans
le gneiss de Sapé, à 2 lieues à l’est de Praia-Grande,
à une hauteur de 6 à 800 mètres au-dessus du niveau
de la mer.
M. Eniest Hofman , géologue de l’expédition du
capitaine Kot/.ebiie, dit avoir trouvé sur la pente du
Corcovado, près du chemin qui conduit de Laran-
geiras au sommet, un filon épais d’un demi-pied de
basalte compacte. Le passage suivant du voyage de
Victor Jacquemonl semblerait confirmer le fait de la
présence du basalte.
« ,)’ai découvert des trapps avec leurs vaques dans
l’île de Villegagnon ; ils forment la partie orientale de
celte petite île ; ils ne recouvrent point les gneiss qui
constituent le reste de l’île, mais s’appuient contre
la tranche de ses coupes, coupées verticalement du
nord an sud.
« La jonction des deux roches s’observe sur une
cinquantaine de pas. Le gneiss, au contact des vaques,
esl légèrement altéré; les paillettes de mica qui y sont
disséminées sont bronzées, et le feldspath est terreux.
Quant au irapp, il est noir, ti'ès-dur, divisé en
masses psendo-régulièrement rectangulaires. J’y ai
vainement cherché des indices de division colon-
naire.
« Au voisinage dn petit escarpement contre lequel
ces trapps s’appuient, ils sont terreux et friables, et
se divisent en tables schisteuses verticales, et consé-
quemment parallèles à la tranche des couches de
gneiss; ce sont des vaques.
G K O l.O G iE . 3.)
« Ces trapjis, aiixipiels je n’ose donner le nom de
ha.salte, fondent difficilement au chalumeau en émail
noir (1). »
Victor Jacquemoiit n’a vu de ces trapps ([u’à Ville-
gagnoii ; mais il pense que des recherches systématiques
en feraient découvrir d’autres sur les bords de
la haie.
Je n’ai pas vu le point dont il est ici question; mais
je crois que l’on serait dans l’erreur si l’on voulait
conclure de là qu’il y a des basaltes dans les environs
de Rio-Janeiro. La roclie que l ’uii et l’autre de ces
géologues a voulu désigner est probablement une diorite
compacte, dont la présence dans ce terrain s’ex-
pliipierait mieux que celle du ha.salte. Il estpossible, dn
reste, que ce soit la diorite compacte que Jacquemonl a
voulu désigner sous ce nom de irapp, qui n’a jamais
eu (|u’une signilication vague et assez mal définie.
La ville de Rio-Janeiro esl bâtie presque entièrement
avec les gneiss que lui fournissent les carrières
quiFavoisinent; mais la chaux employée dans les constructions
provient de la calcination des coquilles, et
esl généralement de mauvaise qualité.
Plusieurs voyageurs ont affirmé que feau de la haie
de Rio-Janeiro était moins salée que celle de l’Océan :
nous n’avons pas vérifié ce fai t , mais le nombre des
cours d’eau qui s’y jettent et le peu de largeur de
l’entrée le rendent très-prohahle.
Dans la haie de Rio-Janeiro, comme sur la plupart
des côtes intertropicales, les brises de terre et du large
( i) H is to r iqu e , v o l. I , p. 28.
Bonite. — Géol. et m inéral. 3