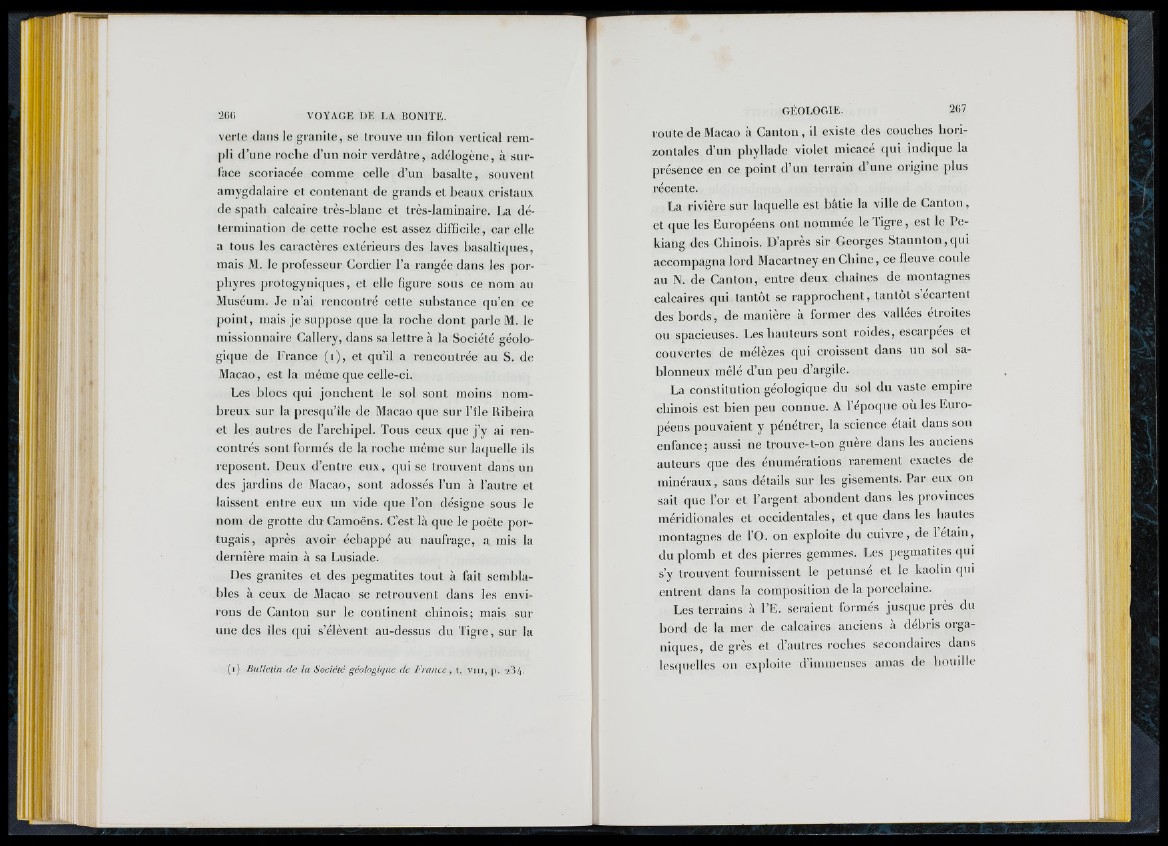
vcrle dans le gi aiiite, se Douve un iilou vertical retu-
|)li d’une roclie d’uu noir verdâtre, adélogène, à surface
scoriacée comme celle d’uu basalte, souvent
amygdalaire el contenant de grands et beaux cristaux
de spatb calcaire très-blanc et très-larninaire. La détermination
de cette rocbe est assez difficile, car elle
a tous les caractères extérieurs des laves basaltiques,
mais M. le professeur Cordier l’a rangée dans les porphyres
protogyuiques, et elle figure sous ce nom au
Muséum. Je ii’ai rencontré cette substance ([u’eii ce
point, mais je siip])ose cpie la rocbe dont parle M. le
missionnaire Callery, dans sa lettre à la Société géologique
de France (i), et cpi’il a rencontrée au S. de
Macao, est la même que celle-ci.
Les blocs qui jouclient le sol sont moins nombreux
sur la prescpi’île de Macao que sur l’île Ribeira
et les autres de l’archipel. Tous ceux cpie j’y ai rencontrés
seul formés de la rocbe même sur la(]uelle ils
rejiosent. Deux d’entre eux, qui se trouvent dans uu
des jardins de Macao, sont adossés l’un â l’autre el
laissent entre eux un vide que l’on désigne sous le
nom de grotte du Camoëns. C’est là que le poète portugais,
après avoir échappé au naufrage, a mis la
dernière main à sa Lusiade.
Des granités et des pegmatites tout à fait sembla-
bles à ceux de Macao se retrouvent dans les environs
de Canton sur le continent chinois; mais sur
une des iles qui s’élèvent au-dessus du Tigre, sur la
( i ) Bulletin (le la Société géolngUpic de France, I. v i i j , p . 254.
route de Macao à Canton, il existe des couches horizontales
d’un phyllade violet micacé c[ui indique la
présence en ce point d’un terrain d’une origine plus
récente.
La rivière sur laquelle esl bâtie la ville de Canton ,
et que les Européens ont nommée le Tigre, est le Pe-
kiang des Chinois. D’après sir Georges Staunton,qui
accompagna lord Macartney en Chine, ce fleuve coule
au N. de Canton, entre deux chaînes de montagnes
calcaires qui tantôt se rapprochent, tantôt s’écartent
des bords, de manière à former des vallées étroites
ou spacieuses. Les hauteurs sont roides, escarpees el
couvertes de mélèzes qui croissent dans un sol sablonneux
mêlé d’un peu d’argile.
La constitution géologique du sol du vaste empire
chinois est bien peu connue. A l’époque où les Européens
pouvaient y pénétrer, la science était dans sou
enfance; aussi ne trouve-t-on guère dans les anciens
auteurs c|ue des énumérations rarement exactes de
minéraux, sans détails sur les gisements. Par eux ou
sait que l’or et l’argent abondent dans les provinces
méridionales et occidentales, et que dans les hautes
montagnes de l’O. on exploite du cuivre, de letaiu,
du plomb et des pierres gemmes. Les pegmatites c|ui
s’y trouvent fournissent le pelimsé el le kaolin cpii
entrent dans la composition de la porcelaine.
Les terrains à TE. seraient formés jusque près du
bord de la mer de calcaires anciens à débris organiques,
de grès et d’autres roches secondaires dans
icscpielles on exploite d’immcuscs amas de bouille