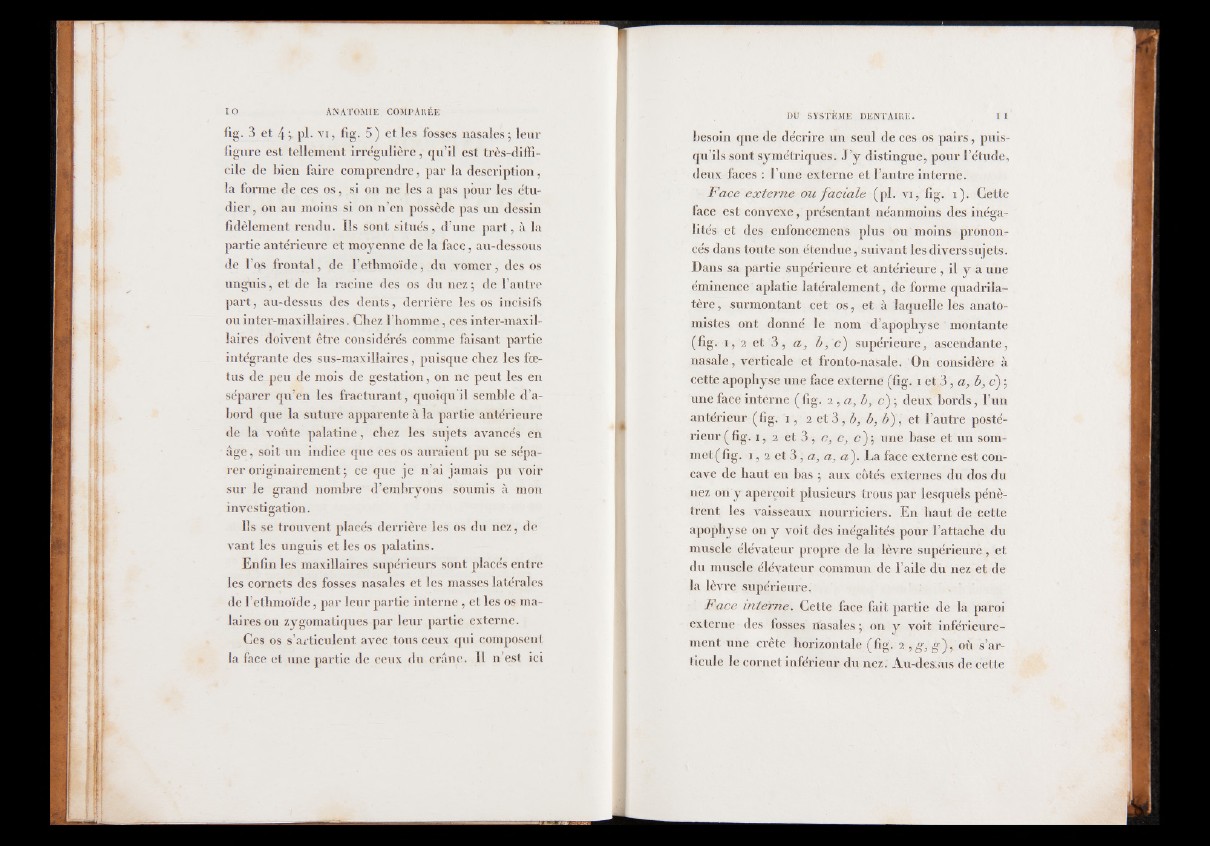
fig. 3 et 4 > pl. vi, fig. 5) et les fosses nasales; leur
ligure est tellement irre'gulière, qu’il est très-difficile
de bien faire comprendre, par la description,
la forme de ces os, si on ne les a pas pour les étudier,
ou au moins si on n’en possède pas un dessin
fidèlement rendu. Ils sont situés, d’une part, à la
partie antérieure et moyenne de la face, au-dessous
de l’os frontal, de l’efhmoïde, du vomer, des os
unguis, et de la racine des os du nez; de l’autre
part, au-dessus des dents, derrière les os incisifs
ou inter-maxillaires. Chez l ’homme, ces inter-maxillaires
doivent être considérés comme faisant partie
intégrante des sus-maxillaires, puisque chez les foetus
de peu de mois de gestation, on ne peut les en
séparer qu’en les fracturant, quoiqu'il semble d’abord
que la suture apparente à la partie antérieure
de la voûte palatine, chez les sujets avancés en
âge, soit un indice que ces os auraient pu se séparer
originairement ; ce que je n’ai jamais pu voir
sur le grand nombre d’embryons soumis à mon
investigation.
Ils se trouvent placés derrière les os du nez, de
vant les unguis et les os palatins.
Enfin les maxillaires supérieurs sont placés entre
les cornets des fosses nasales et les masses latérales
de l’ethmoïde, par leur partie interne , et les os malaires
ou zygomatiques par leur partie externe.
Ces os s'articulent avec tous ceux qui composent
la face et une partie de ceux du crâne. Il n’est ici
besoin qne de décrire un seul de ces os pairs, puisqu’ils
sont symétriques. J’y distingue, pour l’étude,
deux faces : l’une externe et l’autre interne.
Face externe ou faciale (pl. vi, fig. i). Cette
face est convexe, présentant néanmoins des inégalités
et des enfoncemens plus ou moins prononcés
dans toute son étendue, suivant les divers sujets.
Dans sa partie supérieure et antérieure , il y a une
éminence aplatie latéralement, de forme quadrilatère
, surmontant cet os, et à laquelle les anatomistes
ont donné le nom d’apophyse montante
(fig. i,'2 et 3 , a, b,F) supérieure, ascendante,
nasale, verticale et fronto-nasale. On considère à
cette apophyse une face externe (fig. i et 3, a, b, c) ;
une face interne (fig. 2, a, b, c) ; deux bords, l’un
antérieur (fig. i , 2 et 3 , b, b, b), et l ’autre postérieur
(fig. 1, 2 et 3 , c, c, c ) ; une base et un som-
met(fig. 1, 2 et 3, a, a, a'). La face externe est concave
de haut en bas ; aux côtés externes du dos du
nez on y aperçoit plusieurs trous par lesquels pénètrent
les vaisseaux nourriciers. En haut de cette
apophyse on y voit des inégalités pour l ’attache du
muscle élévateur propre de la lèvre supérieure, et
du muscle élévateur commun de l’aile du nez et de
la lèvre supérieure.
Face interne. Cette face fait partie de la paroi
externe des fosses nasales ; on y voit inférieurement
une crête horizontale (fig. 2 , g, g~) 7 où s’articule
le cornet inférieur du nez. Au-dessus de cette