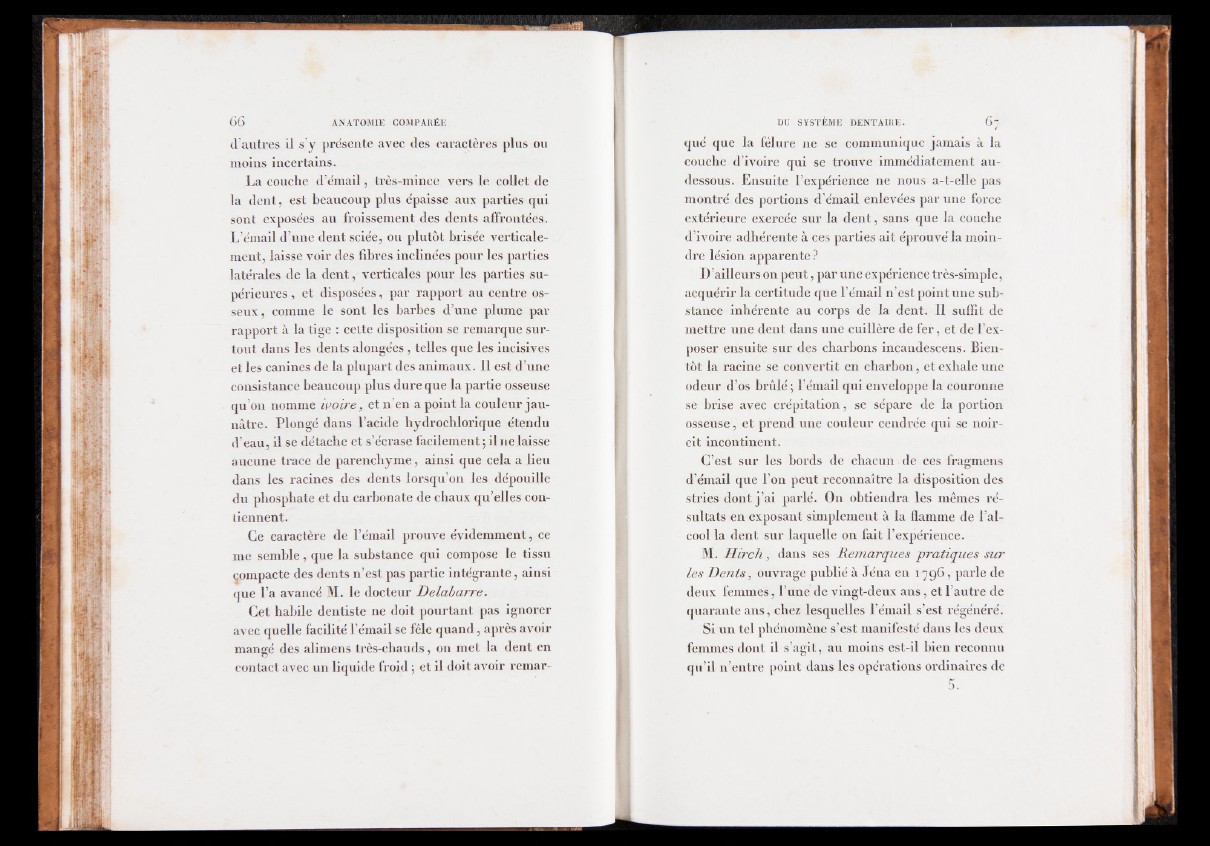
d'autres il s’y présente avec des caractères plus ou
moins incertains.
La couche d’émail, très-mince vers le collet de
la dent, est beaucoup plus épaisse aux parties qui
sont exposées au froissement des dents affrontées.
L'émail d’une dent sciée, ou plutôt brisée verticalement,
laisse voir des fibres inclinées pour les parties
latérales de la dent, verticales pour les parties supérieures
, et disposées, par rapport au centre osseux,
comme le sont les barbes d’une plume par
rapport à la tige : celte disposition se remarque surtout
dans les dents alongées, telles que les incisives
et les canines de la plupart des animaux. Il est d’une
consistance beaucoup plus dure que la partie osseuse
qu’on nomme ivoire, et n’en a point la couleur jaunâtre.
Plongé dans l’acide bydrochlorique étendu
d’eau, il se détache et s’écrase facilement ; il ne laisse
aucune trace de parenchyme, ainsi que cela a lieu
dans les racines des dents lorsqu’on les dépouille
du phosphate et du carbonate de chaux qu’elles contiennent.
Ce caractère de l’émail prouve évidemment, ce
me semble, que la substance qui compose le tissu
compacte des dents n’est pas partie intégrante, ainsi
que l’a avancé M. le docteur Delabarre.
Cet habile dentiste ne doit pourtant pas ignorer
avec quelle facilité l’émail se fêle quand, après avoir
mangé des alimens très-chauds, on met la dent en
contact avec un liquide froid ; et il doit avoir remarqué
que la fêlure ne se communique jamais à la
couche d’ivoire qui se trouve immédiatement au-
dessous. Ensuite l’expérience ne nous a-t-elle pas
montré des portions d’émail enlevées par une force
extérieure exercée sur la dent, sans que la couche
d’ivoire adhérente à ces parties ait éprouvé la moindre
lésion apparente ?
D’ailleurs on peut, par une expérience très-simple,
acquérir la certitude que l’émail n’est point une substance
inhérente au corps de la dent. Il suffit de
mettre une dent dans une cuillère de fer, et de l’exposer
ensuite sur des charbons incandescens. Bientôt
la racine se convertit en charbon, et exhale une
odeur d’os brûlé 5 l’émail qui enveloppe la couronne
se brise avec crépitation, se sépare de la portion
osseuse, et prend une couleur cendrée qui se noircit
incontinent.
C’est sur les bords de chacun de ces framtnens O d’émail que l’on peut reconnaître la disposition des
stries dont j’ai parlé. On obtiendra les mêmes résultats
en exposant simplement à la flamme de l’alcool
la dent sur laquelle on fait l’expérience.
M. Hirch, dans ses Remarques pratiques sur
les Dents, ouvrage publié à Jéna en 1796, parle de
deux femmes, l’une de vingt-deux ans, et l’autre de
quarante ans, chez lesquelles l’émail s’est régénéré.
Si un tel phénomène s’est manifesté dans les deux
femmes dont il s’agit, au moins est-il bien reconnu
qu’il n’entre point dans les opérations ordinaires de
5.