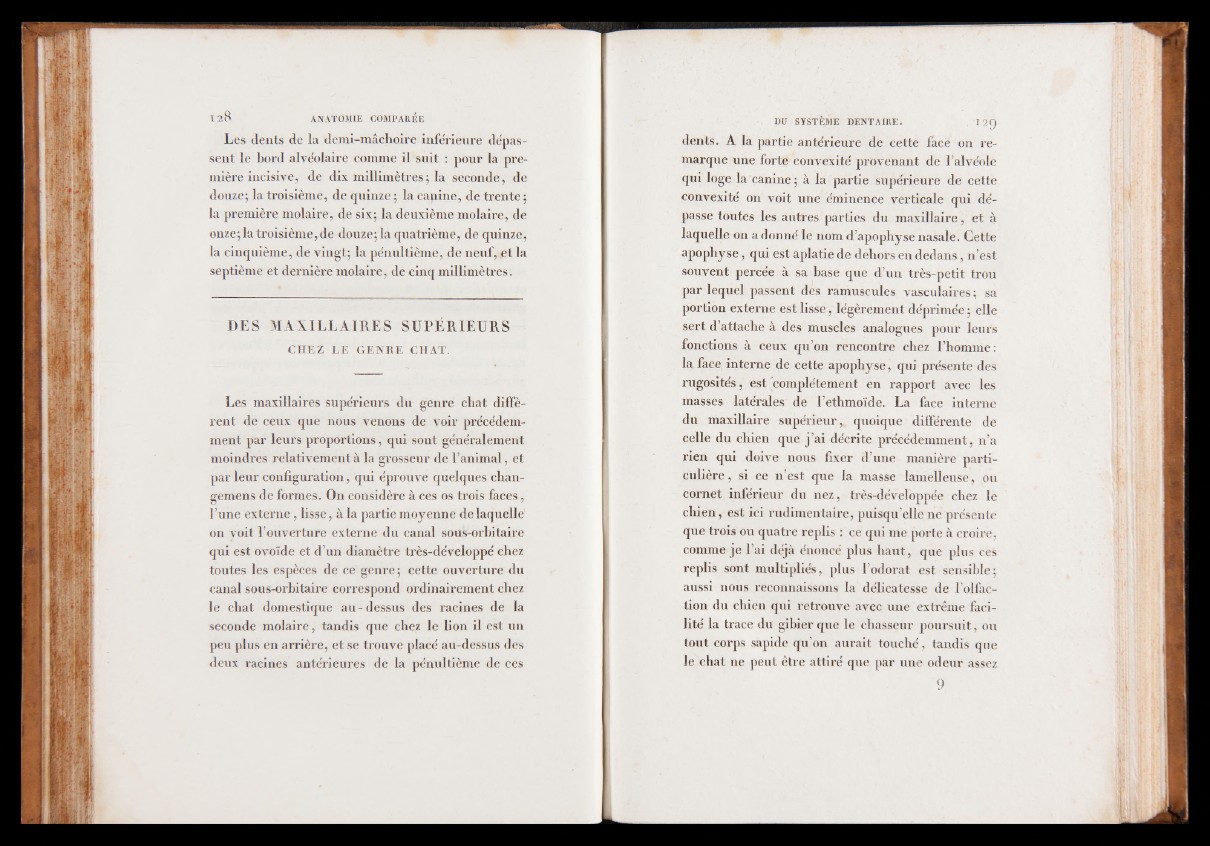
ANATOMIE COMPARÉE 128L
es dents de la demi-mâchoire inferieure dépassent
le bord alvéolaire comme il suit : pour la première
incisive, de dix millimètres ; la seconde, de
douze; la troisième, de quinze ; la canine, de trente ;
la première molaire, de six; la deuxième molaire, de
onze;latroisième,de douze;laquatrième, de quinze,
la cinquième, de vingt; la pénultième, de neuf, et la
septième et dernière molaire, de cinq millimètres.
DES M A X ILLA IR ES SU PÉR IEU R S
CHEZ LE GENRE CHAT.
Les maxillaires supérieurs du genre chat diffèrent
de ceux que nous venons de voir précédemment
par leurs proportions, qui sont généralement
moindres relativement à la grosseur de l’animal, et
par leur configuration, qui éprouve quelques chan-
gemens de formes. On considère à ces os trois faces,
l’une externe, lisse, à la partie moyenne de laquelle
on voit l’ouverture externe du canal sous-orbitaire
qui est ovoïde et d’un diamètre très-développé chez
toutes les espèces de ce genre ; cette ouverture du
canal sous-orbitaire correspond ordinairement chez
le chat domestique au-dessus des racines de la
seconde molaire, tandis que chez le lion il est un
peu plus en arrière, et se trouve placé au-dessus des
deux racines antérieures de la pénultième de ces
DU SYSTÈME DENTAIRE. . 1 29
dents. A la partie antérieure de cette face on remarque
une forte convexité provenant de l’alvéole
qui loge la canine; à la partie supérieure de cette
convexité on voit une éminence verticale qui dépasse
toutes les autres parties du maxillaire, et à
laquelle on a donné le nom d’apophyse nasale. Cette
apophyse, qui est aplatie de dehors en dedans, n’est
souvent percée à sa base que d’un très-petit trou
par lequel passent des ramuscules vasculaires ; sa
portion externe est lisse, légèrement déprimée ; elle
sert d’attache à des muscles analogues pour leurs
fonctions à ceux qu’on rencontre chez l’homme:
la face interne de cette apophyse, qui présente des
rugosités, est complètement en rapport avec les
masses latérales de l’ethmoïde. La face interne
du maxillaire supérieur, quoique différente de
celle du chien que j ’ai décrite précédemment, n’a
rien qui doive nous fixer d’une manière particulière,
si ce n’est que la masse lamelleuse, ou
cornet inférieur du nez, très-développée chez le
chien, est ici rudimentaire, puisqu’elle ne présente
que trois ou quatre replis : ce qui me porte à croire,
comme je l’ai déjà énoncé plus haut, que plus ces
replis sont multipliés, plus l’odorat est sensible;
aussi nous reconnaissons la délicatesse de l’olfaction
du chien qui retrouve avec une extrême facilité
la trace du gibier que le chasseur poursuit, ou
tout corps sapide qu’on aurait touché, tandis que
le chat ne peut être attiré que par une odeur assez