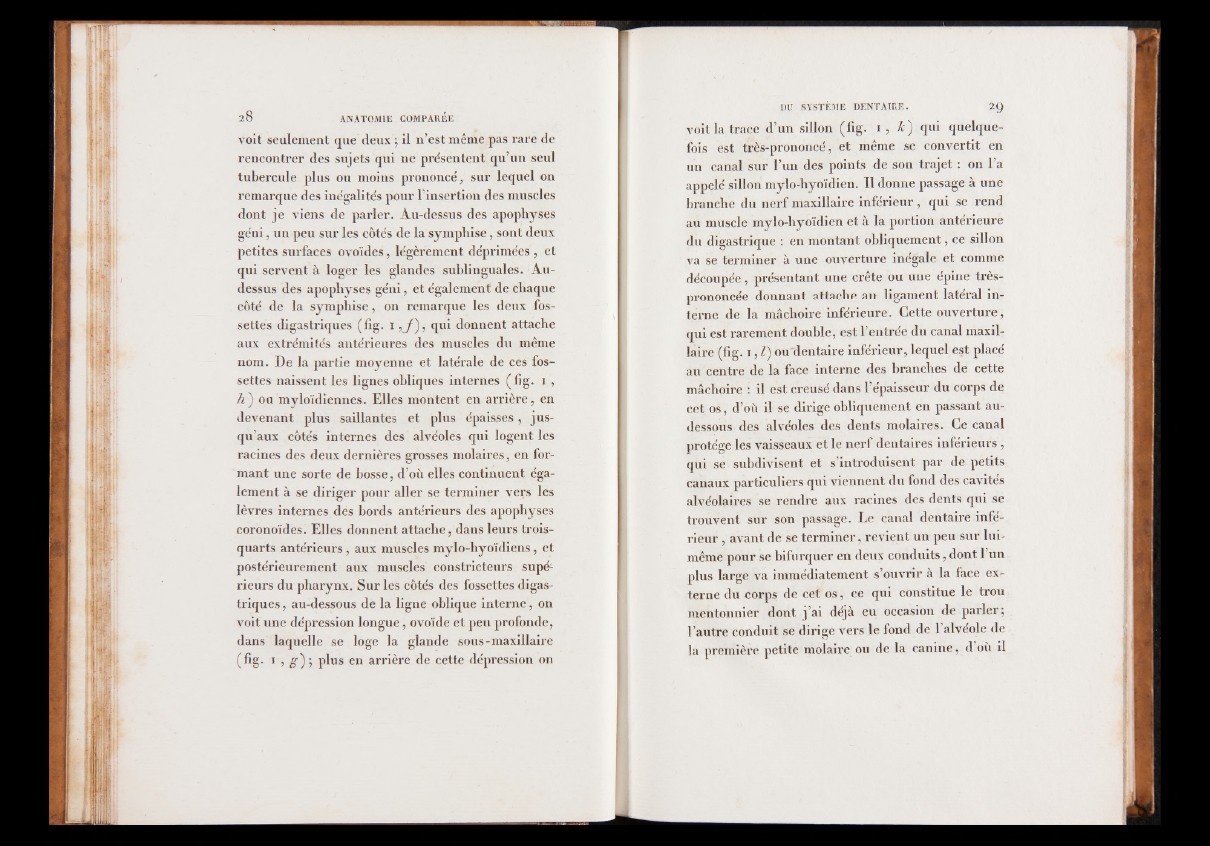
voit seulement que deux; il n’est même pas rare de
rencontrer des sujets qui ne présentent qu’un seul
tubercule plus ou moins prononcé, sur lequel on
remarque des inégalités pour l’insertion des muscles
dont je viens de parler. Au-dessus des apophyses
géni, un peu sur les côtés de la symphise, sont deux
petites sui'faces ovoïdes, légèrement déprimées , et
qui servent à loger les glandes sublinguales. Au-
dessus des apophyses géni, et également de chaque
côté de la symphise, on remarque les deux fossettes
digastriques (fig. x ,ƒ ) , qui donnent attache
aux extrémités antérieures des muscles du même
nom. De la partie moyenne et latérale de ces fossettes
naissent les lignes obliques internes (fig. l ,
A) ou myloïdiennes. Elles montent en arrière, en
devenant plus saillantes et plus épaisses, jusqu’aux
côtés internes des alvéoles qui logent les
racines des deux dernières grosses molaires, en formant
une sorte de bosse, d’où elles continuent également
à se diriger pour aller se terminer vers les
lèvres internes des bords antérieurs des apophyses
coron oïdes. Elles donnent attache, dans leurs trois-
quarts antérieurs, aux muscles mylo-hyoïdiens, et
postérieurement aux muscles constricteurs supé1
rieurs du pharynx. Sur les côtés des fossettes digastriques
, au-dessous de la ligne oblique interne, on
voit une dépression longue, ovoïde et peu profonde,
dans laquelle se loge la glande sous-maxillaire
(fig. i , g') ; plus en arrière de cette dépression on
voit la trace d’un sillon (fig. i , A) qui quelquefois
est très-prononcé, et même se convertit en
un canal sur l’un des points de son trajet : on l’a
appelé sillon mylo-hyoïdien. Il donne passage à une
branche du nerf maxillaire inférieur, qui se rend
au muscle mylo-hyoïdien et à la portion antérieure
du digastrique : en montant obliquement, ce sillon
va se terminer à une ouverture inégale et comme
découpée, présentant une crête ou une épine très-
prononcée donnant attache au ligament latéral interne
de la mâchoire inférieure. Cette ouverture,
qui est rarement double, est l’entrée du canal maxillaire
(fig. i , l ) ou dentaire inférieur, lequel est placé
au centre de la face interne des branches de cette
mâchoire : il est creusé dans l’épaisseur du corps de
cet os, d’où il se dirige obliquement en passant au-
dessous des alvéoles des dents molaires. Ce canal
protège les vaisseaux et le nerf dentaires inférieurs,
qui se subdivisent et s’introduisent par de petits
canaux particuliers qui viennent du fond des cavités
alvéolaires se rendre aux racines des dents qui se
trouvent sur son passage. Le canal dentaire inférieur
, avant de se terminer, revient un peu sur lui-
même pour se bifurquer en deux conduits, dont 1 un
plus large va immédiatement s’ouvrir à la face externe
du corps de cet os, ce qui constitue le trou
mentonnier dont j ’ai déjà eu occasion de parler;
l’autre conduit se dirige vers le fond de l’alvéole de
la première petite molaire ou de la canine, d’où il