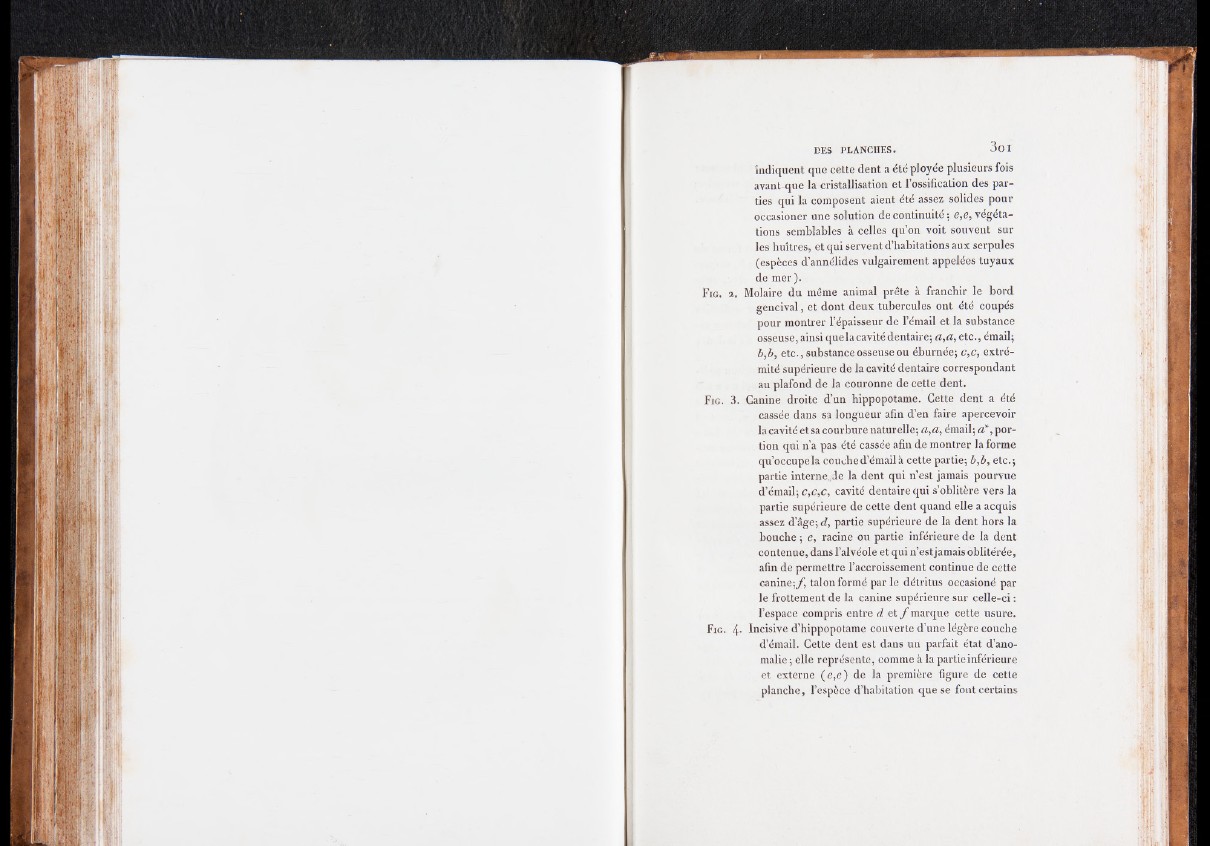
indiquent que cette dent a été ployée plusieurs fois
avant-que la cristallisation et l’ossification des parties
qui la composent aient été assez solides pour
occasioner une solution de continuité : e,e, végétations
semblables à celles qu’on voit souvent sur
les huîtres, et qui servent d’habitations aux serpules
(espèces d’annélides vulgairement appelées tuyaux
de mer).
Fig. 2. Molaire du même animal prête à franchir le bord
gencival, et dont deux tubercules ont été coupés
pour montrer l’épaisseur de l’émail et la substance
osseuse, ainsi que la cavité dentaire; a,a, etc., émail;
b,b, etc., substance osseuse ou éburnée; e,c, extrémité
supérieure de la cavité dentaire correspondant
au plafond de la couronne de cette dent.
Fig. 3. Ganine droite d’un hippopotame. Cette dent a été
cassée dans sa longueur afin d’en faire apercevoir
lacavité et sa courbure naturelle; a,a , émail; a*, portion
qui n’a pas été cassée afin de montrer la forme
qu’occupe la couche d’émail à cette partie; b,b, etc.;
partie interne,;de la dent qui n’est jamais pourvue
d’émail; c,c,c, cavité dentaire qui s’oblitère vers la
partie supérieure de cette dent quand elle a acquis
assez d’âge; d, partie supérieure de la dent hors la
bouche ; e, racine ou partie inférieure de la dent
contenue, dans l’alvéole et qui n’est jamais oblitérée,
afin de permettre l’accroissement continue de cette
canine ;ƒ, talon formé parle détritus occasioné par
le frottement de la canine supérieure sur celle-ci :
l’espace compris entre d et f marque cette usure.
Fig. 4- Incisive d’hippopotame couverte d’une légère couche
d’émail. Cette dent est dans un parfait état d’anomalie
; elle représente, comme à la partie inférieure
et externe (e ,e ) de la première figure de cette
planche, l’espèce d’habitation que se font certains