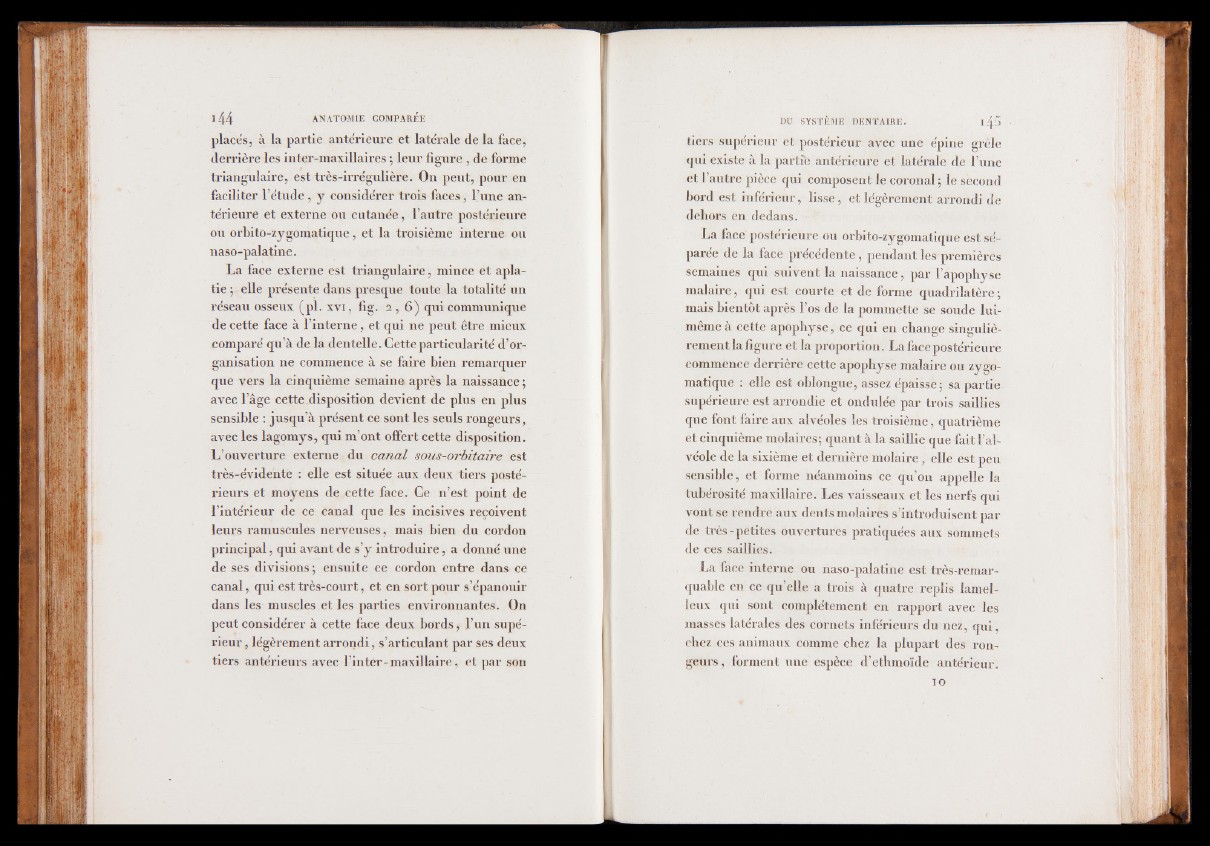
placés, à la partie antérieure et latérale de la face,
derrière les inter-maxillaires ; leur figure , de forme
triangulaire, est très-irrégulière. On peut, pour en
faciliter l’étude, y considérer trois faces, l’une antérieure
et externe ou cutanée, l’autre postérieure
ou orbito-zygomatique, et la troisième interne ou
naso-palatine.
La face externe est triangulaire, mince et aplatie
; elle présente dans presque toute la totalité un
réseau osseux (pl. xvi, fig. 2, 6) qui communique
de cette face à l’interne, et qui ne peut être mieux
comparé qu’à de la dentelle. Cette particularité d’organisation
ne commence à se faire bien remarquer
que vers la cinquième semaine après la naissance ;
avec l’âge cette disposition devient de plus en plus
sensible : jusqu’à présent ce sont les seuls rongeurs ,
avec les lagomys, qui m’ont offert cette disposition.
L’ouverture externe du canal sous-orbitaire est
très-évidente : elle est située aux deux tiers postérieurs
et moyens de cette face. Ce n’est point de
l’intérieur de ce canal que les incisives reçoivent
leurs ramuscules nerveuses, mais bien du cordon
principal, qui avant de s’y introduire, a donné une
de ses divisions ; ensuite ce cordon entre dans ce
canal, qui est très-court, et en sort pour s’épanouir
dans les muscles et les parties environnantes. On
peut considérer à cette face deux bords, l’un supérieur
, légèrement arrondi, s’articulant par ses deux
tiers antérieurs avec l’inter-maxillaire, et par son
tiers supérieur et postérieur avec une épine grêle
qui existe à la partie antérieure et latérale de l’une
et l’autre pièce qui composent le coronal ; le second
bord est inférieur, lisse, et légèrement arrondi de
dehors en dedans.
La face posterieure ou orbito-zygomatique est séparée
de la face précédente, pendant les premières
semaines qui suivent la naissance, par l’apophyse
malaire, qui est courte et de forme quadrilatère ;
mais bientôt après l’os de la pommette se soude lui-
même à cette apophyse, ce qui en change singulièrement
la figure et la proportion. La face postérieure
commence derrière cette apophyse malaire ou zygomatique
: elle est oblongue, assez épaisse ; sa partie
supérieure est arrondie et ondulée par trois saillies
que font faire aux alvéoles les troisième, quatrième
et cinquième molaires; quant à la saillie que fait l’alvéole
de la sixième et dernière molaire, elle est peu
sensible, et forme néanmoins ce qu’on appelle la
tubérosité maxillaire. Les vaisseaux et les nerfs qui
vont se rendre aux dents molaires s’introduisent par
de très-petites ouvertures pratiquées aux sommets
de ces saillies.
La face interne ou naso-palatine est très-remarquable
en ce qu’elle a trois à quatre replis lamel-
leux qui sont complètement en rapport avec les
masses latérales des cornets inférieurs du nez, qui,
chez ces animaux comme chez la plupart des rongeurs,
forment une espèce d’ethmoïde antérieur.