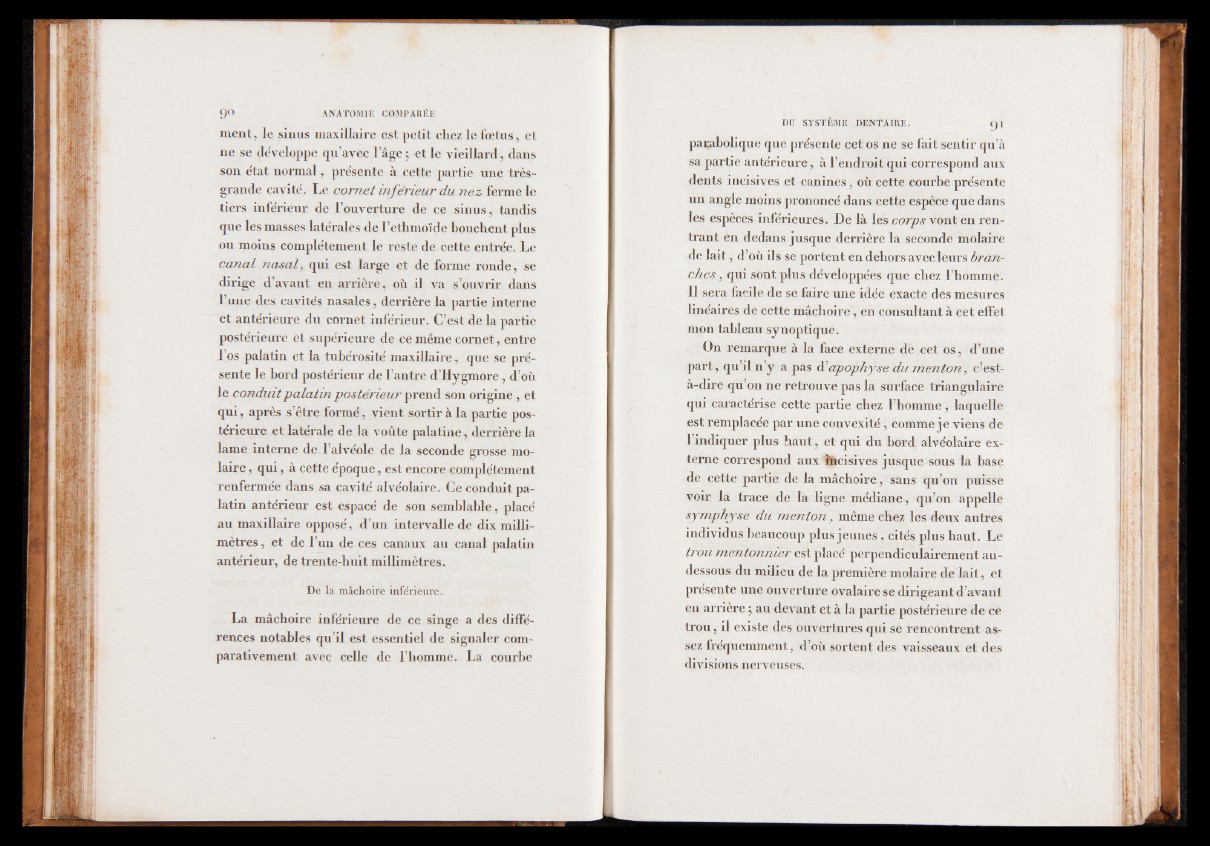
ment, le sinus maxillaire est petit chez le foetus, et
ne se développe qu’avec 1 âge ; et le vieillard, dans
son état normal, présente à cette partie une très-
grande cavité. Le cornet inférieur du nez ferme le
tiers inférieur de l’ouverture de ce sinus, tandis
que les masses latérales de l’ethmoïde bouchent plus
ou moins complètement le reste de cette entrée. Le
canal nasal, qui est large et de forme ronde, se
dirige d’avant en arrière, où il va s’ouvrir dans
l’une des cavités nasales, derrière la partie interne
et antérieure du cornet inférieur. C’est de la partie
postérieure et supérieure de ce même cornet, entre
l’os palatin et la tubérosité maxillaire, que se présente
le bord postérieur de l’antre d’Hygmore, d’où
le conduit palatin postérieur prend son origine , et
qui, après s’être formé, vient sortir à la partie postérieure
et latérale de la voûte palatine, derrière la
lame interne de l’alvéole de la seconde grosse mo-
laire, qui, à cette époque, est encore complètement
renfermée dans sa cavité alvéolaire. Ce conduit palatin
antérieur est espacé de son semblable, placé
au maxillaire opposé, d’un intervalle de dix millimètres
, et de l’un de ces canaux au canal palatin
antérieur, de trente-huit millimètres.
De la mâchoire inférieure.
La mâchoire inférieure de ce singe a des différences
notables qu’il est essentiel de signaler comparativement
avec celle de l’homme. La courbe
parabolique que présente cet os ne se fait sentir qu’à
sa partie antérieure, à l’endroit qui correspond aux
dents incisives et canines, où cette courbe présente
un angle moins prononcé dans cette espèce que dans
les espèces inférieures. De là les corps vont en rentrant
en dedans jusque derrière la seconde molaire
de lait, d’où ils se portent en dehors avec leurs branches,
qui sont plus développées que chez l’homme.
Il sera facile de se faire une idée exacte des mesures
linéaires de cette mâchoire, en consultant à cet effet
mon tableau synoptique.
On remarque à la face externe de cet os, d’une
part, qu’il n’y a pas d'apophyse du menton, c’est-
à-dire qu’on ne retrouve pas la surface triangulaire
qui caractérise cette partie chez l’homme, laquelle
est remplacée par une convexité, comme je viens de
l’indiquer plus haut, et qui du bord alvéolaire externe
correspond aux Incisives jusque sous la base
de cette partie de la mâchoire, sans qu’on puisse
voir la trace de la ligne médiane, qu’on appelle
symphyse du menton, même chez les deux autres
individus beaucoup plus jeunes, cités plus haut. Le
trou mentonnier est placé perpendiculairement au-
dessous du milieu de la première molaire de lait, et
présente une ouverture ovalaire se dirigeant d’avant
en arrière ; au devant et à la partie postérieure de ce
trou, il existe des ouvertures qui se rencontrent assez
fréquemment, d’où sortent des vaisseaux et des
divisions nerveuses.