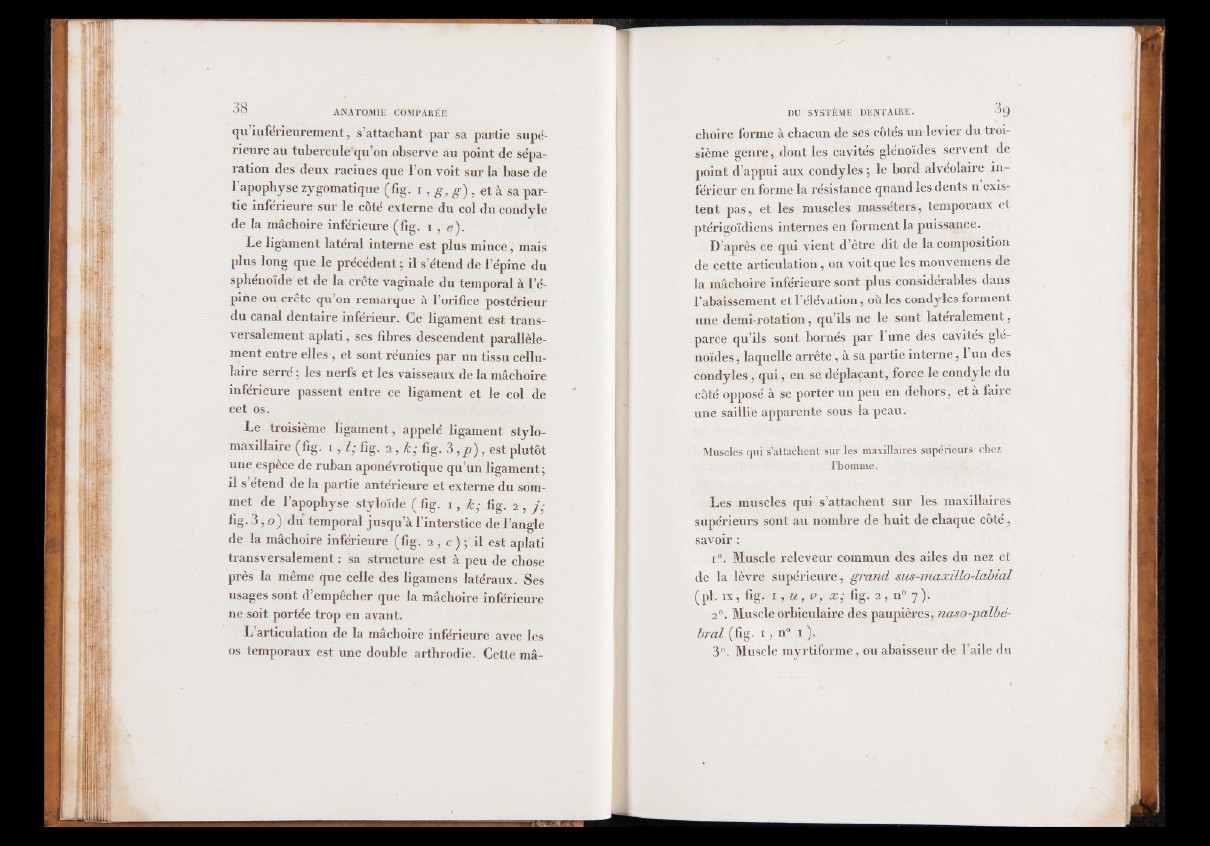
qu’inférieurement, s’attachant par sa partie superieure
au tubercule qu’on observe au point de séparation
des deux racines que l ’on voit sur la base de
l ’apophyse zygomatique (fig. !r g, g % et à sa partie
inférieure sur le côté externe du col du condyle
de la mâchoire inférieure (fig. i , e).
Le ligament latéral interne est plus mince, mais
plus long que le précédent 5 il s’étend de l’épine du
sphénoïde et de la crête vaginale du temporal à l’épine
ou crête qu’on remarque à l ’orifice postérieur
du canal dentaire inférieur. Ce ligament est transversalement
aplati, ses fibres descendent parallèlement
entre elles , et sont réunies par un tissu cellulaire
serré ; les nerfs et les vaisseaux de la mâchoire
inférieure passent entre ce ligament et le col de
cet os.
Le troisième ligament, appelé ligament stylo-
maxillaire (fig. 1, l- fig. 2, k ■ fig. 3 , p ) , est plutôt
une espèce de ruban aponévrotique qu’un ligament |
il s’étend de la partie antérieure et externe du sommet
de l ’apophyse styloïde (fig. 1 , k; fig. 2 , g§
fig. 3, o) du temporal jusqu’à l’interstice de l ’angle
de la mâchoire inférieure (fig. 2, c) ; il est aplati
transversalement : sa structure est à peu de chose
près la même que celle des ligamens latéraux. Ses
usages sont d’empêcher que la mâchoire inférieure
ne soit portée trop en avant.
L articulation de la mâchoire inférieure avec les
os temporaux est une double arthrodie. Cette mâchoire
forme à chacun de ses côtés un levier du troisième
genre, dont les cavités gléno'ïdes servent de
point d’appui aux condyles ] le bord alvéolaire inférieur
en forme la résistance quand les dents n existent
pas, et les muscles masséters, temporaux et
ptérigoïdiens internes en forment la puissance.
D’après ce qui vient d’être dit de la composition
de cette articulation, on voit que les mouvemens de
la mâchoire inférieure sont plus considérables dans
l’abaissement et l’élévation, où les condyles forment
une demi-rotation, qu’ils ne le sont latéralement,
parce qu’ils sont bornés par l’une des cavités gle-
noïdes, laquelle arrête, à sa partie interne, l’un des
condyles, qui, en se déplaçant, force le condyle du
côté opposé à se porter un peu en dehors, et à faire
une saillie apparente sous la peau.
Muscles qui s’attachent sur les maxillaires supérieurs chez
l’homme.
Les muscles qui s’attachent sur les maxillaires
supérieurs sont au nombre de huit de chaque côté,
savoir :
i°. Muscle releveur commun des ailes du nez et
de la lèvre supérieure, grand sus-maxillo-labial
(pi. ix, fig. 1, u , v, x - fig. 2, n° 7).
2°i Muscle orbiculaire des paupières, naso-palbé-
bral (fig. 1, n° i ).
3°. Muscle myrtiforme, ou abaisseur de l’aile du