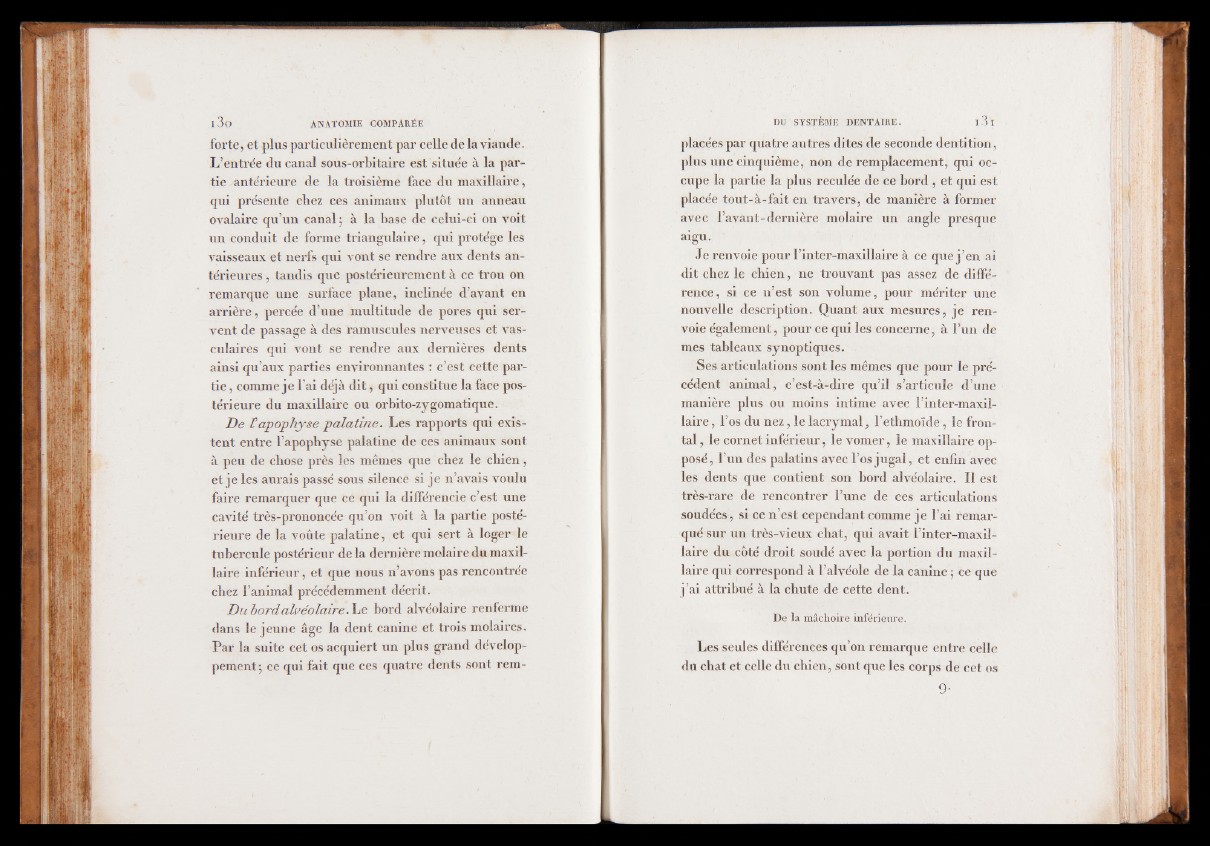
forte, et plus particulièrement par celle de la viande.
L’entrée du canal sous-orbitaire est située à la partie
antérieure de la troisième face du maxillaire,
qui présente chez ces animaux plutôt un anneau
ovalaire qu’un canal 5 à la base de celui-ci on voit
un conduit de forme triangulaire, qui protège les
vaisseaux et nerfs qui vont se rendre aux dents antérieures
, tandis que postérieurement à ce trou on
remarque une surface plane, inclinée d’avant en
arrière, percée d’une multitude de pores qui servent
de passage à des ramuscules nerveuses et vasculaires
qui vont se rendre aux dernières dents
ainsi qu’aux parties environnantes : c’est cette partie
, comme je l’ai déjà d it, qui constitue la face postérieure
du maxillaire ou orbito-zygomatique.
De T apophyse palatine. Les rapports qui existent
entre l’apophyse palatine de ces animaux sont
à peu de chose près les mêmes que chez le chien,
et je les aurais passé sous silence si je n’avais voulu
faire remarquer que ce qui la différencie c’est une
cavité très-prononcée qu’on voit à la partie postérieure
de la voûte palatine, et qui sert à loger le
tubercule postérieur de la dernière molaire du maxillaire
inférieur, et que nous n’avons pas rencontrée
chez l’animal précédemment décrit.
Du bord alvéolaire. Le bord alvéolaire renferme
dans le jeune âge la dent canine et trois molaires.
Par la suite cet os acquiert un plus grand développement
•, ce qui fait que ces quatre dents sont remplacées
par quatre autres dites de seconde dentition,
plus une cinquième, non de remplacement, qui occupe
la partie la plus reculée de ce bord , et qui est
placée tout-à-fait en travers, de manière à former
avec l’avânt-dernière molaire un angle presque
aigu.
Je renvoie pour l’inter-maxillaire à ce que j ’en ai
dit chez le chien, ne trouvant pas assez de différence,
si ce 11’est son volume, pour mériter une
nouvelle description. Quant aux mesures, je renvoie
également, pour ce qui les concerne, à l’un de
mes tableaux synoptiques.
Ses articulations sont les mêmes que pour le précédent
animal, c’est-à-dire qu’il s’articule d’une
manière plus ou moins intime avec l’inter-maxil-
laire, l’os du nez, le lacrymal, l’ethmoïde, le frontal
, le cornet inférieur, le vomer, le maxillaire opposé,
l’un des palatins avec l’os jugal, et enfin avec
les dents que contient son bord alvéolaire. Il est
très-rare de rencontrer l’une de ces articulations
soudées, si ce n’est cependant comme je l’ai remarqué
sur un très-vieux chat, qui avait l’inter-maxil-
laire du côté droit soudé avec la portion du maxillaire
qui correspond à l’alvéole de la canine ; ce que
j’ai attribué à la chute de cette dent.
De la mâchoire inférieure.
Les seules différences qu’on remarque entre celle
du chat et celle du chien, sont que les corps de cet os