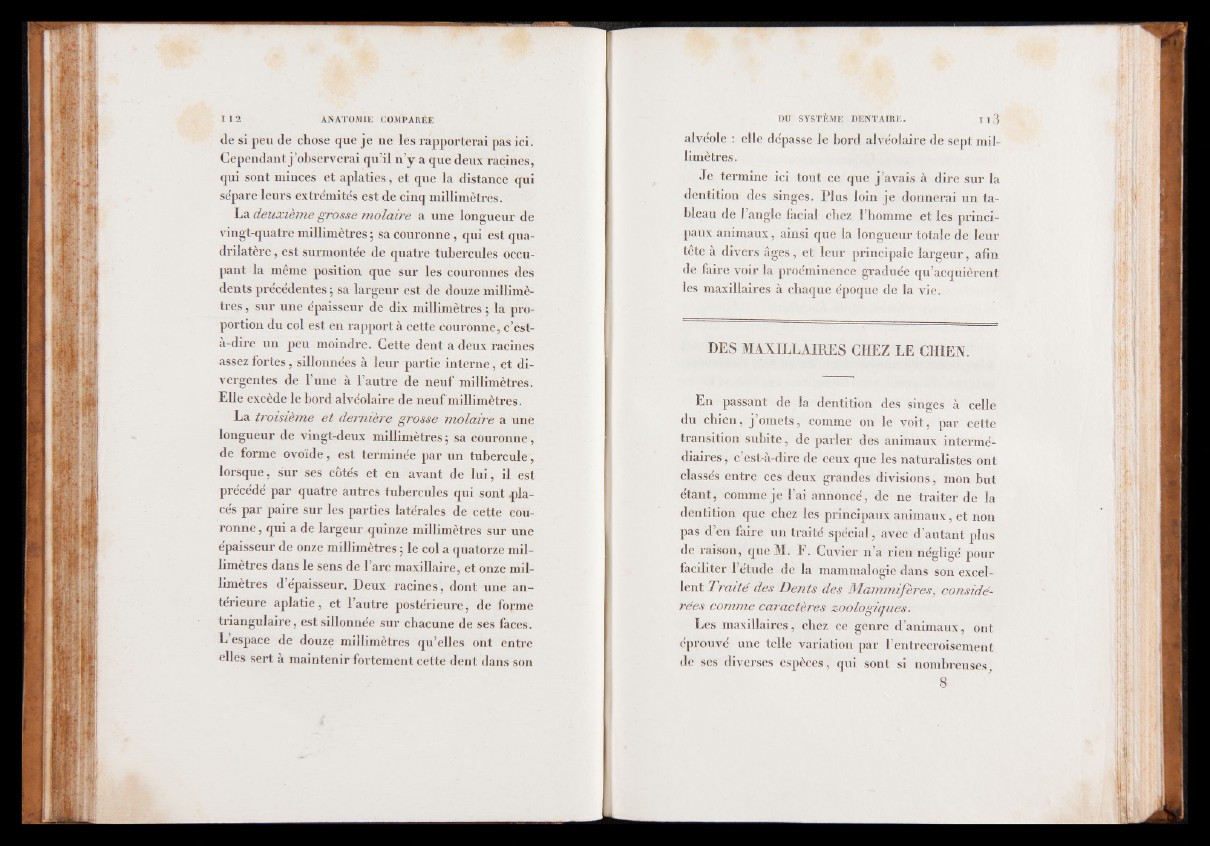
de si peu de chose que je ne les rapporterai pas ici.
Cependant j ’observerai qu’il n’y a que deux racines,
qui sont minces et aplaties, et que la distance qui
se'pare leurs extrémités est de cinq millimètres.
La deuxième grosse molaire a une longueur de
vingt-quatre millimètres ; sa couronne, qui est quadrilatère
, est surmontée de quatre tubercules occupant
la même position que sur les couronnes des
dents précédentes ; sa largeur est de douze millimètres
, sur une épaisseur de dix millimètres ; la proportion
du col est en rapport à cette couronne, c’est-
à-dire un peu moindre. Cette dent a deux racines
assez fortes, sillonnées à leur partie interne, et divergentes
de 1 une à l’autre de neuf millimètres.
Elle excède le bord alvéolaire de neuf millimètres.
La troisième et dernière grosse molaire a une
longueur de vingt-deux millimètres; sa couronne,
de forme ovoïde, est terminée par un tubercule,
lorsque, sur ses côtés et en avant de lui, il est
précédé par quatre autres tubercules qui sont .placés
par paire sur les parties latérales de cette couronne
, qui a de largeur quinze millimètres sur une
épaisseur de onze millimètres ; le col a quatorze millimètres
dans le sens de l’arc maxillaire, et onze millimètres
d’épaisseur. Deux racines, dont une anterieure
aplatie, et l’autre postérieure, de forme
triangulaire, est sillonnée sur chacune de ses faces.
L espace de douze millimètres qu’elles ont entre
elles sert à maintenir fortement cette dent dans son
alvéole : elle dépasse le bord alvéolaire de sept millimètres.
Je termine ici tout ce que j ’avais à dire sur la
dentition des singes. Plus loin je donnerai un tableau
de l’angle facial chez l’homme et les principaux
animaux, ainsi que la longueur totale de leur
tête à divers âges, et leur principale largeur, afin
de faire voir la proéminence graduée qu’acquièrent
les maxillaires à chaque époque de la vie.
DES MAXILLAIRES CHEZ LE CHIEN.
En passant de la dentition des singes à celle
du chien, j ’omets, comme on le voit, par cette
transition subite, de parler des animaux intermédiaires
, c’est-à-dire de ceux que les naturalistes ont
classés entre ces deux grandes divisions, mon but
étant, comme je l’ai annoncé, de ne traiter de la
dentition que chez les principaux animaux, et non
pas d’en faire un traité spécial, avec d’autant plus
de raison, que M. F. Cuvier n’a rien négligé pour
faciliter l’étude de la mammalogie dans son excellent
Traité des Dents des Mammifères, considérées
comme caractères zoologiques.
Les maxillaires, chez ce genre d’animaux, ont
éprouvé une telle variation par l’entrecroisement
de ses diverses espèces, qui sont si nombreuses
8