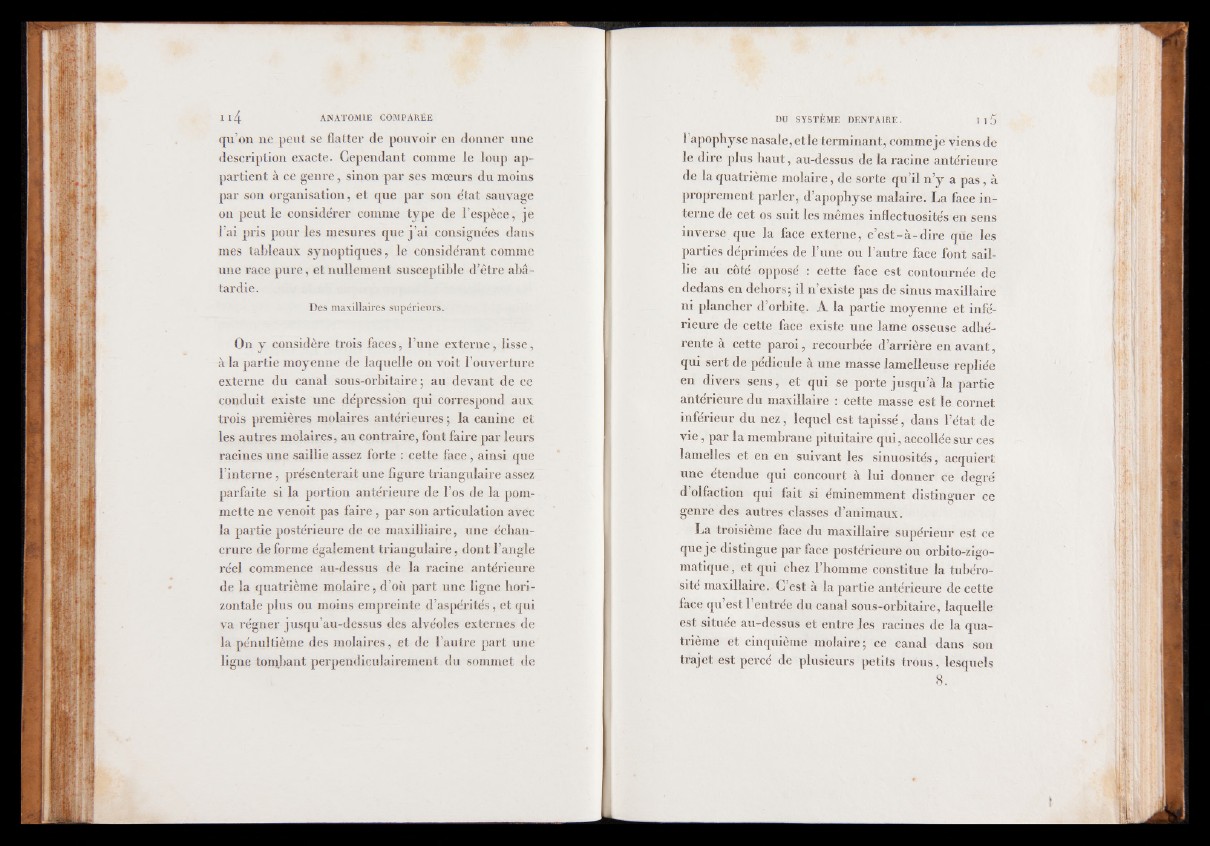
qu’on ne peut se flatter de pouvoir en donner une
description exacte. Cependant comme le loup appartient
à ce genre, sinon par ses moeurs du moins
par son organisation, et que par son e'tat sauvage
on peut le considérer comme type de l’espèce, je
l’ai pris pour les mesures que j ’ai consignées dans
mes tableaux synoptiques, le considérant comme
une race pure, et nullement susceptible d’être abâtardie.
Des maxillaires supérieurs.
On y considère trois faces, l’une externe, lisse,
à la partie moyenne de laquelle on voit l’ouverture
externe du canal sous-orbitaire ; au devant de ce
conduit existe une dépression qui correspond aux
trois premières molaires antérieures ; la canine et
les autres molaires, au contraire, font faire par leurs
racines une saillie assez forte : cette face, ainsi que
l’interne , présenterait une figure triangulaire assez
parfaite si la portion antérieure de l’os de la pommette
ne venoit pas faire, par son articulation avec
la partie postérieure de ce maxilliaire, une échancrure
de forme également triangulaire, dont l’angle
réel commence au-dessus de la racine antérieure
de la quatrième molaire, d’où part une ligne horizontale
plus ou moins empreinte d’aspérités, et qui
va régner jusqu’au-dessus des alvéoles externes de
la pénultième des molaires, et de l’autre part une
ligne tombant perpendiculairement du sommet de
l’apophyse nasale, etle terminant, commeje viens de
le dire plus haut, au-dessus de la racine antérieure
de la quatrième molaire, de sorte qu’il n’y a pas, à
proprement parler, d’apophyse malaire. La face interne
de cet os suit les mêmes inflectuosités en sens
inverse que la face externe, c’est-à-dire que les
parties déprimées de l’une ou l’autre face font saillie
au côté opposé : cette face est contournée de
dedans en dehors; il n’existe pas de sinus maxillaire
ni plancher d’orbitç. A la partie moyenne et inférieure
de cette face existe une lame osseuse adhérente
à cette paroi, recourbée d’arrière en avant,
qui sert de pédicule à une masse lamelleuse repliée
en divers sens, et qui se porte jusqu a la partie
antérieure du maxillaire : cette masse est le cornet
inférieur du nez, lequel est tapissé, dans l’état de
vie, par la membrane pituitaire qui, accollée sur ces
lamelles et en en suivant les sinuosités, acquiert
une étendue qui concourt à lui donner ce degré
d’olfaction qui fait si éminemment distinguer ce
genre des autres classes d’animaux.
La troisième face du maxillaire supérieur est ce
que je distingue par face postérieure ou orbito-zigo-
matique, et qui chez l’homme constitue la tubérosité
maxillaire. C’est à la partie antérieure de cette
face qu est l’entrée du canal sous-orbitaire, laquelle
est située au-dessus et entre les racines de la quatrième
et cinquième molaire; ce canal dans son
trajet est percé de plusieurs petits trous, lesquels