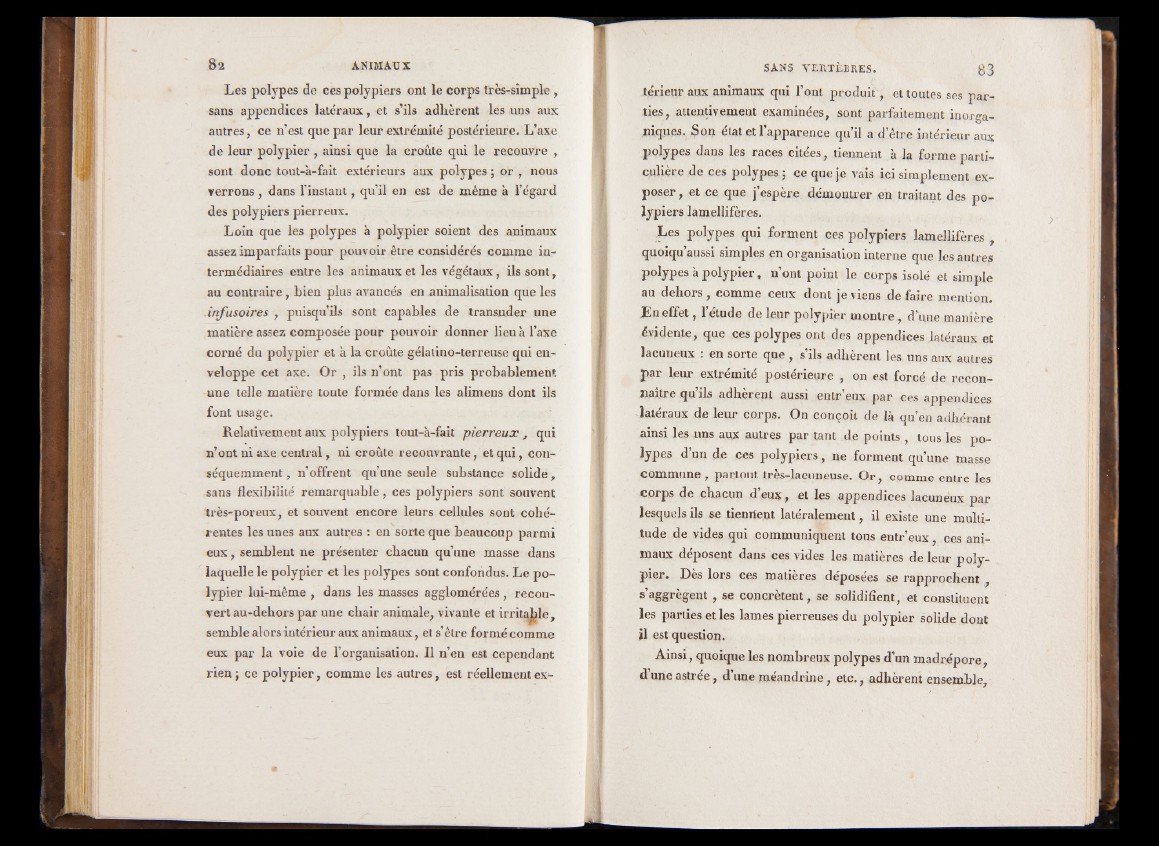
Les polypes de ces polypiers ont le corps très-simple ,
sans appendices latéraux, et s’ils adhèrent les uns aux
autres, ce n’est que par leur extrémité postérieure. L ’axe
de leur polypier , ainsi que la croûte qui le recouvre y
sont donc tout-à-fait extérieurs aux polypes ; or , nous
verrons y dans l’instant, qu’il en est de même à l’égard
des polypiers pierreux.
Loin que les polypes à polypier soient des animaux
assez imparfaits pour pouvoir être considérés comme intermédiaires
entre les animaux et les végétaux, ils sont,
au contraire, bien plus avancés en animalisation que les
infusoires , puisqu’ils sont capables de transuder une
matière assez composée pour pouvoir donner lieu à l’axe
corné du polypier et à la croûte gélatino-terreuse qui enveloppe
cet axe. Or , ils n’ont pas pris probablement
une telle matière toute formée dans les alimens dont ils
font usage.
Relativement aux polypiers tout-à-fait pierreux , qui
n’ont ni axe central, ni croûte recouvrante, et qui, conséquemment
, n’offrent qu’une seule substance solide,
sans flexibilité remarquable, ces polypiers sont souvent
très-poreux, et souvent encore leurs cellules sont cohérentes
les unes aux autres : en sorte que beaucoup parmi
eux, semblent ne présenter chacun qu’une masse dans
laquelle le polypier et les polypes sont confondus. Le polypier
lui-même , dans les masses agglomérées, recouvert
au-dehors par une chair animale, vivante et irritable,
semble alors intérieur aux animaux, et s’être formé comme
eux par la voie de l’organisation. Il n’en est cependant
rien ; ce polypier, comme les autres, est réellement extérieur
aux animaux qui l’ont produit, et toutes ses par-i
lies, attentivement examinées, sont parfaitement inorganiques.
Son état et l’apparence qu’il a d’être intérieur aux
polypes dans les races citées, tiennent à la forme particulière
de ces polypes ; ce que je vais ici simplement exposer,
et ce que j’espère démontrer en traitant des polypiers
lamellifères.
Les polypes qui forment ces polypiers lamellifères ,
quoiqu’aussi simples en organisation interne que les autres
polypes à polypier, n’ont point le corps isolé et simple
au dehors , comme ceux dont je viens de faire mention.
J£n effet, l’étude de leur polypier montre , d’une manière
évidente, que ces polypes ont des appendices latéraux et
lacuneux . en sorte que , s ils adhèrent les uns aux autres
par leur extrémité postérieure , on est forcé de reconnaître
qu ils adhèrent aussi enlr eux par ces appendices
latéraux de leur corps. On conçoit de là qu’en adhérant
ainsi les uns aux autres par tant de points , tous les polypes
d’un de ces polypiers, ne forment qu’une masse
commune , partout très-lacuneuse. O r , comme entre les
corps de chacun d eux, et les appendices lacuneux par
lesquels ils se tiennent latéralement, il existe une multitude
de vides qui communiquent tous entr’eux ces animaux
déposent dans ces vides les matières de leur polypier.
Des lors ces matières déposées se rapprochent ,
s’aggrègent , se concrètent, se solidifient, et constituent
les parties et les lames pierreuses du polypier solide dont
R est question.
Ainsi, quoique les nombreux polypes d’un madrépore
d’une astrée, d’une méandrine, etc., adhèrent ensemble,