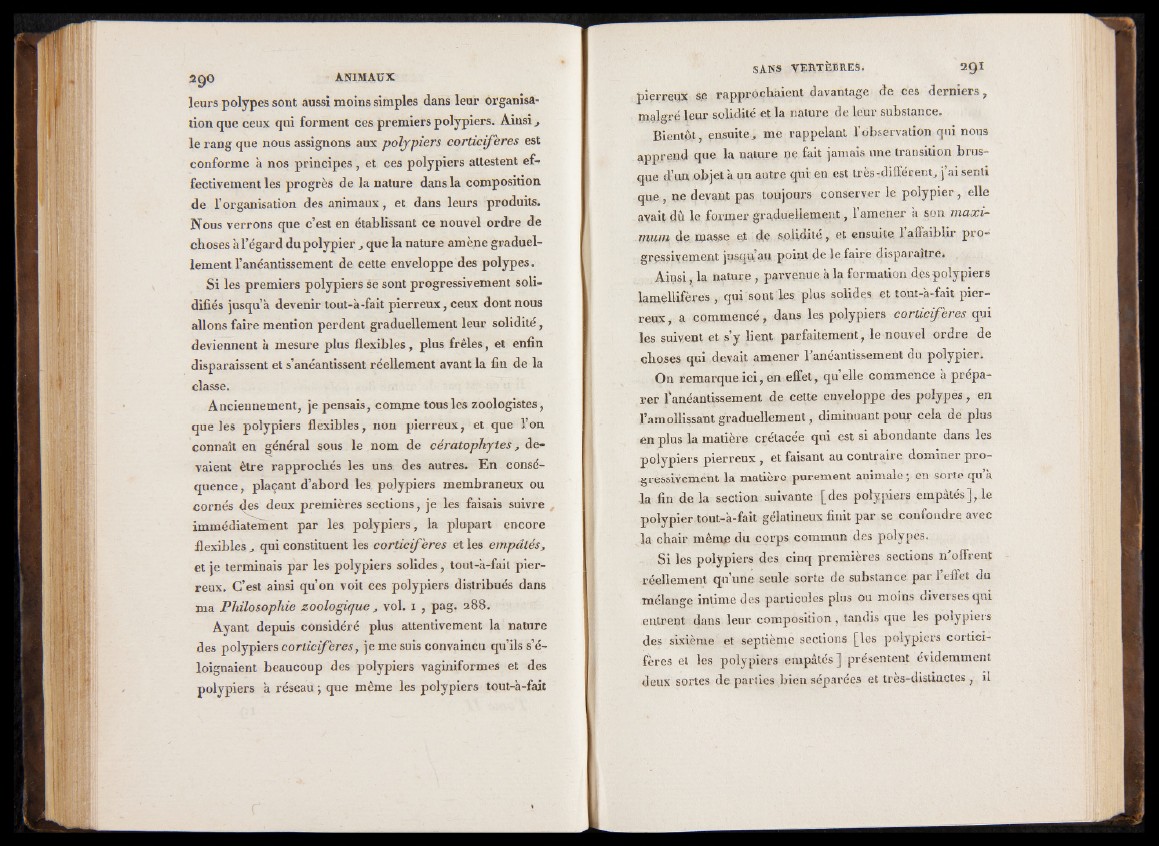
leurs polypes sont aussi moins simples dans leur organisation
que ceux qui forment ces premiers polypiers. Ainsi,
le rang que nous assignons aux polypiers corticiferes est
conforme à nos principes, et ces polypiers attestent effectivement
les progrès de la nature dans la composition
de l’organisation des animaux, et dans leurs produits.
Nous verrons que c’est en établissant ce nouvel ordre de
choses à l’égard du polypier que la nature amène graduellement
l’anéantissement de cette enveloppe des polypes.
Si les premiers polypiers se sont progressivement solidifiés
jusqu’à devenir tout-à-fait pierreux, ceux dont nous
allons faire mention perdent graduellement leur solidité,
deviennent à mesure plus flexibles, plus frêles, et enfin
disparaissent et s’anéantissent réellement avant la fin de la
classe.
Anciennement, je pensais, comme tous les zoologistes,
que les polypiers flexibles, non pierreux, et que l’on
connaît en général sous le nom de cératophytes , devaient
être rapprochés les uns des autres. En conséquence
, plaçant d’abord les polypiers membraneux ou
cornés des deux premières sections, je les faisais suivre
immédiatement par les polypiers, la plupart encore
flexibles , qui constituent les corticiferes et les empâtés,
et je terminais par les polypiers solides, tout-à-fail pierreux.
C’est ainsi qu’on voit ces polypiers distribués dans
ma Philosophie zoologique , vol. 1 , pag. 288.
Ayant depuis considéré plus attentivement la nature
des polypiers corticiferes, je me suis convaincu qu’ils s’éloignaient
beaucoup des polypiers vaginiformes et des
polypiers à réseau ; que même les polypiers tout-à-fait
pierreux se rapprochaient davantage de ces derniers,
malgré leur solidité et la nature de leur substance.
Bientôt, ensuite., me rappelant l’observation qui nous
apprend que la nature ne fait jamais une transition brusque
d’un objet à un autre qui: en est très-différent, j ai senti
que , ne devant pas toujours conserver le polypier , elle
avait dû le former graduellement, 1 amener à son maximum
de masse ejt de solidité, et ensuite 1 affaiblir progressivement
jusqu’au, point de le faire disparaître,
Aiusi, la nature , parvenue à la formation des polypiers
lamellifères, qui sont les plus solides et tout-à-fait pierreux
, a commence , dans les polypiers corticiferes qui
les suivent et s’y lient parfaitement, le nouvel ordre de
choses qui devait amener l’anéantissement du polypier.
On remarque ic i, en effet, quelle commence à préparer
l’anéantissement de cette enveloppe des polypes, en
l’amollissant graduellement, diminuant pour cela de plus
en plus la matière crétacée qui est si abondante dans les
polypiers pierreux , et faisant au contraire dominer progressivement
la matière purement animale ; en sorte qu’à
la fin de la section suivante [des polypiers empâtés], le
polypier tout-à-fait gélatineux finit par se confondre avec
la chair mémo du corps commun des polypes.
Si les polypiers des cinq premières sections n offrent
réellement qu’une seule sorte de substance par 1 effet du
mélange intime des particules plus ou moins diverses qui
entrent dans leur composition, tandis que les polypiers
des sixième et septième sections [les polypiers cortici-
fères et les polypiers empâtés ] présentent évidemment
deux sortes de parties bien séparées et très-distinctes , il