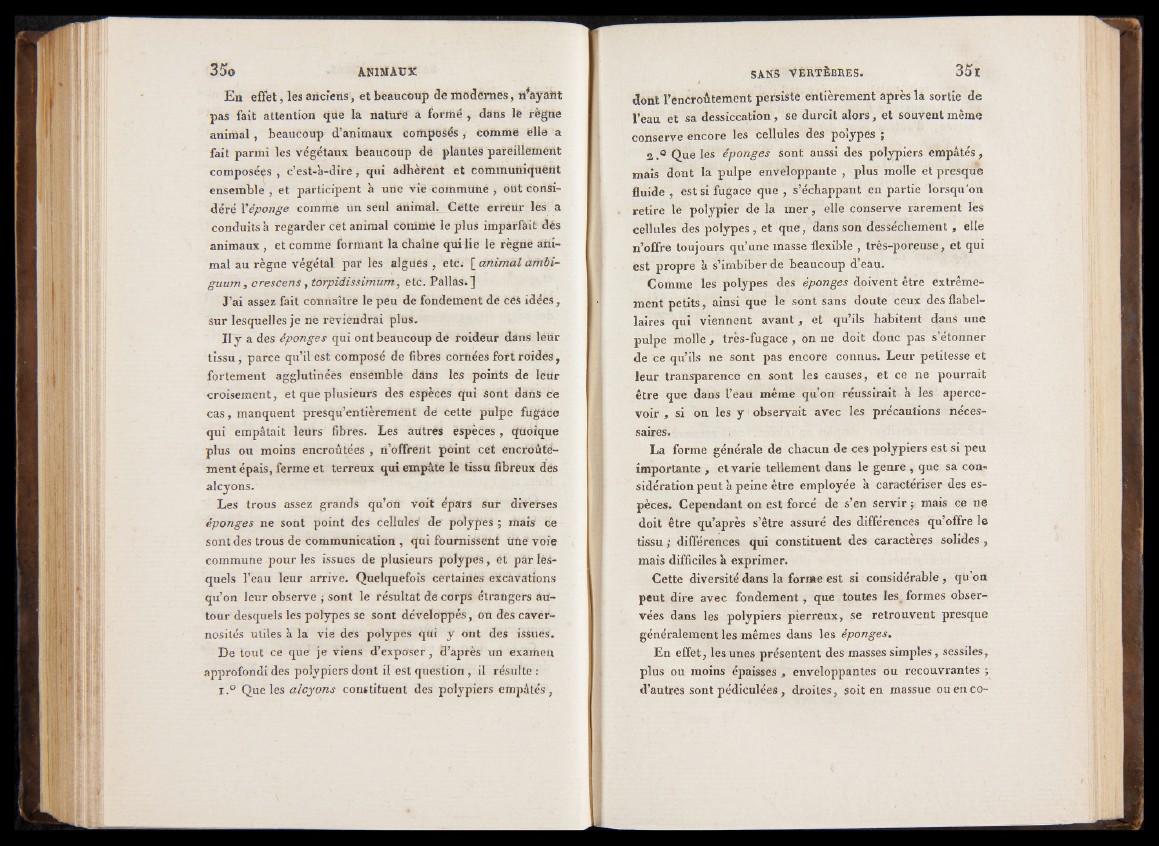
En effet, les anciens, et beaucoup de modernes, Payant
pas fait attention que la nature à formé > dans lë règne
animal , beaucoup d’animaux composés , comme elle a
fait parmi les végétaux beaucoup de plantes pareillement
composées , c’est-a-dire, qui adhèrent et communiquent
ensemble , et participent à une vië commune , ont considéré
Xéponge comme un seul animal. Cette erréür lès a
conduits à regarder cet animal comme le plus imparfait dés
animaux , et comme formant la chaîne qui lie le régne animal
au règne végétal par les algues , etc; [ animal arhbi-
guums crescens, torpidissimum, etc. Pallas.]
J’ai assez fait connaître le peu de fondement dé céS idées,
sur lesquelles je ne reviendrai plus.
Il v a des éponges qui ont beaucoup de roideur dans léür
tissu, parce qu’il est composé de fibres cornées fort roidés,
fortement agglutinées ensemble dans les points de letlr
croisement, et que plusieurs des espèces qui sont dans Ce
cas, manquent presqu’entièrement de cette pulpe fugace
qui empâtait leurs fibres. Les autres espèces, quoique
plus ou moins encroûtées , n’ofîrént point cét encroûtement
épais, ferme et terreux qui empâte le tissu fibreux dés
alcyons.
Les trous assez grands qu’on voit épars sur diverses
éponges ne sont point des cellules' de polypes ; mais ce
sont des trous de communication , qui fournissent une voie
commune pour les issues de plusieurs polypes, et par lesquels
l’eau leur arrive. Quelquefois certaines excavations
qu’on leur observe $ sont le résultat de corps étrangers autour
desquels les polypes se sont développés, ou des cavernosités
utiles à la vie des polypes qui y ont des issues.
De tout ce que je viens d’exposer, d’après un examen
approfondi des polypiers dont il est question , il résulte :
l .° Que les alcyons constituent des polypiers empâtés,
dont l’encroûtement persiste entièrement après la sortie de
l’eau et sa dessiccation, se durcit alors, et souvent même
conserve encore les cellules des polypes ;
2 Que les éponges sont aussi des polypiers empâtés,
mais dont la pulpe enveloppante , plus molle et presque
fluide , est si fugace que , s’échappant en partie lorsqu’on
retire le polypier de la mer, elle conserve rarement les
cellules des polypes , et que, dans son dessèchement, elle
n’offre toujours qu’une masse flexible , très-]îoreuse, et qui
est propre h s’imbibèr de beaucoup d’eau.
Comme les polypes des éponges doivent être extrêmement
petits, ainsi que le sont sans doute ceux des flabel-
îaires qui viennent avant, et qu’ils habitent dans une
pulpe molle , très-fugace , on ne doit donc pas s’étonner
de ce qu’ils ne sont pas encore connus. Leur petitesse et
leur transparence en sont les causes, et ce ne pourrait
être que dans l’eau même qu’on réussirait à les apercevoir
, si on les y 1 observait avec les précautions nécessaires;
La forme générale de chacun de ces polypiers est si peu
importante , et varie tellement dans le genre , que sa considération
peut à peine être employée a caractériser des espèces.
Cependant on est forcé de s’en servir y mais ce ne
doit être qu’après s’être assuré des différences qu’offre le
tissu ; différences qui constituent des caractères solides ,
mais difficiles à exprimer.
Cette diversité dans la forme est si considérable , qu on
peut dire avec fondement, que toutes feg formes observées
dans les polypiers pierreux, se retrouvent presque
généralement les mêmes dans les éponges.
En effet, les unes présentent des masses simples, sessiles,
plus ou moins épaisses , enveloppantes ou recouvrantes ;
d’autres sont pédiculées , droites, soit en massue ou en co