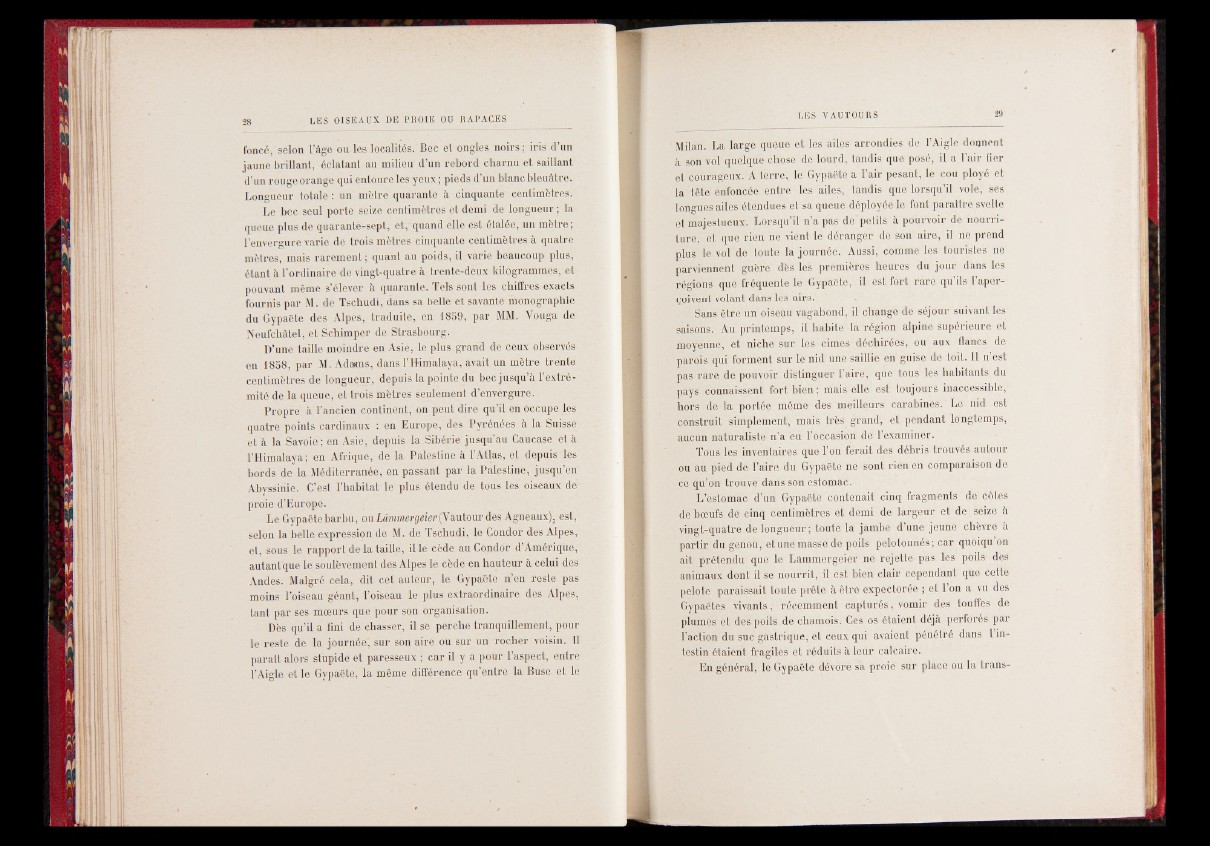
foncé, selon l’âge ou les localités. Bec et ongles noirs; iris d’un
jaune brillant, éclatant au milieu d’un rebord charnu et saillant
d’un rouge orange qui entoure les yeux ; pieds d’un blanc bleuâtre.
Longueur totale : un mètre quarante à cinquante centimètres.'
Le bec seul porte seize centimètres et demi de longueur ; la
queue plus de quarante-sept, et, quand elle est étalée, un mètre;
l’envergure varie de trois mètres cinquante centimètres à quatre
mètres, mais rarement; quant au poids, il varie beaucoup plus,
étant à l’ordinaire de vingt-quatre à trente-deux kilogrammes, et
pouvant même s’élever à quarante. Tels sont les chiffres exacts
fournis par M. de Tschudi, dans sa belle et savante monographie
du Gypaète des Alpes, traduite, en 1859, par MM. Vouga de
Neufchâtel, et Schimper de Strasbourg.
D’une taille moindre en Asie, le plus grand de ceux observés
en 1858, par M. Adams, dans Fffimalaya, avait un mètre trente
centimètres de longueur, depuis la pointe du bec jusqu’à l’extrémité
de la queue, et trois mètres seulement d’envergure.
Propre à l’ancien continent, on peut dire qu’il en Occupe les
quatre points cardinaux : en Europe, des Pyrénées à la Suisse
et à la Savoie; en Asie, depuis la Sibérie jusqu’au Caucase et à
l’Himalaya ; en Afrique, de la Palestine à l’Atlas, èt depuis les
bords de la Méditerranée, en passant par la Palestine, jusqu’en
Abyssinie. C’est l’habitat le plus étendu de tous les oiseaux de
proie d’Europe.
Le Gypaète barbu, ou Lâmmergeier (Vautour dès Agneauxjj est,
selon la belle expression de M. de Tschudi, le Condor des Alpes,
et, sous le rapport de la taille, il le cède au Condor d’Amérique,
autant que le soulèvement des Alpes le cède en hauteur à celui des
Andes. Malgré cela, dit cet auteur, le Gypaète n’en reste pas
moins l’oiseau géant, l’oiseau le plus extraordinaire des Alpes,
tant par ses moeurs que pour son organisation.
Dès qu’il a fini de chasser, il se perche tranquillement, pour
le reste de la journée, sur son aire ou sur un rocher voisin. Il
paraît alors stupide et paresseux ; car il y a pour l’aspect, entre
l’Aigle et le Gypaète, la même différence qu’entre la Buse et le
Milan. La large queue et les ailes arrondies de l’Aigle donnent
à son vol quelque chose de lourd, tandis que posé, il a l’air fier
et courageux. A terre, le Gypaète a l’air pesant, le cou ployé et
la tête enfoncée entre les ailes, tandis que lorsqu’il vole, ses
longues ailes étendues et sa queue déployée le font paraître svelte
et majestueux. Lorsqu’il n’a pas de petits à pourvoir de nourriture,
et que rien ne vient le déranger de son aire, il ne prend
plus le vol de toute la journée. Aussi, comme les touristes ne
parviennent guère dès les premières heures du jour dans les
régions que fréquente le Gypaète, il est fort rare qu ils 1 aperçoivent
volant dans les airs.
Sans être un oiseau vagabond, il change de séjour suivant les
saisons. Au printemps, il habite la région alpine supérieure et
moyenne, et niche sur les cimes déchirées, ou aux flancs de
parois qui forment sur le nid une saillie en guise de toit. Il n’est
pas rare de pouvoir distinguer Faire, que tous les habitants du
pays connaissent fort bien; mais elle est toujours inaccessible,
hors de la portée même des meilleurs carabines. Le nid est
construit simplement, mais très grand, et pendant longtemps,
aucun naturaliste n'a eu l’occasion de l’examiner.
Tous les inventaires que l’on ferait des débris trouvés autour
ou au pied de l’aire du Gypaète ne sont rien en comparaison de
ce qu’on trouve dans son estomac.
L’estomac d’un Gypaète contenait ' cinq fragments de côtes
de boeufs de cinq centimètres et demi de largeur et de seize à
vingt-quatre de longueur; toute la jambe d’une jeune chèvre à
partir du genou, et une masse de poils pelotonnés; car quoiqu’on
ait prétendu que le Lämmergeier ne rejette pas les poils des
animaux dont il se nourrit, il est bien clair cependant que cette
pelote paraissait toute prête à être expectorée ; et l’on a vu des
Gypaètes vivants, récemment capturés, vomir des touffes de
plumes et des poils de chamois. Ces os étaient déjà perforés par
l’action du suc gastrique, et ceux qui avaient pénétré dans 1 intestin
étaient fragiles et réduits à leur calcaire.
En général, le Gypaète dévore sa proie sur place ou la trans