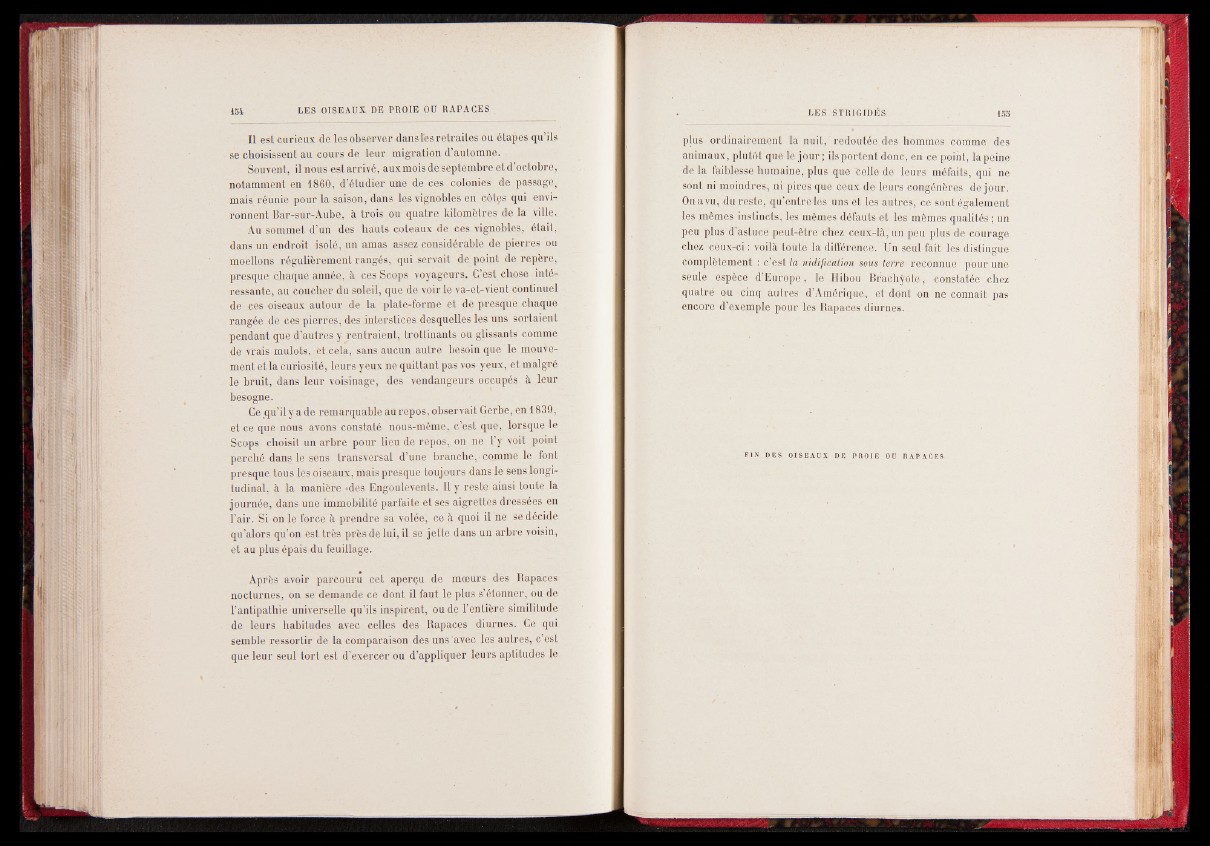
Il est curieux de les observer dans les retraites ou étapes qu’ils
se choisissent au cours de leur migration d’automne.
Souvent, il nous est arrivé, aux mois de septembre et d’octobre,
notamment en 1860, d’étudier une de ces colonies de passage,
mais réunie pour la saison, dans les vignobles en côtes qui environnent
Bar-sur-Aube, à trois ou quatre kilomètres de la ville.
Au sommet d’un des hauts coteaux de ces vignobles, était,
dans un endroit isolé, un amas assez considérable de pierres ou
moellons régulièrement rangés, qui servait de point de repère,
presque chaque année, à ces Scops voyageurs. C’est chose intéressante,
au coucher du soleil, que de voir le va-et-vient continuel
de ces oiseaux autour de la plate-forme et de presque chaque
rangée de ces pierres, des interstices desquelles les uns sortaient
pendant que d’autres y rentraient, trottinants ou glissants comme
de vrais mulots, et cela, sans aucun autre besoin que le mouvement
et la curiosité, leurs yeux ne quittant pas vos yeux, et malgré
le bruit, dans leur voisinage, des vendangeurs occupés à leur
besogne.
Ce qu’il y a de remarquable au repos, observait Gerbe, en 1839,
et ce que nous avons constaté nous-même, c’est que, lorsque le
Scops choisit un arbre pour lieu de repos, on ne l’y voit point
perché dans le sens transversal d’une branche, comme le font
presque tous les oiseaux, mais presque toujours dans le sens longitudinal.
à la manière «des Engoulevents. Il y reste ainsi toute la
journée, dans une immobilité parfaite et ses aigrettes dressées en
l’air. Si on le force à prendre sa volée, ce à quoi il ne se décide
qu’alors qu’on est très près de lui, il se jette dans un arbre voisin,
et au plus épais du feuillage.
Après avoir parcouru cet aperçu de moeurs des Rapaces
nocturnes, on se demande ce dont il faut le plus s’étonner, ou de
l’antipathie universelle qu’ils inspirent, ou de l’entière similitude
de leurs habitudes avec celles des Rapaces diurnes. Ce qui
semble ressortir de la comparaison des uns avec les autres, c’est
que leur seul tort est d’exercer ou d’appliquer leurs aptitudes le
plus ordinairement la nuit,'redoutée des hommes comme des
animaux, plutôt que le jour; ils portent donc, en ce point, la peine
de la faiblesse humaine, plus que celle de leurs méfaits, qui ne
sont ni moindres, ni pires que ceux de leurs congénères de jour.
On a vu, du reste, qu’entre les uns et les autres, ce sont également
les mêmes instincts, les mêmes défauts et les mêmes qualités ; un
peu plus d’astuce peut-être chez ceux-là, un peu plus de courage
chez ceux-ci : voilà toute la différence. Un seul fait les distingue
complètement : c’est la nidification sous terre reconnue pour une
seule espèce d’Europe, le Hibou Brachÿôte, constatée chez
quatre ou cinq autres d’Amérique, et dont on ne connaît pas
encore d’exemple pour les Rapaces diurnes.