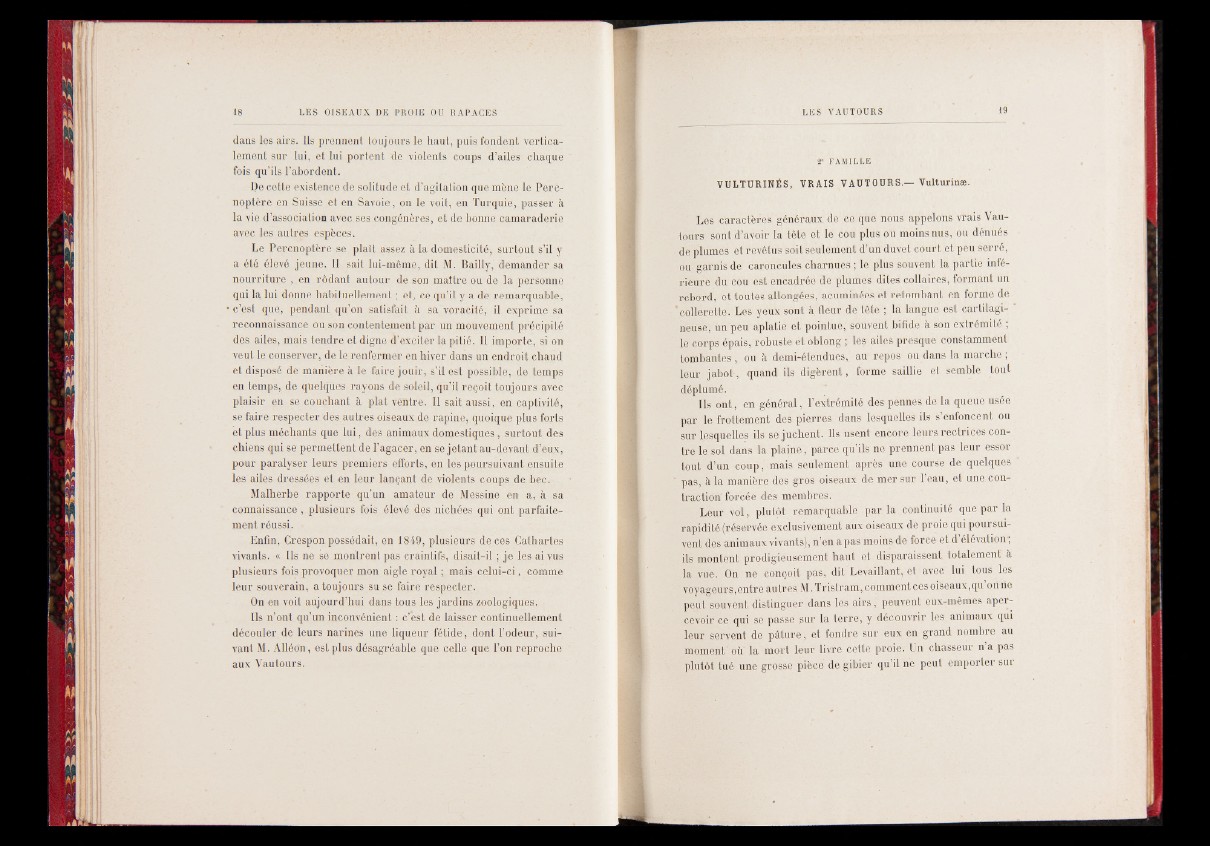
dans les airs. Ils prennent toujours le haut, puis,fondent verticalement
sur lui, et lui portent de violents coups d’ailes chaque
fois qu’ils l’abordent.
De cette existence de solitude et d’agitation que mène le Perc-
noptèrê en Suisse et en Savoie, on le voit, en Turquie, passer à
la vie d’association avec ses congénères, et de bonne camaraderie
avec les autres espèces.
Le Percnoptère se plaît assez à la domesticité, surtout s’il y
a été élevé jeune. Il sait lui-même, dit M. Bailly, demander sa
nourriture , en rôdant autour de son maître ou de la personne
qui la lui donne habituellement ; et, ce qu’il y a de remarquable,
c’est que, pendant qu’on satisfait à sa voracité, il exprime sa
reconnaissance ou son contentement par un mouvement précipité
des ailes, mais tendre et digne d’exciter la pitié. Il importe, si on
veut le conserver, de le renfermer en hiver dans un endroit chaud
et disposé de manière à le faire jouir, s’il est possible, de temps
en temps, de quelques rayons de soleil, qu’il reçoit toujours avec
plaisir en se couchant à plat ventre. Il sait aussi, en captivité,
se faire respecter des autres oiseaux de rapine, quoique plus forts
et plus méchants que lui, des animaux domestiques , surtout des
chiens qui se permettent de l’agacer, en se jetant au-devant d’eux,
pour paralyser leurs premiers efforts, en les poursuivant ensuite
les ailes dressées et en leur lançant de violents coups de bec.
Malherbe rapporte qu’un amateur de Messine en a, à sa
connaissance, plusieurs fois élevé des nichées qui ont parfaitement
réussi.
Enfin, Crespon possédait, en 1849, plusieurs de ces Cathartes
vivants. « Ils ne se montrent pas craintifs, disait-il ; je les ai vus
plusieurs fois provoquer mon aigle royal ; mais celui-ci . comme
leur souverain, a toujours su se faire respecter.
On en voit aujourd’hui dans tous les jardins zoologiques.
Ils n’ont qu’un inconvénient : c’*est de laisser continuellement
découler de leurs narines une liqueur fétide, dont l’odeur, suivant
M. Alléon, est plus désagréable que celle que l’on reproche
aux Vautours.
2’ FAMILLE
VULTURINËS, VRAIS VAUTOURS.— V u ltu rinæ.
' Les caractères généraux de ce que nous appelons vrais Vautours
sont d’avoir la tête et le cou plus ou moins nus, ou dénués
de plumes et revêtus soit seulement d’un duvet court et peu serré,
ou garnis de caroncules charnues ; le plus souvent la partie inférieure
du cou est encadrée de plumes dites collaires, formant un
rebord, et toutes allongées, acuminées et retombant en forme de
’collerette. Les yeux sont à fleur de tête ; la langue est cartilagi- '
neuse, un peu aplatie et pointue, souvent bifide à son extrémité ;
le corps épais, robuste et oblong ; les ailes presque constamment
tombantes , ou à demi-étendues^ au repos ou dans la marche ,
leur jabot-, quand ils digèrent, forme saillie et semble tout
déplumé.
Ils ont, en général, l’extrémité des pennes de la queue usée
par le frottement des pierres dans lesquelles ils s’enfoncent ou
sur lesquelles ils se juchent. Ils usent encore leurs rectrices contre
le sol dans la. plaine , parce qu’ils ne prennent pas leur essor
tout d’un coup, mais seulement après une course de quelques
pas, à la manière des gros oiseaux de mer sur 1 eau, et une contraction'
forcée des membres.
Leur vol, plutôt remarquable par la continuité que par la
rapidité (réservée exclusivement aux oiseaux de proie qui poursuivent
des animaux vivants), n’en apas moins de force et d élévation,
ils montent prodigieusement haut et disparaissent totalement à
la vue. On ne conçoit pas, dit Levaillant, et avec lui tous les
voyageurs,entre autres M. Tristram, comment ces oiseaux,qu’on ne
peut souvent distinguer dans les airs, peuvent eux-mêmes apercevoir
ce qui se passe sur la terre, y découvrir les animaux qui
leur servent de pâture, et fondre sur eux en grand nombre au
moment où la mort leur livre cette proie. Un chasseur n a pas
plutôt tué une grosse pièce de gibier qu’il ne peut emporter sui