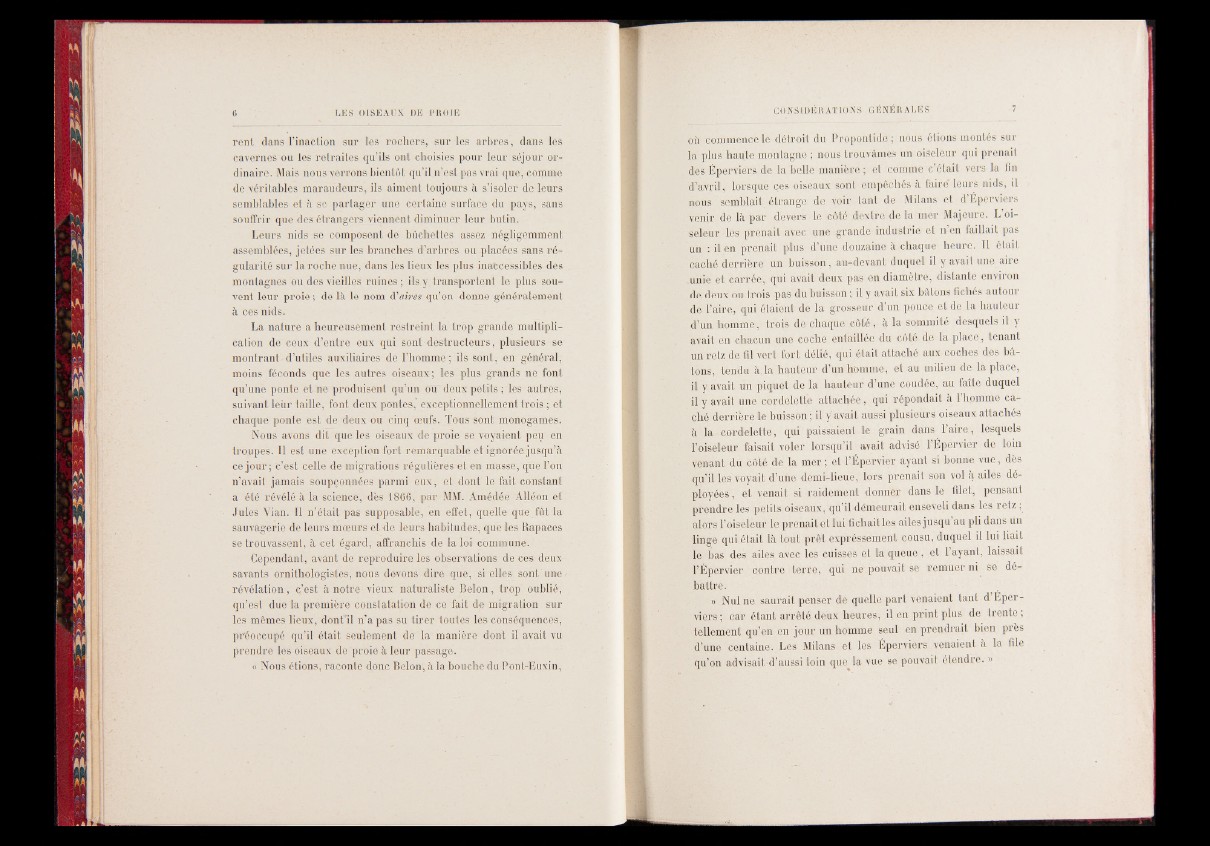
rent dans l’inaction sur les rochers, sur les arbres, dans lès
cavernes ou les retraites qu’ils ont choisies pour leur séjour ordinaire.
Mais nous verrons bientôt qu’il n’est pas vrai que, comme
de véritables maraudeurs, ils aiment toujours à s’isoler de leurs
semblables et à sc partager une certaine surface du pays, sans
souffrir que des étrangers viennent diminuer leur butin.
Leurs nids se composent de bûchettes assez négligemment
assemblées, jetées sur les branches d’arbres ou placées sans régularité
sur la roche nue, dans les lieux les plus inatcessibles des
montagnes ou des vieilles ruines ; ils y transportent le plus souvent
leur proie; de là le nom A'aires qu’on donne généralement
à ces nids.
La nature a heureusement restreint la trop grande multiplication
de ceux d’entre eux qui sont destructeurs, plusieurs se
montrant d’utiles auxiliaires de l’homme ; ils sont, en général,
moins féconds que les autres oiseaux; les plus grands ne font
qu’une ponte et ne produisent qu’un ou deux petits ; les autres,
suivant leùr taille, font deux pontes,* exceptionnellement trois ; et
chaque ponte est de deux ou cinq oeufs. Tous sont monogames.
Nous avons dit que les oiseaux de proie se voyaient peu en
troupes. Il est une exception fort remarquable et ignorée jusqu’à
ce jour ; c’est celle de migrations régulières et en masse, que l’on
n’avait jamais soupçonnées parmi eux, et dont le fait constant
a été révélé à la science, dès 1866, par MM. Amédée Alléon et
Jules Vian. Il n’était pas supposable, en effet, quelle que fût la
sauvagerie de leurs moeurs et de leurs habitudes, que les Rapaces
se trouvassent, à cet égard, affranchis de la loi commune.
Cependant, avant de reproduire les observations de ces deux
savants ornithologistes, nous devons dire que, si elles sont une
révélation, c’est à notre vieux naturaliste Belon, trop oublié,
qu’est due la première constatation de ce fait de migration sur
les mêmes lieux, dont'il n’a pas su tirer toutes les conséquences,
préoccupé qu’il était seulement de la manière dont il avait vu
prendre les oiseaux de proie à leur passage.
« Nous étions, raconte donc Belon, à la bouche du Pont-Euxin,
où commence le détroit du Propontide ; nous étions montés sur
la plus haute montagne ; nous trouvâmes un oiseleur qui prenait
des Éperviers de la belle manière ; et comme c’était vers la fin
d’avril, lorsque çes oiseaux sont empêchés à faire" leurs nids, il
nous semblait étrange de voir tant de Milans et d’Éperviers
venir de là par devers le côté dextre de la mer Majeure. L’oiseleur
les prenait avec une grande industrie et n’en faillait pas
un : il en prenait plus d’une douzaine à chaque heure. Il était
caché derrière un buisson, au-devant duquel il y avait une aire
unie et carrée, qui avait deux pas en diamètre, distante environ
de deux ou trois pas du buisson ; il y avait six bâtons fichés autour
de l’aire, qui étaient de la grosseur d’un pouce et de.la hauteur
d’un homme, trois de chaque côté, à la sommité desquels il y
avait en chacun une coche entaillée du côté de la place, tenant
un retz de fil vert fort délié, qui était attaché aux coches des bâtons,
tendu à.la hauteur d’un homme, et au milieu de la place,
il y avait un piquet de la hauteur d’une coudée, au faîte duquel
il y avait une cordelette attachée, qui répondait à 1 homme caché
derrière le buisson ; il y avait aussi plusieurs oiseaux attachés
à la- cordelette, qui paissaient le grain dans l’aire , lesquels
l’oiseleur faisait voler lorsqu’il avait advisé 1 Épervier de loin
venant du côté de la mer; et l’Épervier ayant si bonne vue, dès
qu’il les voyait d’uûe demi-lieue, lors prenait son vol à ailes déployées,
et venait si raidement donner dans le fdet, pensant
prendre les petits oiseaux, qu’il démeurait enseveli dans les retz;
alors l’oiseleur le prenait et lui fichaitles ailes jusqu’au pli dans un
linge qui était là tout prêt expréssement cousu, duquel il lui liait
le bas des ailes avec les cuisses et la queue, et l’ayant, laissait
l’Épervier contre terre, qui ne pouvait sfe remuer ni se débattre.
■
» Nul ne saurait penser de quelle part venaient tant d’Éperviers;
car étant arrêté deux heures, il en print plus de trente;
tellement qu’en en jour un homme seul en prendrait bien près
d’une centaine. Les Milans et les Éperviers venaient à la fde
qu’on advisait d’aussi loin que^la vue se pouvait étendre. »