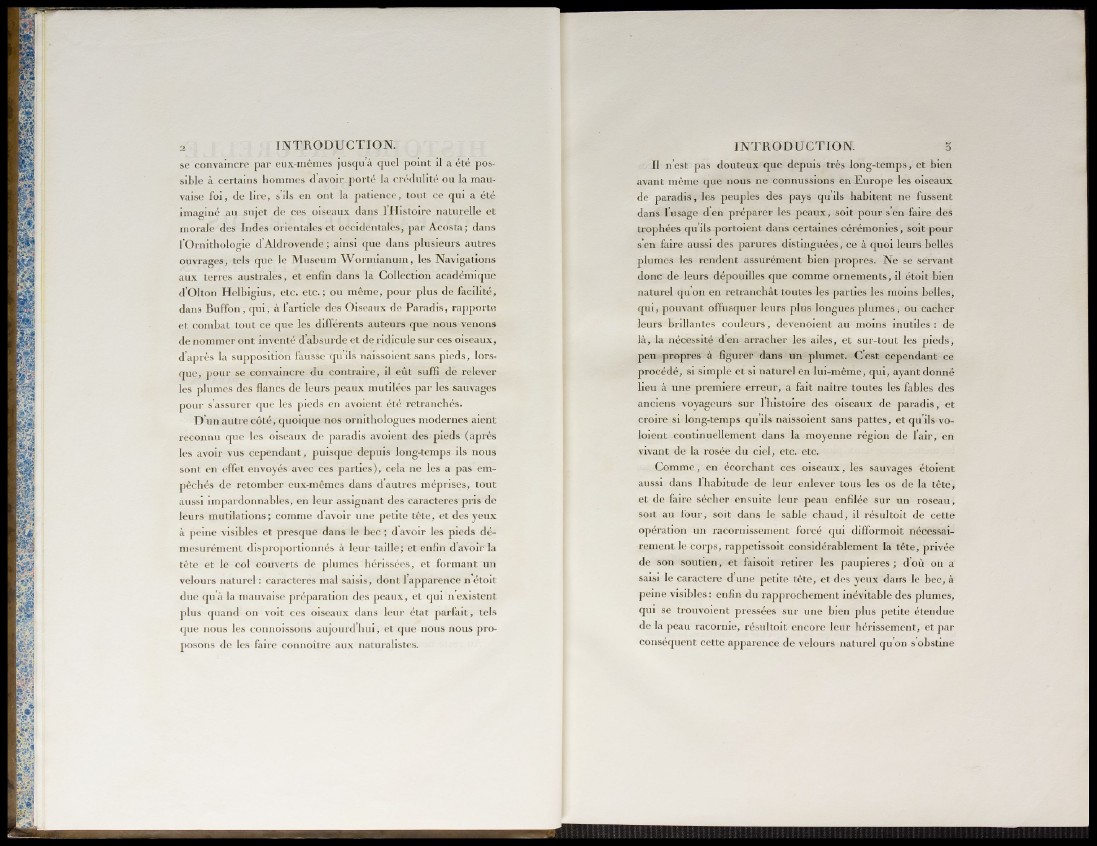
se convaincre par eux-mêmes jusqu à quel point il a été possible
à certains hommes d'avoir porté la crédulité ou la mauvaise
Toi, de lire, s'ils en ont la patience, tout ce qui a été
imaginé au sujet de ces oiseaux dans 1 Histoire naturelle et
morale des Indes orientales et occidentales, par Acosta; dans
l'Ornithologie d Aldrovende; ainsi que dans plusieurs autres
ouvrages, tels que le Muséum Wormianum, les Navigations
aux terres australes, et enfin dans la Collection académique
d'Olton Helbigius, etc. etc.; ou même, pour plus de facilité,
dans Buffon, qui, a l'article des Oiseaux de Paradis, rapporte
et combat tout ce que les différents auteurs que nous venons
de nommer ont inventé d'absurde et de ridicule sur ces oiseaux,
d'après la supposition fausse qn ils naissoient sans pieds, lorsque;,
pour se convaincre du contraire, il eût suffi de relever
les plumes des flancs de leurs peaux mutilées par les sauvages
pour s'assurer que les pieds en avoient. été retranchés.
D'un autre côté, quoique nos ornithologues modernes aient
reconnu que les oiseaux, de paradis avoient des pieds (après
les avoir vus cependant, puisque depuis long-temps ils nous
sont en effet envoyés avec ces parties), cela ne les a pas empêchés
de retomber eux-mêmes dans d autres méprises, tout
aussi impardonnables, en leur assignant des caractères pris de
leurs mutilations; comme d avoir une pelile tête, et des yeux
à peine visibles et presque dans le bec ; d avoir les pieds démesurément
disproportionnés à leur taille; et enfin d avoir la
tète et le col couverts de plumes hérissées, et formant un
velours naturel : caractères mal saisis, dont 1 apparence n étoit
due qu'à la mauvaise préparation des peaux, et qui 11 existent
plus quand on voit ces oiseaux dans leur état parfait, tels
que nous les connoissons aujourd hui, et que nous nous proposons
de les faire connoitre aux naturalistes.
Il n'est pas douteux que depuis très long-temps, et bien
avant même que nous ne connussions en Europe les oiseaux
de paradis, les peuples des pays qu ils habitent ne fussent
dans l'usage den préparer les peaux, soit pour s'en faire des
trophées qu'ils portoient dans certaines cérémonies, soit pour
s'en faire aussi des parures distinguées, ce à quoi leurs belles
plumes les rendent assurément bien propres. Ne se servant
donc de leurs dépouilles que comme ornements, il étoit bien
naturel quon en retranchât toutes les parties les moins belles,
qui, pouvant offusquer leurs plus longues plumes, ou cacher
leurs brillantes couleurs, devenoient au moins inutiles: de
là, la nécessité den arracher les ailes, et sur-tout les pieds,
peu propres à figurer dans un plumet. C est cependant ce
procédé, si simple et si naturel en lui-même, qui, ayant donné
heu à une premiere erreur, a fait naître toutes les fables des
anciens voyageurs sur 1 histoire des oiseaux de paradis, et
croire si long-temps qu'ils riaissoient sans pattes, et qu'ils votaient
continuellement dans la moyenne région de l'air, en
vivant de la rosée du ciel, etc. etc.
Comme, en écorchant ces oiseaux, les sauvages étoient
aussi dans l'habitude de leur enlever tous les os de la tête,
et de faire sécher ensuite leur peau enfilée sur un roseau,
soit au iour, soit dans le sable chaud, il résultait de cette
opération un racornissement forcé qui difformoit nécessairement
le corps, rappetissoit considérablement la tête, privée
de son soutien, et faisoit retirer les paupières; d'où on a
saisi le caractère d une petite tête, et des yeux dans le bec, à
peine visibles : enfin du rapprochement inévitable des plumes,
qui se trouvoient pressées sur une bien plus petite étendue
de la peau racornie, résultait encore leur hérissement, et par
conséquent cette apparence de velours naturel qu'on s obstine