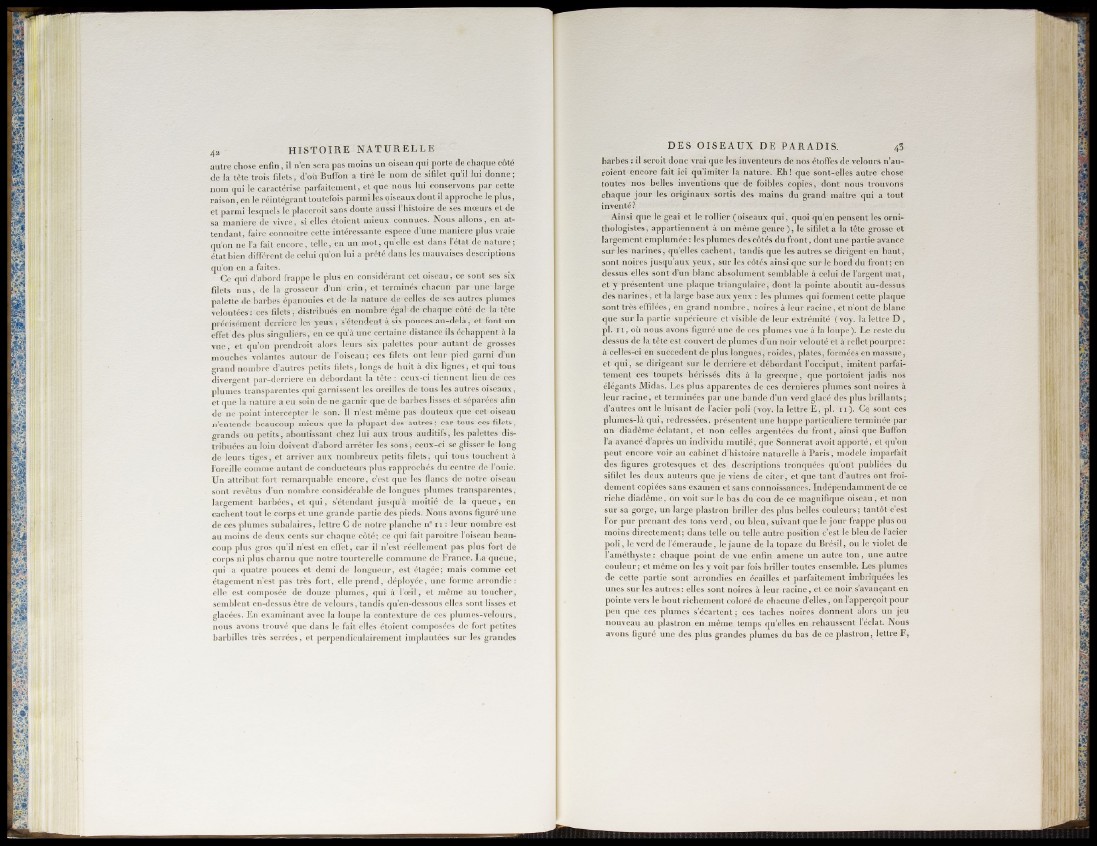
4 2 HISTOIRE NATURELLE
autre ebose enfin, il n'en sera pas moins un oiseau qui porte tle chaque côté
de la tête trois filets, d'où Buffon a tiré le nom de sifilet qu'il lui donne;
nom qui le caractérise parfaitement, et que nous lui conservons par cette
raison, en le réintégrant toutefois parmi les oiseaux dont il approche le plus,
et parmi lesquels le placeroit sans doute aussi l'histoire de ses moeurs et de
sa maniéré de vivre, si elles étoient mieux connues. Nous allons, en attendant,
faire connoître cette intéressante espece d'une maniéré plus vraie
qu'on ne l'a fait encore, telle, en un mot, qu'elle est dans l'état de nature;
état bien différent de celui qu'on lui a prêté dans les mauvaises descriptions
qu'on en a faites.
Ce qui d'abord frappe le plus en considérant cet oiseau, ce sont ses six
filets nus, de la grosseur d'un crin, et terminés chacun par une large
palette de barbes épanouies et de la nature de celles de ses autres plumes
veloutées: ces filets, distribués en nombre égal de chaque côté de la tête
précisément derriere les yeux , s'étendent à six pouces au-delà, et font un
effet des plus singuliers, en ce qu'à une certaine distance ils échappent à la
vue, et qu'on prendroit alors leurs six palettes pour autant de grosses
mouches volantes autour de l'oiseau; ces filets ont leur pied garni d'un
grand nombre d'autres petits filets, longs de huit à dix lignes, et qui tous
divergent par-derriere en débordant la tète : ceux-ci tiennent lieu de ces
plumes transparentes qui garnissent les oreilles de tous les autres oiseaux,
et que la nature a eu soin de ne garnir que de barbes lisses et séparées afin
de ne point intercepter le son. Il n'est même pas douteux que cet oiseau
n'entende beaucoup mieux que la plupart des autres; car tous ces filets,
grands ou petits, aboutissant chez lui aux trous auditifs, les palettes distribuées
au loin doivent d'abord arrêter les sons, ceux-ci se glisser le long
de leurs tiges, et arriver aux nombreux petits filets, qui tous touchent à
l'oreille comme autant de conducteurs plus rapprochés du centre de l'ouie.
Un attribut fort remarquable encore, c'est que les flancs de notre oiseau
sont revêtus d'un nombre considérable de longues plumes transparentes,
largement barbées, et qui, s'étendant jusqu'à moitié de la queue, en
cachent tout le corps et une grande partie des pieds. Nous avons figuré une
de ces plumes subalaires, lettre C de notre planche n° 11 : leur nombre est
au moins de deux cents sur chaque côté; ce qui fait paroître l'oiseau beaucoup
plus gros qu'il n'est en effet, car il n'est réellement pas plus fort de
corps ni plus charnu que notre tourterelle commune de France. La queue,
qui a quatre pouces et demi de longueur, est étagée; mais comme cet
étagement n'est pas très fort, elle prend, déployée, une forme arrondie:
elle est composée de douze plumes, qui à l'oeil, et même au toucher,
semblent en-dessus être de velours, tandis qu'en-dessous elles sont lisses et
glacées. En examinant avec la loupe la contexture de ces plumes-velours,
nous avons trouvé que dans le fait elles étoient composées de fort petites
barbilles très serrées, et perpendiculairement implantées sur les grandes
DES OISEAUX DE PARADIS. 43
barbes : il seroit donc vrai que les inventeurs de nos étoffes de velours n'auroient
encore fait ici qu'imiter la nature. Eh ! que sont-elles autre chose
toutes nos belles inventions que de foibles copies, dont nous trouvons
chaque jour les originaux sortis des mains du grand maître qui a tout
inventé?
Ainsi que le geai et le rollier (oiseaux qui, quoi qu'en pensent les ornithologistes,
appartiennent à un même genre), le sifilet a la tête grosse et
largement emplumée : les plumes des côtés du front, dont une partie avance
sur les narines, qu'elles cachent, tandis que les autres se dirigent en haut,
sont noires jusqu'aux yeux, sur les côtés ainsi que sur le bord du front; en
dessus elles sont d'un blanc absolument semblable à celui de l'argent mat,
et y présentent une plaque triangulaire, dont la pointe aboutit au-dessus
des narines, et la large base aux yeux : les plumes qui forment celle plaque
sont très effilées, en grand nombre, noires à leur racine, et n'ont de blanc
que sur la partie supérieure et visible de leur extrémité (voy. la lettre D ,
pl. 11, où nous avons figuré une de ces plumes vue à la loupe). Le reste du
dessus de la tète est couvert de plumes d'un noir velouté et à reflet pourpre:
à celles-ci en succedenl de plus longues, roides, plates, formées en massue,
et qui, se dirigeant sur le derriere et débordant l'occiput, imitent parfaitement
ces toupets hérissés dits à la grecque, que portoient jadis nos
élégants Midas. Les plus apparentes de ces dernieres plumes sont noires à
leur racine, et terminées par une bande d'un verd glacé des plus brillants;
d'autres ont le luisant de l'acier poli (voy. la lettre E, pl. 11). Ce sont ces
plumes-là qui, redressées, présentent une huppe particulière terminée par
un diadème éclatant, et non celles argentées du front, ainsi que Buffon
l'a avancé d'après un individu mutilé, que Sonnerat avoit apporté, et qu'on
peut encore voir au cabinet d'histoire naturelle à Paris, modelé imparfait
des figures grotesques et des descriptions tronquées qu'ont publiées du
sifilet les deux auteurs que je viens de citer, et que tant d'autres ont froidement
copiées sans examen et sans connoissanees. Indépendamment de ce
riche diadème, on voit sur le bas du cou de ce magnifique oiseau, et non
sur sa gorge, un large plastron briller des plus belles couleurs; tantôt c'est
l'or pur prenant des tons verd , ou bleu, suivant que le jour frappe plus ou
moins directement: dans telle ou telle autre position c'est le bleu de l'acier
poli, le verd de l'émeraude, le jaune de la topaze du Brésil, ou le violet de
l'améthyste : chaque point de vue enfin amene un autre ton, une autre
couleur; et même on les y voit par fois briller toutes ensemble. Les plumes
de cette partie sont arrondies en écailles et parfaitement imbriquées les
unes sur les autres: elles sont noires à leur racine, et ce noir s'avançant en
pointe vers le bout richement coloré de chacune d'elles, on l'apperçoit pour
peu que ces plumes s'écartent; ces taches noires donnent alors un jeu
nouveau au plastron en même temps qu'elles en rehaussent l'éclat. Nous
avons figuré une des plus grandes plumes du bas de ce plastron, lettre F,