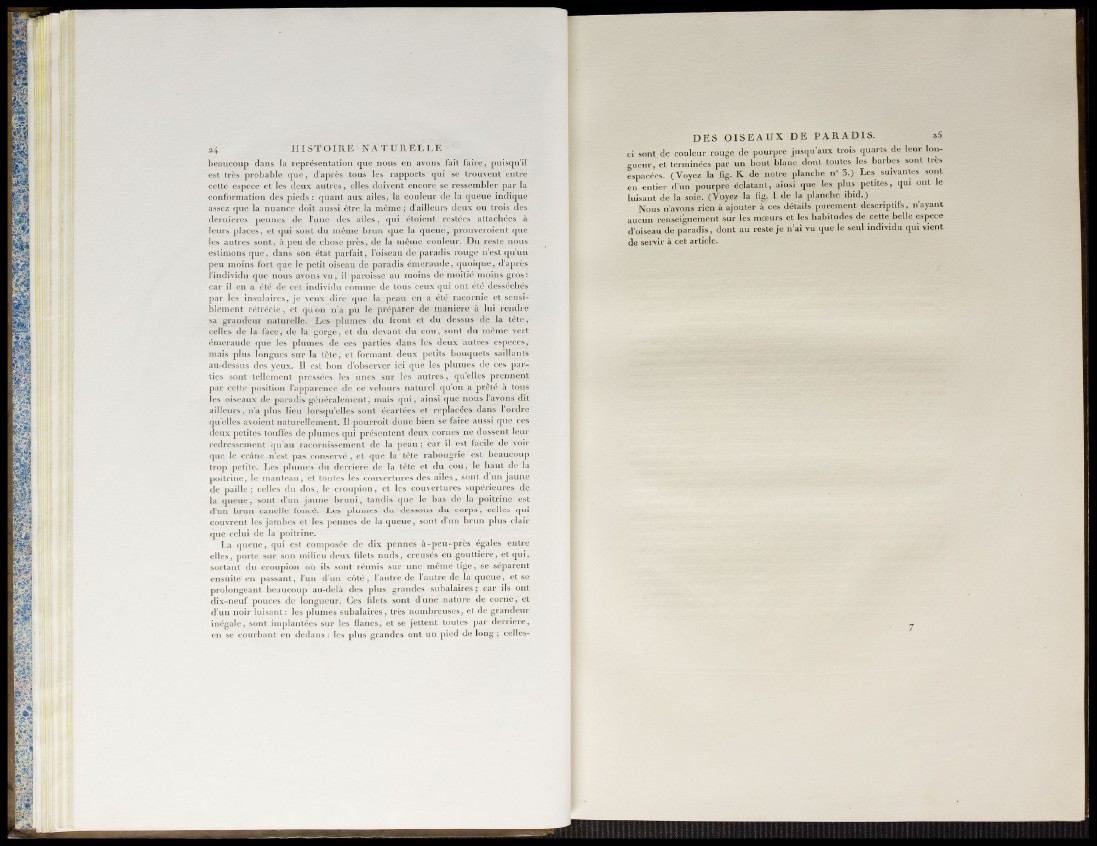
beaucoup dans la représentation que nous en avons fait faire, puisqu'il
est très probable que, d'après tous les rapports qui se trouvent entre
cette espece et les deux autres, elles doivent encore se ressembler par la
conformation des pieds : quant aux ailes, la couleur de la queue indique
assez que la nuance doit aussi être la même ; d'ailleurs deux ou trois des
dernieres pennes de l'une des ailes, qui étoient restées attachées à
leurs places, et qui sont du même brun que la queue, prouveraient que
les autres sont, à peu de chose près, de la même couleur. Du reste nous
estimons que, dans son état parfait, l'oiseau de paradis rouge n'est qu'un
peu moins fort que le petit oiseau de paradis émeraude, quoique, d'après
l'individu que nous avons vu, il paroisse au moins de moitié moins gros:
car il en a été de cet individu comme de tous ceux qui ont été desséchés
par les insulaires, je veux dire que la peau en a été racornie et sensiblement
rétrécie, et qu'on n'a pu le préparer de maniéré à lui rendre
sa grandeur naturelle. Les plumes du front et du dessus de la tête,
celles de la face, de la gorge, et du devant du cou, sont du même vert
émeraude que les plumes de ces parties dans les deux autres especes,
mais plus longues sur la tête, et formant deux petits bouquets saillants
au-dessus des yeux. II est bon d'observer ici que les plumes de ces parties
sont tellement pressées les unes sur les autres, qu'elles prennent
par cette position l'apparence de ce velours naturel qu'on a prêté à tous
les oiseaux de paradis généralement, mais qui, ainsi que nous l'avons dit
ailleurs, n'a plus lieu lorsqu'elles sont écartées et replacées dans l'ordre
qu'elles avoient naturellement. Il pourrait donc bien se faire aussi que ces
deux petites touffes de plumes qui présentent deux cornes ne dussent leur
redressement qu'au racornissement de la peau ; car il est facile de voir
que le crâne n'est pas conservé, et que la tète rabougrie est beaucoup
trop petite. Les plumes du derriere de la tete et du cou, le haut de la
poitrine, le manteau, et toutes les couvertures des ailes, sont d'un jaune
de paille; celles du dos, le croupion, et les couvertures supérieures de
la queue, sont d'un jaune bruni, tandis que le bas de la poitrine est
d'un brun canelle foncée Les plumes du dessous du corps, celles qui
couvrent les jambes et les pennes de la queue, sont d'un brun plus clair
que celui de la poitrine.
La queue, qui est composée de dix pennes à-peu-près égales entre
elles, porte sur son milieu deux filets nuds, creusés en gouttiere, et qui.
sortant du croupion où ils sont réunis sur une même tige, se séparent
ensuite en passant, l'un d'un côté, l'autre de l'autre de la queue, et se
prolongeant beaucoup au-delà des plus grandes subalaires ; car ils ont
dix-neuf pouces de longueur. Ces filets sont d'une nature de corne, et
d'un noir luisant : les plumes subalaires, très nombreuses, et de grandeur
inégale, sont implantées sur les flancs, et se jettent toutes par derriere,
en se courbant en dedans : les plus grandes ont un pied de long ; celles-
DES O I S E A U X DE P A R A D I S.
ci sont de couleur rouge de pourpre jusqu'aux trois quarts de leur longueur,
et terminées par un bout blanc dont toutes les barbes sont très
espacées. (Voyez la fig. K de notre planche n° 3.) Les suivantes sont
en entier d'un pourpre éclatant, ainsi que les plus petites, qui ont le
luisant de la soie. (Voyez la fig. I de la planche ibid.)
Nous n'avons rien à ajouter à ces détails purement descriptifs, n'ayant
aucun renseignement sur les moeurs et les habitudes de cette belle espece
d'oiseau de paradis, dont au reste je n'ai vu que le seul individu qui vient
de servir à cet article.
7