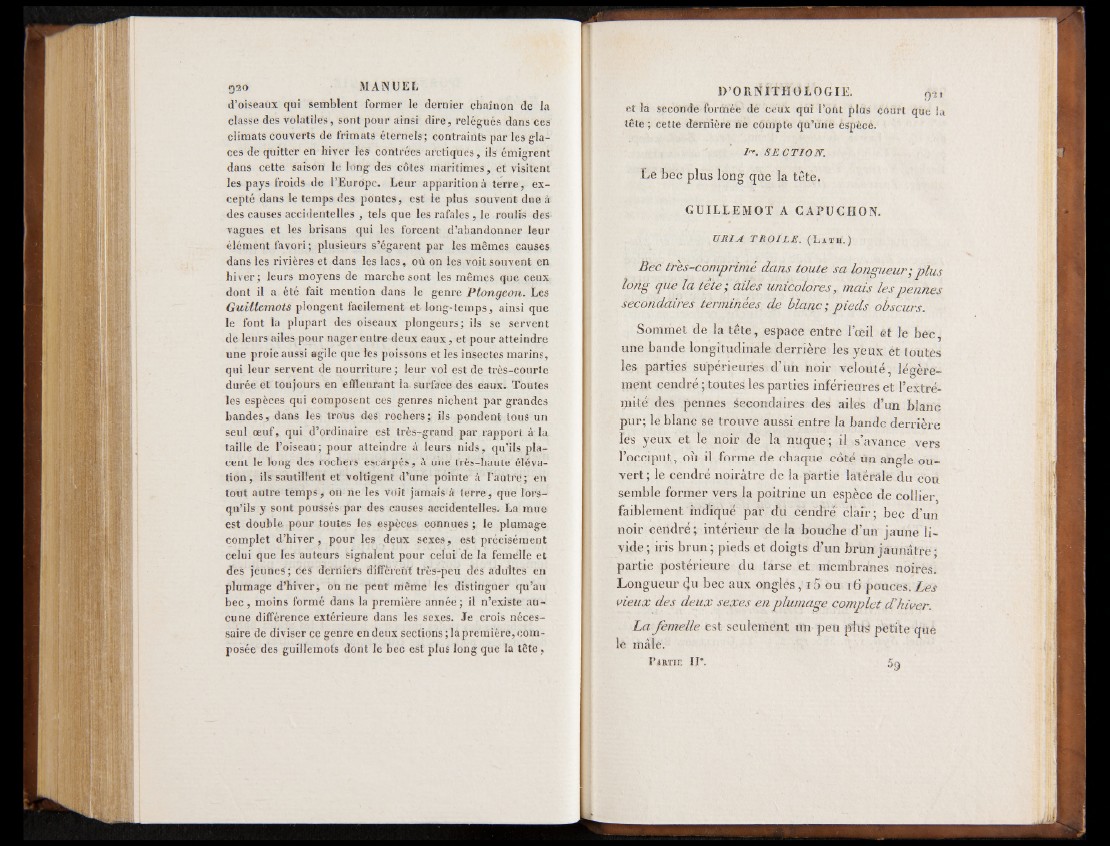
d’oiseaux qui semblent former le dernier chaînon de la
classe des volatiles, sont pour ainsi dire, relégués dans ces
climats couverts de frimats éternels; contraints par les glaces
de quitter en hiver les contrées arctiques, ils émigrent
dans cette saison le long des côtes maritimes, et visitent
les pays froids de l’Europe. Leur apparition à terre, excepté
dans le temps des pontes, est le plus souvent due à
des causes accidentelles , tels que les rafales, le roulis des
vagues et les brisans qui les forcent d’abandonner leur
élément favori; plusieurs s’égarent par les mêmes causes
dans les rivières et dans les lacs, où on les voit souvent en
hiver; leurs moyens de marche sont les mêmes que ceux
dont il a été fait mention dans le genre Plongeon. Les
Guiilemots plongent facilement et long-temps, ainsi que
le font la plupart des oiseaux plongeurs; ils se servent
de leurs ailes pour nager entre deux eaux, et pour atteindre
une proie aussi agile que les poissons et les insectes marins,
qui leur servent de nourriture; leur vol est de très-courte
durée et toujours en effleurant la surface des eaux. Toutes
les espèces qui composent ces genres nichent par grandes
bandes, dans les trous des rochers; ils pondent tous un
seul oeuf, qui d’ordinaire est très-grand par rapport à la
taille de l’oiseau; pour atteindre à leurs nids, qu’ils.placent
le long des rochers escarpés, à une très-haute élévation,
ils sautillent et voltigent d’une pointe à l’antre; en
tout autre temps, on ne les Voit jamais à terre, que lorsqu’ils
y sont poussés par des causes accidentelles. La mue
est double pour toutes les espèces connues ; le plumage
complet d’hiver, pour les deux sexes, est précisément
celui que les auteurs signalent pour celui de la femelle et
des jeunes ; ces derniers diffèrent très-peu des adultes en
plumage d’hiver, on ne peut même les distinguer qu’au
bec, moins formé dans la première année; il n’existe aucune
différence extérieure dans les sexes. Je crois nécessaire
de diviser ce genre en deux sections; la première, composée
des guiilemots dont le bec est plus long que la tête,
D’ORNITHOLOGIE. p*,
et la seconde formée de ceux qui l’oùt plus court que la
tête ; cette dernière ne compte qu’une espèce.
S E C T ION .
Le bec plus long que la tête.
GUILLEMOT A CAPUCHON.
V R IA T ROI LE . (Lath.)
Bée très-comprimé dans toute sa longueur ; plus
long que là tete ^ àdes unicolores, mais les pennes
secondaires terminées de blanc ; pieds obscurs.
Sommet de la tête, espace entre l’oeil et le bec,
une bande longitudinale derrière les yeux ét toutes
les parties supérieures d’un noir velouté, légèrement
cendré ; toutes les parties inférieures et l’extré-
ipité des pennes Secondaires des ailes d’un blanc
pur; le blanc se trouve aussi entre la bande derrière
les yeux et le noir de la nuque; il s’avance vers
l’occiput, où il forme de chaque côté un angle ouvert;
le cendré noirâtre de la partie latérale du cou
semble former vers la poitrine un espèce de collier
faiblement indique par du cendré clair; bec d’un
noir cendré; intérieur de la bouche d’un jaune livide
; iris brun ; pieds et doigts d’un brun jaunâtre *
partie postérieure du tarse et membranes noires.
Longueur cju bec aux ongles, 15 ou 16 pouces. Les
vieux des deux sexes en plumage complet d'hiver.
La femelle est seulement un peu plus petite que
le mâle.
P artie II*. 5q