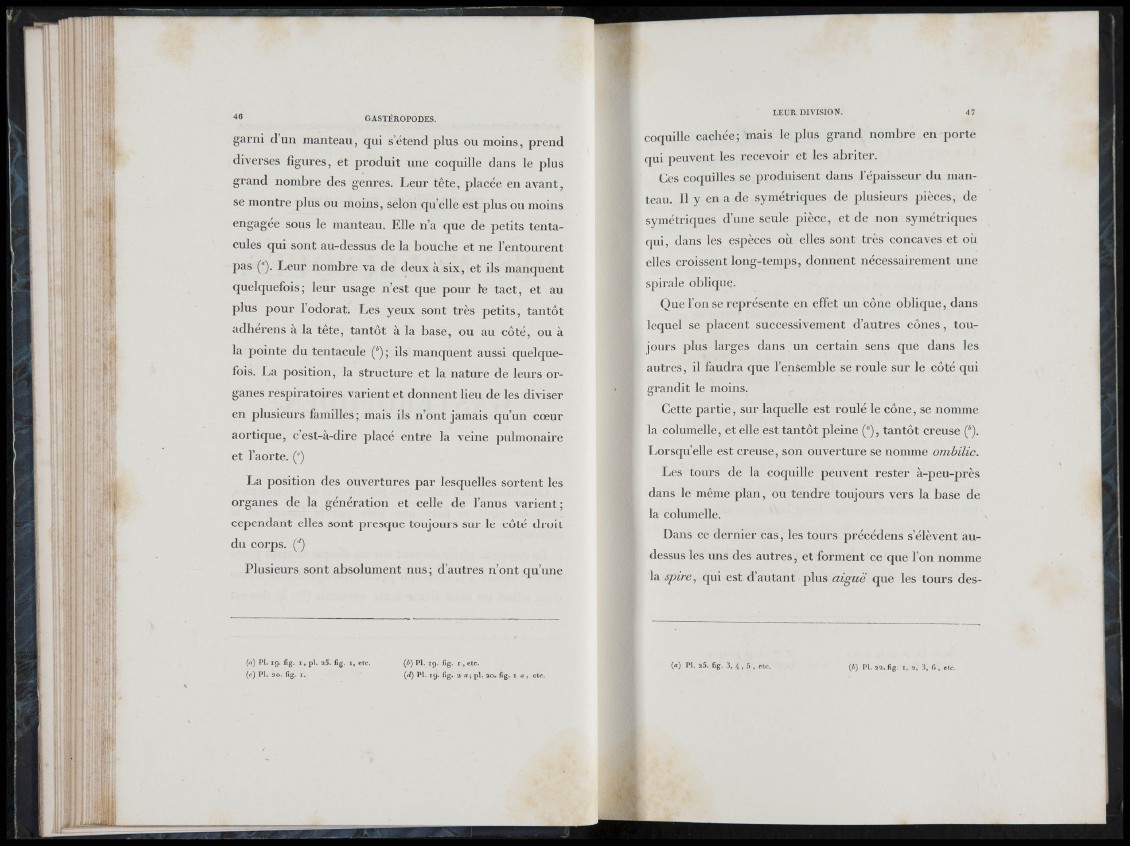
i; !i
•l® GA S T É R O P O D E S .
garni d un manteau, qui s'étend plus ou moins, prend
diverses figures, et produit une coquille dans le plus
grand nombre des genres. Leur tête, placée en avant,
se montre plus ou moins, selon qu'elle est plus ou moins
engagée sous le manteau. Elle n'a que de petits tentacules
qui sont au-dessus de la bouche et ne l'entourent
pas Leur nombre va de deux à six, et ils manquent
quelquefois; leur usage n'est que pour te tact, et au
plus pour l'odorat. Les yeux sont très petits, tantôt
adherens à la tête, tantôt à la base, ou au côté, ou à
la pointe du tentacule (') ; ils manquent aussi quelquefois.
La position, la structure et la nature de leurs organes
respiratoires varient et donnent lieu de les diviser
en plusieurs familles; mais ils n'ont jamais qu'un coeur
aortique, c'est-à-dire placé entre la veine pulmonaire
et l'aorte. (')
La position des ouvertures par lesquelles sortent les
organes de la génération et celle de l'anus varient;
cependant elles sont presque toujours sur le côté droit
du corps. ('')
Plusieurs sont absolument nus; d'autres n'ont qu'une
LEUR DIVISION.
I coquille cachée; mais le plus grand nombre en porte
I qui peuvent les recevoir et les abriter.
i Ces coquilles se produisent dans l'épaisseur du manvl
teau. Il y en a de symétriques de jjlusieurs pièces, de
^ symétriques d'une seule pièce, et de non symétriques
I qui, dans les espèces où elles sont très concaves et où
i elles croissent long-temps, donnent nécessairement une
spirale oblique.
Que l'on se représente en effet un cône oblique, dans
lequel se placent successivement d'autres cônes, toujours
plus larges dans un certain sens que dans les
autres, il faudra que l'ensemble se roule sur le côté qui
grandit le moins.
Cette partie, sur laquelle est roulé le cône, se nomme
la columelle, et elle est tantôt pleine (°), tantôt creuse (').
Ilorsqu'elle est creuse, son ouverture se nomme ombilic.
Les tours de la coquille peuvent rester à-peu-près
dans le même plan, ou tendre toujours vers la base de
la columelle.
Dans ce dernier cas, les tours précédens s'élèvent audessus
les uns des autres, et forment ce que l'on nomme
la spire, qui est d'autant plus aiguë que les tours des-
It^
' ii'J i
1 !
1
. l l M l
(rt) Pl. 19. fig. r, pl. 25. fig. I,
(C) Pl. 30. fig. I.
(¿) Pl. 19. fig. r ,etc.
(<i) Pl. 19. fig. 2 ai pl. ao. fig. 1 «, etc.
(«) P). 25. fig. 3, . 5 , clc. (i) Pl. î î . f ig. I, 9., 3, f). elc.