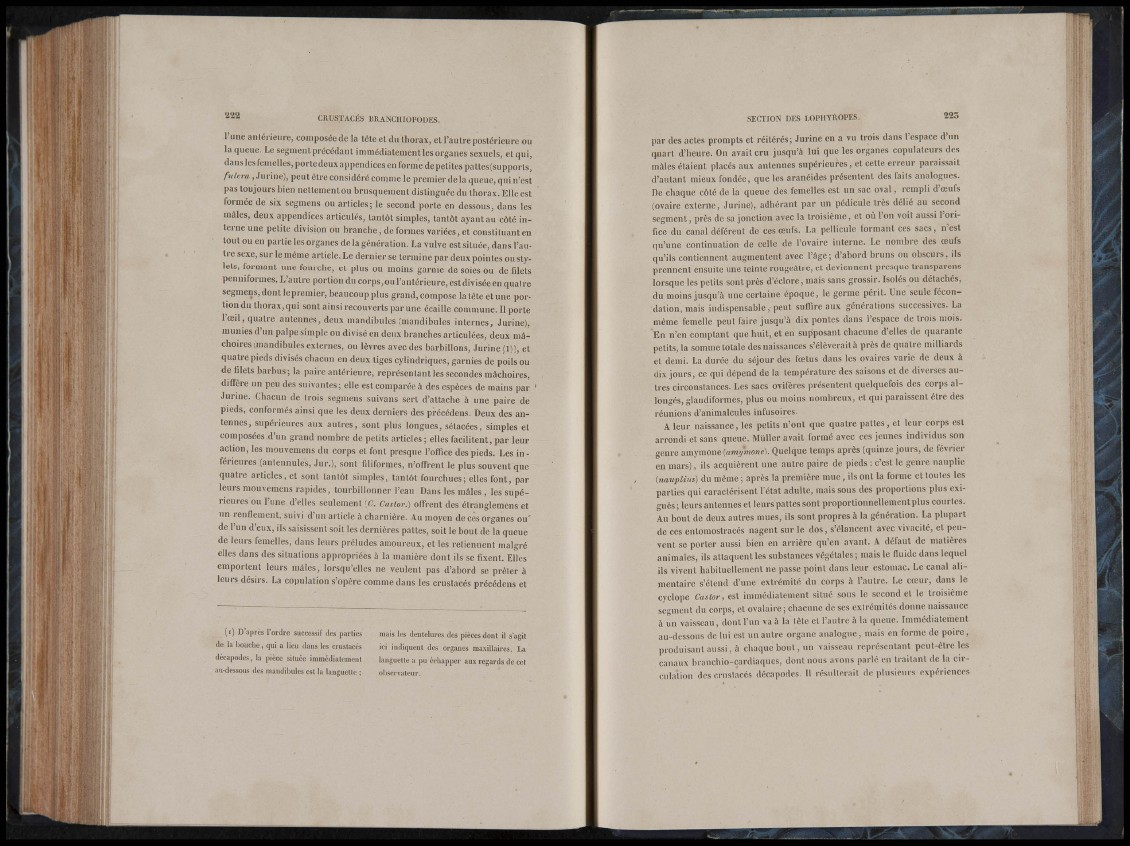
CRUSTACÉS liRAiNCmOl'ODES.
l ' u n e anlérieiire, composée de la tète el du thorax, el l 'aulre postérieure ou
la queue. Le segment précédant immédiatement les o rganes sexuels, et qui,
dans les femel les , p o r t e d e u x appendices en forme de pet i tes paltes(supports,
f u U r a , Jul'ine), peut être considér é comme le premier del à queue, qui n'est
pas toujour s bien nettementou brusquement distinguée du thorax. El l e est
formée de six scgmens ou articles; le second porte en dessous, dans les
mâles, deux appendices articulés, tantôt simples, tantôt ayant au côté inl
e r n e une petite division ou branche, de formes variées, et conslituanten
tout ou en partie les o rganes del à générat ion. La vulve est s i tuée, d ans l'aut
r e sexe, sur le m ême article. Le dernier se termine par deux pointes oustylets,
formant une fourche, et pins ou moins garnie de soies ou de filets
penniformes. L'aut r e portion du corps,ou l 'antér ieure, e s tdivi séeen quatre
segmens, dont lepremier , beaucoup plus grand, compose la téte et une port
i on d u thorax,qui sont ainsi recouvert s par une écaille connnune. Il porte
l ' oe i l , quatre antennes, deux mandibules imandibnles internes, Jurine),
munies d'un palpe s impl e ou divisé en deux branches articulées, deux mâchoires
^mandibules externes, on lèvres avec des barbillons, Jurine(l)), et
q u a t r e pieds divisés chacun en deux tiges cyl indriques, garnies de poils ou
d e filets barbus; la paire antérieure, représentant les secondes mâchoires,
diffère un peu des suivantes ; elle est comparée à des espèces de mains par '
J u r i n e . Chacun de trois segmens suivans sert d'attache à une paire de
pieds, conformés ainsi que les deux derniers des précédens. Deux des ant
e n n e s , supériein-es aux autres, sont plus longues, sétacées, simples et
composées d'un grand nombr e de petits articles; elles facilitent, par leur
action, les mouvemens du corps et font presque l'office des pieds. Les inf
é r i e u r e s (antennnles, Jur.), sont filiformes, n'offrent le plus souvent que
q u a t r e articles, et sont tantôt simples, tantôt fourchues; elles font , par
l e u r s mouvemens rapides, tourbillonner l'eau Dans les mâles , les supér
i e u r e s ou l'une d'elles seulement [C. Castor.) offrent des étranglemens et
n n renflement, suivi d'un article à charnière. Au moyen de ces o rganes ond
e l 'un d'eux, ils saisissent soit les dernières pattes, soit le bout île la queue
d e leurs femelles, dans leurs préludes amoureux, et les retiennent malgré
elles dans des si tuat ions appropriées à la manière dont ils se fixent. Elles
e m p o r t e n t leurs miles, lorsqu'elles ne veulent pas d'abord se prêter à
leurs désirs. La copulation s'opère comme dans les crustacés précédens et
{i] D .Tpi'cs l'ordre successif des parties
de la Ijoiiche, qui a lieu dans les crustacés
décapodes, la pièce située inimcdiatement
au-dessous des mauditiules est lit languette ;
mais les dentelures des pièces dont il s'agit
ici indiquent des organes raa.\illaires. La
languette a pu échapper aux regards de cet
observateur.
.SECTION DES LOPHYROPES. 22,-)
par des actes prompts et réitérés; Jurine en a vu trois dans l'espace d'un
q u a r t d'heure. On avait c m jusqu'à lui que les organes copulateurs des
mâles étaient placés aux antennes supérieures , et cette e r reur paraissait
d ' a u t a n t mieux fondée, que les aranéides présentent des faits analogues.
De chaque côté de la queue des femelles est un sac oval , rempli d'oeufs
(ovaire externe, Jurine), adhérant par nn pédicule très délié au second
s e g m e n t , près de sa jonct ion avec la troisième, et où l 'on voit aussi l'orifice
du canal déférent de ces oeufs. La pellicule lormant ces sacs, n'est
q u ' u n e continuation de celle de l'ovaire interne. Le nombre des oeufs
q u ' i l s contiennent augmentent avec l'âge; d'abord bruns ou obscurs, ils
p r e n n e n t ensuite une teinte rougeâtre, et deviennent presque transparens
l o r s q u e les petits sont p rès d'éclore, mai s sans grossir. Isolés ou détachés,
du moins jusqu' à une certaine époque, le germe périt. Une seule fécondation,
mais indispensable, peut suffire aux générations successives. La
même femelle peut faire jusqu' à dix pontes dans l'espace de trois mois.
E n n'en comptant que hui t , et en supposant chacune d'elles de quarante
petits, la somme totale des naissances s'élèveraità près de quat r e milliards
et demi. La durée du séjour des foetus dans les ovaires varie de deux à
dix jour s , ce qui dépend de la température des saisons et de diverses aut
r e s circonstances. Les sacs oviféres présentent quelquefois des corps allongés,
glaudiformes, plus ou moins nombreux, et qui paraissent être des
réunions d'animalcules infusoires.
A leur naissance, les petits n'ont que quatre pat tes, et leur corps est
arrondi et sans queue. Müller avait formé avec ces jeunes individus son
genre atnytnone {amijmonc). Quelque temps après (quinze jours, de février
e n mars), ils acquièrent une autre paire do pieds : c'est le genre nauplie
{nauplius) du même ; après la première m u e , ils ont la forme et toutes les
p a r t i e s qui caractérisent l'état adulte, mais sous des proportions plus exiguës
; l e u r s antennes et leurs pat tes sont p ropor t ionnel lement plus courtes.
Au bout de deux autres mues, ils sont propres à la génération. La plupart
de ces entomostracés nagent sur le dos, s'élancent avec vivacité, et peuvent
se porter aussi bien en arrière qu'en avant. A défaut de matières
animales, ils a t taquent les substances végétales ; mai s le fluide d a n s lequel
ils vivent habituellement ne passe point dans leur estomac. Le canal alim
e n t a i r e s'étend d'une extrémité du corps à l'autre. I.e coeur, dans le
cyclope Castor, est immédiatement situé sous le second et le tioisième
segment du corps, et ovalaire ; c h a c u n e de ses exi rémi tés donne naissance
à un vaisseau, dont l'un va à la tête et l 'autr e à la queue. Immédiatement
au-dessous de lui est un autre organe analogue, mais en forme de poire ,
p r o d u i s a n t aussi, à chaque bout , nn vaisseau représentant peut-être les
canaux brauchio-cardiaqucs, dont nous avons parlé en traitant de la circulation
des crustacés décapodes. Il résulterait de plusieurs expériences