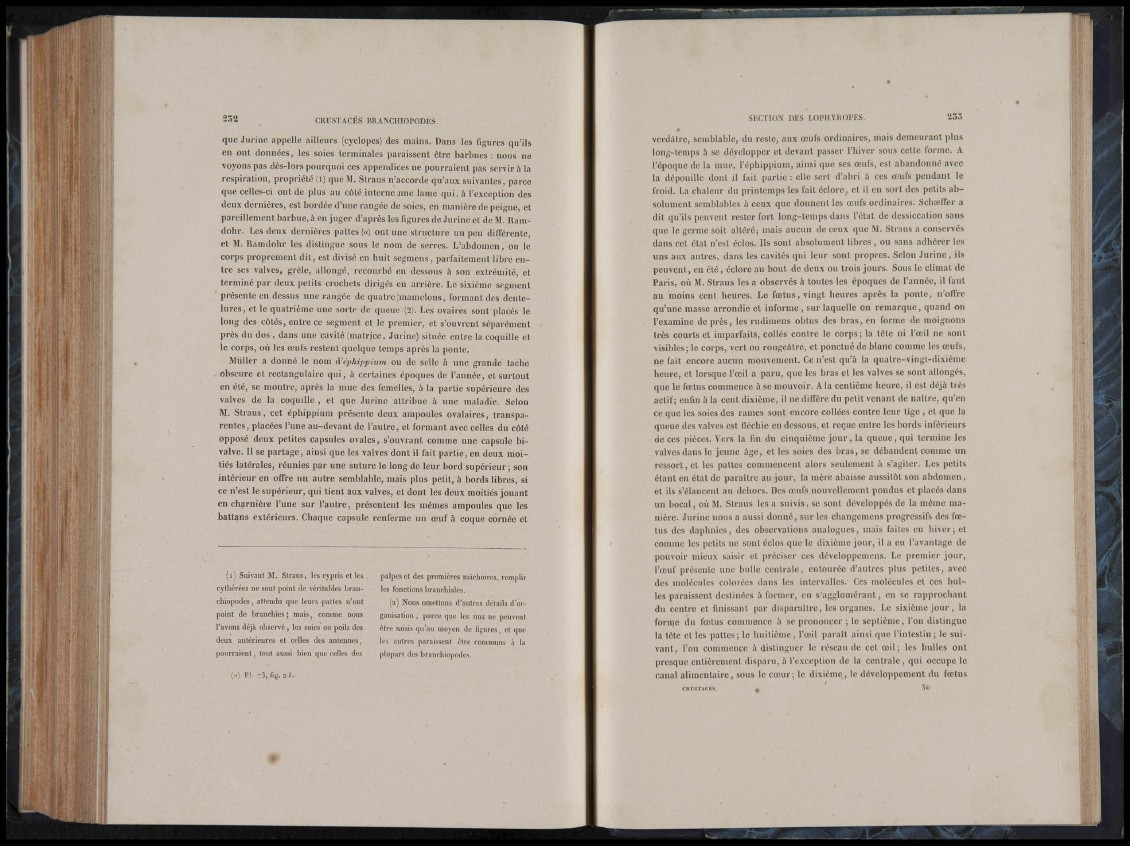
a
232 CRUSTACÉS BRANCITIOPODES.
que Jurine appelle ailleurs (cyclopes) des mains. Dans les figures qu'ils
en ont données, les soies terminales paraissent être barbues : nous ne
voyons pas dès-loi s pourquoi ces appendices ne pourraient pas servir h la
respiration, propriété (1) que M. Straus n'accorde qu'aux suivantes, parce
que celles-ci ont de plus au côté interne .une lame qui, à l'exception des
deux dernières, est bordée d'une rangée de soies, en manière de peigne, et
pareillement barbue, à en juger d'après les figures de Jurine et de M. Ramdohr.
Les deux dernières pattes (a) ont une structure un peu diflérente,
et M. Raindohr les distingue sous le nom de serres. L'abdomen, ou le
corps proprement dit, est divisé en huit segmens, parfaitement libre entre
ses valves, grêle, allongé, recourbé en dessous à son extrémité, et
terminé par deux petits crochets dirigés en arrière. Le sixième segment
' présente en dessus une rangée de quatre [mamelons, formant des dentelures,
et le quatrième une sorte de queue (2). Les ovaires sont placés le
long des côtés, entre ce segment et le premier, et s'ouvrent séparément
près du dos , dans une cavité (matrice, Jurine) située entre la coquille et
le corps, où les oeufs restent quelque temps après la ponte.
Müller a donné le nom d'e^At/;^^?« ou de selle à une grande tache
- obscure et rectangulaire qui, à certaines époques de l'année, et surtout
en été, se montre, après la mue des femelles, à la partie supérieure des
valves de la coquille , et que Jurine attribue à une maladie. Selon
M. Straus, cet éphippium présente deux ampoules ovalaires, transparentes,
placées l'une au-devant de l'autre, et formant avec celles du côté
opposé deux petites capsules ovales, s'ouvrant comme une capsule bivalve.
Il se partage, ainsi que les valves dont il fait partie, en deux moitiés
latérales, réunies par une suture le long de leur bord supérieur; son
intérieur en oiTre un autre semblable, mais plus petit, à bords libres, si
ce n'est le supérieur, qui tient aux valves, et dont les deux moitiés jouant
en charnière l'une sur l'autre, présentent les mêmes ampoules que les
battans extérieurs. Chaque capsule renferme un oeuf à coque cornée et
( i ) Suivant M. Slraiis, li's cypris et les
cythérces ne sont point de véritables liranchiopocies,
attendu que leurs-paltes n'ont
point de branchies; mais, comme nous
l'avons déjà observé , les soies ou poils des
deux antérieures et colles des antennes,
pourraient, tout aussi bien que relies dos
Pl.
palpes et des premières mâchoires, rcmpHr
les fonctions branchiales.
(a) Nous omettons d'autres détails d'organisation
, parce que les uns no peiivcnl
ôire saisis qu'au moyen de figures, et que
h:s autres paraissent élro communs à la
plupart des brancliiopodos.
SECTION DES LOPHÏROPES.
vcrdàtre, semblable, du reste, aux oeufs ordinaires, mais demeurant plus
long-temps à se développer et devant passer l'hiver sous cette forme. A
l'éi>oque de la mue, l'éphippium, ainsi que ses oeufs, est abandonné avec
la dépouille dont il fait partie : elle sert d'abri à ces oeufs pendant le
froid. La chaleur du printemps les fait éclore, et il en sort des petits absolument
semblables ä ceux que donnent les oeufs ordinaires. Sclueffer a
dit qu'ils peuvent rester fort long-temps dans l'état de dessiccation sans
que le germe soit altéré; mais aucun de ceux que M. Straus a conservés
dans cet état n'est éclos. Ils sont absolument libres, ou sans adhérer les
uns aux autres, dans les cavités qui leur sont propres. Selon Jurine, ils
peuvent, en été, éclore au bout de deux ou trois jours. Sous le climat de
Paris, où M. Straus les a observés à toutes les époques de l'année, il faut
au moins cent heures. Le foetus, vingt heures après la ponte, n'offre
qu'une masse arrondie et informe, sur laquelle on remarque, quand on
l'examine de près, les rudimens obtus des bras, en forme de moignons
très courts et imparfaits, collés contre le corps; la tête ni l'oeil ne sont
visibles; le corps, vert ou rougcâtre, et ponctué de blanc comme les oeufs,
ne fait encore aucun mouvement. Ce n'est qu'à la quatre-vingt-dixième
heure, et lorsque l'oeil a paru, que les bras et les valves se sont allongés,
que le foetus commence à se mouvoir. A la centième heure, il est déjù très
actif; enfm à la cent dixième, il ne diffère du petit venant de naître, qu'en
ce que les soies des raines sont encore collées contre leur tige , et que la
queue des valves est fléchie en dessous, et reçue entre les bords inférieurs
de ces pièces. Vers la fin du cinquième jour, la queue, qui termine les
valves dans le jeune ùge, et les soies des bras, se débandent comme un
ressort, et les pattes commencent alors seulement il s'agiter. Les petits
étant en étal de paraître au jour, la mère abaisse aussitôt son abdomen,
et ils s'élancent au dehors. Des oeufs nouvellement pondus et placés dans
un bocal, où M. Straus les a suivis, se sont développés de la même manière.
Jurine nous a aussi donné, sur les changcmens progressifs des foetus
des daphnies, des observations analogues, mais faites en hiver; et
comme les petits ne sont éclos que le dixième jour, il a eu l'avantage de
pouvoir mieux saisir et préciser ces développeinens. Le premier jour,
l'oeuf présente une bulle centrale, entourée d'autres plus petites, avec
des molécules colorées dans les intervalles. Ces molécules et ces bulles
paraissent destinées à former, eu s'agglomérant, en se rapprochant
du centre et finissant par disparaître, les organes. Le sixième jour, la
forme du foetus commence h se prononcer ; le septième, l'on distingue
la löte et les pattes; le huitième, l'oeil paraît ainsi que Tintestin; le suivant,
l'on commence it distinguer U; réseau de cet oeil; les bulles ont
presque entièrement disparu, ù Tcxceplion de la centrale, qui occupe le
canal alimentaire, sous le coeur; le dixième, le dévelo]>pemcnt du foetus
CRDSTACÉ9. « 3ü
%