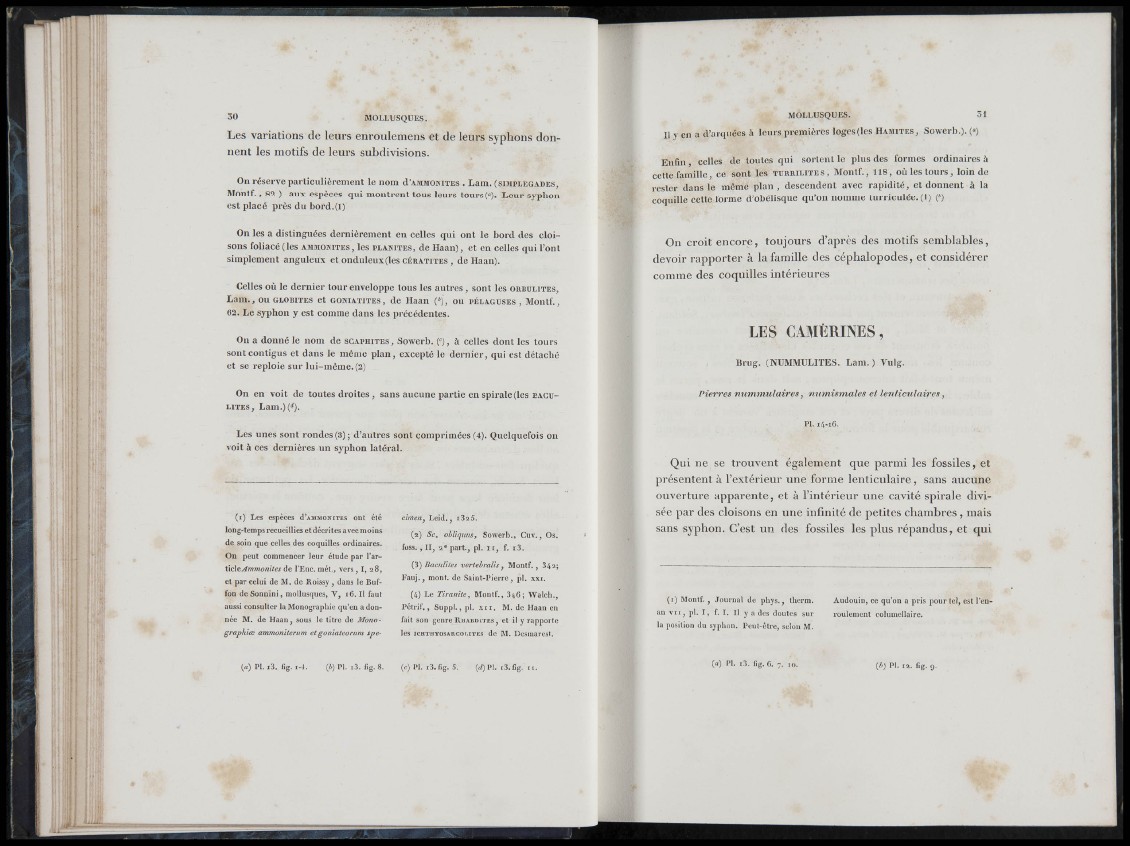
1,1
3 0 MOLLUSQUES.
Les variations de leurs enroulemens et J e leurs syphons donnent
les motifs de leurs subdivisions.
On réserve parliculièrement le nom (I'ammoimtes . Lam. (sliiplegades,
Montf., 82 ) aux espèces qui montrent tous leurs tours (»). Leur syphon
est placé près du bord.(l)
On les a distinguées dernièrement en celles qui ont le bord des cloisons
foliacé (les ahj igs i t e s , les plaki tes, de Haan), et en celles qui l'ont
simplement anguleux et onduleux(les cérat i tes , de Haan).
Celles où le dernier tour enveloppe tous les autres, sont les orbclites,
L a m . , ou GLOBiTES et gokiat i t e s , de Haan ('), ou pélaguses , Montf.,
62. Le syphon y est comme dans les précédentes.
On a donné le nom de scaphites, Sowerb. f ) , îi celles dont les tours
sontcontigus et dans le même plan, excepté le dernier, qui est détaché
et se reploie sur lui-même. (2)
On en voit de toutes droites , sans aucune partie en spirale (les bacu-
LITES, Lam.jC).
Les unes sont rondes (3) ; d'autres sont comprimées (4). Quelquefois on
voit à ces dernières un syphon latéral.
( r ) Les espèces dVMMOiriTEs ont été
long-temps recueillies etdéerltesavee moins
de soio que celles des coquilles ordinaires.
On peut commencer leur étude par l'articie^
mmoniies de TEnc. met., vers, i, 28,
et par celui de M. de Roissy, dans le Eiiffon
deSonnini, mollusques, V, 16. Il faut
aussi consulter la Monographie qu'eu a donnée
M. de Haan, sous le titre de MonographicB
ammonilerum etgoniateorum tpecimen,
Leid., rîaS.
(2) Se. obUqunSt Sowerb., Cnv., Os.
foss. ,11, 2« part., pl. I t , f. i3.
l'i) liacnlt/cs vertebraììs, Montf., 342;
Fanj., mont, de Saint-Pierre, pl. xxi.
(4) Le Tiranile, Montf., 346; Walcii.,
Pétrif., Suppl., pl. XI r. M. de Haaii en
fait son genre RHABDITES , et il y rapporte
les icBTHYosARcoi.iTES dc M. Ucsuiarcsl.
MOLt.USQUES. 3t
Il y en a d'arquées à leurs premières logcs(les Hamites, Sowerb.). (-)
Enfin celles de toutes qui sorlentle plus des formes ordinaires à
cette famille, ce sont les tukrilites, Montf., 118, où les tours, loin de
rester dans le même plan , descendent avec rapidité, et donnent à la
coquille cette forme d'obélisque qu'on nomme turriculée.(l) (»)
On croit encore, toujours d'après des motifs semblables,
devoir rapporter à la famille des céphalopodes, et considérer
comme des coquilles intérieures
L E S CAMÉRINES,
lirug. (NUMMULITES. Lam. ) Vulg.
Pierres nummulaires, numismales et lenticulaircs,
PI. 14-16.
Qui ne se trouvent également que parmi les fossiles, et
pi'ésentent à l 'extérieur une forme lenticulaire, sans aucune
ouverture apparente, et à l'intérieur une cavité spirale divisée
par des cloisons en une infinité de petites chambres , mais
sans syphon. C'est un des fossiles les plus répandus, et qui
( i ) Montf., Journal de phys., therm,
an v i l , pl. I , f. I. Il y a des doutes sur
la position du syphon. Peut-être, selon M.
Audouin, ce qii'on a pris pour tel, est l'eoroulenient
columellaire.
(o) Pl. i3. I!g. i-J. (4) 1>1. t3. lig. ê (c) Pl. i3.lig. 5. (¿)P1. i3.0g. II. («) PL ,3. lig. 6. 7. {!') PI- .2. Cg. 9