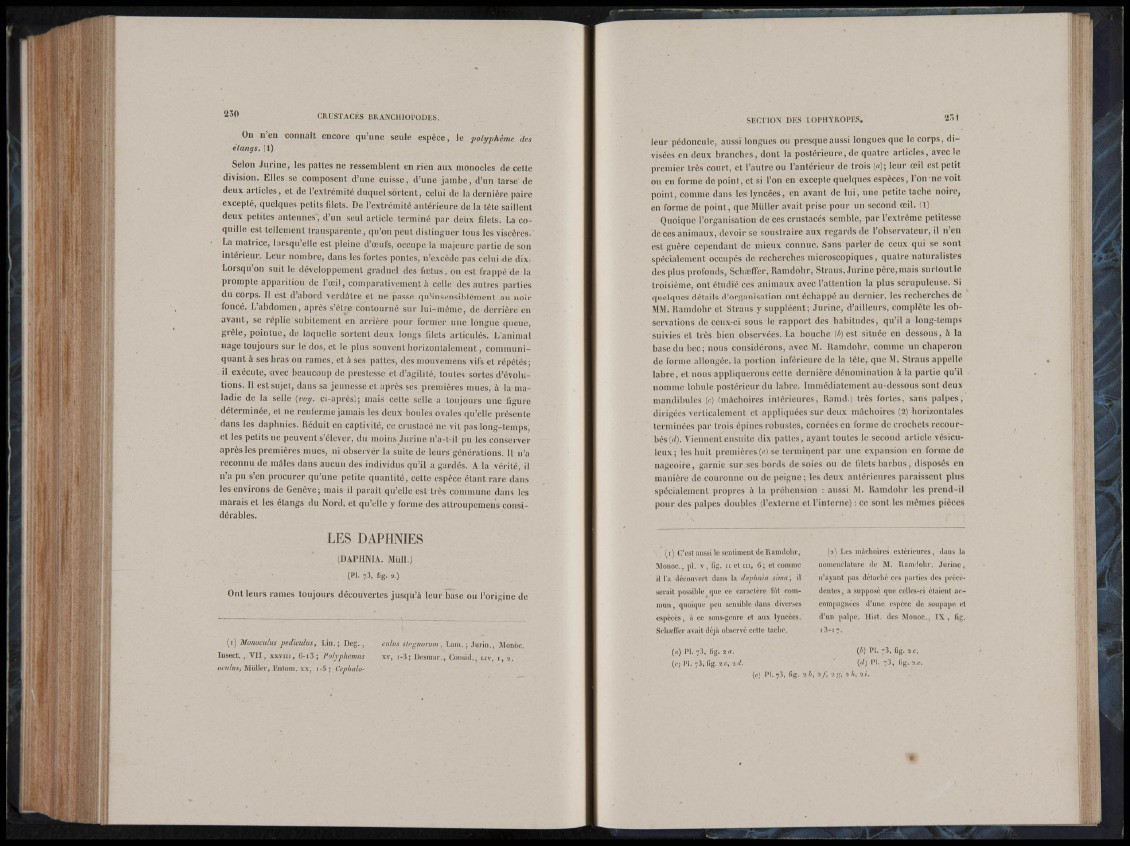
f
:ÎÎI
M
poiyphcmc des
CRUSTACÉS liUANCmOrODES.
On n'en connaît encoie qu'une seule espèce,
étanijs. (I)
Selon Juline, les paltes ne ressemblent en rien aux monocles de cette
division. Elles se composent d'une cuisse, d'une jamhc, d'un tarse de
deux articles, et de l'extrémité duquel sor tent , celui de la dernièr e paire
excepté, quelques petits filets. De l'extréinité antérieure de la tète saillent
deux petites antennes", d'un seul article tenniné par deux filets. La coq
u i l l e est tel lement transparente, qu'on peut distinguer tous les viscères.
La matrice, lorsqu'elle est pleine d'oeuls, occupe la majeure partie de son
i n t é r i e u r . Leur nombre, dans les fortes pontes, n'excède pas celui de dix.
Lorsqu'on suit le développement graduel des foetus, on est frappé de la
p r o m p t e ap|)aiilion de l'oei), comparalivenient à celle des autres (larties
d u corps. 11 est d'abord verdatre et ne passe qu'insensiblement au noiifoncé.
L'abdomen, après s'être conlournc sur lui-même, de derrière en
a v a n t , se replie subitement en arrière pour former une longue queue,
g r ê l e , pointue, de laquelle sortent deux longs l'ilels articules. L'aniuial
nage toujours sur le dos, et le plus souvent l ior izonlalement , communiq
u a n t à ses b ras ou rames, et à ses pattes, des mouvenlens vifs et répétés ;
il exécute, avec beaucoup de prestesse et d'agilité, toutes sortes d'évolutions.
11 est sujet , dans sa jeunesse et après ses pi eni ières mues, à la maladie
de la selle [voy. ci-après!; mais cette selle a toujoui-s une iiguie
déterminée, et ne renferme jamai s les deux boules ovales qu'elle présente
dans les daphnies. Réduit en captivité, ce crustacé ne vit pas long-temps,
e t les pet i ts ne peuvent s'élever, du moins Jiiriue n'a-t-il pu les conserver
a p r è s les p r emi è r e s mues, ni obsci ver la suite de leurs générations. 11 n'a
r e c o n n u de milles dans aucun des individus qu'il a gardés. A la vérité, il
n ' a pu s'en procurei- qu'une petite quantité, cette espèce étant rare dans
les envi rons de Genève; mais il parai t qu'elle est tiès commune dans les
marais et les étangs du Nord, et qu'elle y foi nie des atti oupcmens considérables.
LES DAPHNIES
[DAIMIINIA. MullO
(Pl. 73, lig. 2.)
Onl leurs rames toujours découvertes jusqu' à leur base ou l'origine de
( i ) Monoatlus pediculus. Lin. ; Deg. ,
lustJcL , V I I , XX.VIII, Ii-i3; Polyphemus
ocnÌHSi MiilliT, iLiilom. xx, i-,5 ; Ccpiialoculus
stff^r,iüivi» , l,am, ; .Iiinii,, Monóc,
XV, 1-3; I)<'stiiar., Cotisid., i.[v, i, a.
SECTION DKS LOl>H\ROPES. '¿->1
leur pédoncule, aussi longues ou presque aussi longues que le corps, divisées
en deux branches, dont la postérieure, de quatre articles, avecle
p r e m i e r très court, et l'autre ou l'anlérieur de trois (a); leur oeil est petit
ou eu forme de point , et si l'on en excepte quelques espèces, l'on ne voit
p o i n t , comme dans les lyncées, en avant de lui, une petite tache noire,
en forme de point, que Müller avait prise pour un second oeil. (i)
Quoique l'organisation de ces crustacés semble, par l'extrême petitesse
de ces animaux, devoir se soustraire aux regards de l'observateur, il n'en
est guère cependant de mieux connue. Sans parler de ceux qui se sont
spécialement occupés de recherches microscopiques, quatre naturalistes
des plus profonds, Schîeiîer, Ramdohr , Straus, Jur ine père, mai s surloutle
troisième, ont étudié ces animaux avec l'altention la plus scrupuleuse. Si
quelques détails d'organisation onl échappé au dernier, les recherches de '
MM, lUmdohr et Straus y suppléent ; Jurine, d'ailleurs, complète les observations
de ceux-ci sous le rappor t des habitudes, qu'il a long-temps
suivies et très bien observées. La bouche i/')est située en dessous, à la
base du bec; nous considérons, avec M. Hamdohr, comme un chaperon
de l'ornie allongée, la port ion inférieure de la tòte, que M. Straus appelle
l a b r e , et nous appl iquerons celle dernière dénomination à la part i e qu'il
nomme lobule postérieur du labre. Immédiatement au-dessous sont deux
mandibules (t) fmàchoires intérieures, Ramd.) très fortes, sans pjdpes,
dirigées verticalement et appliquées sur deux mAchoires (2) horizontales
tei ininées par trois épines robustes, cornées en forme de crochet s recourbés
(r/). Viennent ensui t e dix pat tes, ayant toutes le second article vésiculeux
; les hui t premières (e) se Icrminent par nue expansion en forme de
n a g e o i r e , garnie sur ses bords de soies ou de iilets b a rbus , disposés en
manière de couronne ou de peigne; les deux anlérienres paraissent plus
spécialement propres ò la préhension : aussi M. Ramdohr les prend-il
pour des palpes doubles (l'externe et l'interne) : ce sont les mêmes pièces
(f) C'est an.ssi Uî sciiliment ilcRamclohr,
Moiioc., pl. V , fig. It el m, G5 et comme
il l 'a ilccoiivert il a 11s la dnphnia sima, il
serait possible que ce caractère fût comiiuiii,
([iicique jieii sensible ilans diverses
espèces, à ce sous-gcnre et aux lyncées.
Scha'ffer avait iléjà observé celle lâche.
a) Les màclioircs extérienres, dans ki
iclalHve de M. Ramdohr. Jurine,
n'ayant pas détarlié ces parties des précédentes,
a supposé que celles-ci étaient accompagnées
d'une espèce de soupape el
d'un pidpe. llist, des Monoc., IX, fig.
13-17.
(o) Pl. 73, fig. a
(r; Pl. 73,iis.îi.-,
(/') Pl. :3, fig. a
(,/j Pl. 73. li«.'
(f) Pl.73, fig. 7J>, -xf, il'
: : r i