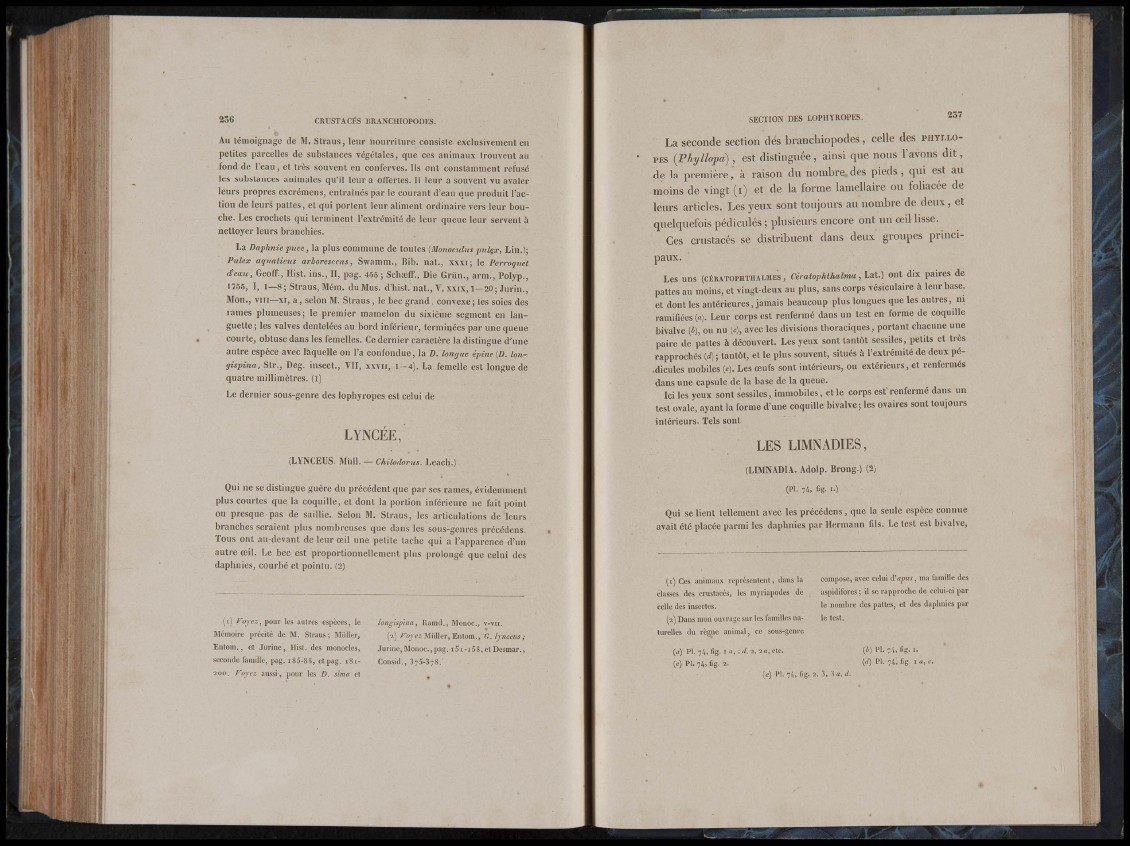
il
Îiô6 CRUSTACÉS BRANCHIOPODES.
Au léinoignase de M. S t r a u s , leur iiourrilurc consiste exclusivenienl eu
p e t i t e s parcelles de substances végétales, que ces animaux trouvent au
f o n d d e Teau, et très souvent en confervas. Ils ont constamment refusé
l e s substances animales qu'il leur a oirerles. Il leur a souvent vu avaler
l e u r s propres excrémens, entraînés p a r le cour ant d'eau que produi t l'act
i o n de leur s pat tes, et qui por tent leur a l iment ordinaire vers leur bouc
h e . Les c rochet s qui terminent l'extrémité de leur queue leur servent à
n e t t o y e r leur s branchies.
La D a p h n i e f u c e , la plus c ommu n e de toutes { M o n o n u l u s f u l ç x , Lin.lj
P u l e x aquni ici i s arhorescens, Swamm., Bib. nat., xxxi ; le Perroquet
d ' e a u , Geoff., Hist , ins. , Il, pag. 455 ; SchaeiF., Die Grün. , arm. , Polyp.,
1755, 1, 1—8; St raus, Mém. du Mus. d'hist. n a t . . Y, x x i x , i—2 0 ; Jurin.,
M o n . , VIII—xr, a , selon M. S t r a u s , le b e c g r a n d , convexe; les soies des
r a m e s plumeuses; le p remier mamelon du sixième segment en lang
u e t t e ; les valves dentelées au bor d infér ieur j t e rmi n é e s p a r une tjueue
c o u r t e , obtuse d a n s les femel les. Ce d e r n i e r caractèr e la d i s t ingu e d'une
a u t r e espèce avec laquel l e o n l'a c o n f o n d u e , la D . I m u j u e é p i n e [D. l a n -
g i s p i n a , Str., Deg. insect., VII, xxYli, 1 -4) . La femelle est longue de
q u a t r e mi l l imèt res. (1)
Le d e rni e r sous-genre des lophyropcs est celui de
LYNCEE,
ÎLYNCEUS. MUIl. — C h i l o d o r u s . Leach.)
Qui ne se d i s t ingue guèr e du précédent que par ses r ame s , évidemment
p l u s cour tes que la coquille, et dont la por t ion inférieure ne fait point
o u presque pas de saillie. Selon M. Slraus, les articulations de leurs
b r a n c h e s seraient plus nombreuses que dans les sous-genres précédens.
T o u s ont au-devant de leur oeil une petite tache qui a l 'apparence d'un
a u t r e oeil. Le bec est proportionnellement plus prolongé que celui des
d a p i n i i e s , courbé et pointu. (2)
( i ) f^ojez, pour les autres espèces, te
Mémoire prccilé de M. Straus; Müller,
Entom., et Jurine, Hist, des monocles,
seconde famille, pag. i85-38, etpag. i8i-
200. rrjycz .anssi, pour les D . s i m a e(
l o n g i s p i n a , Ramd., Mouoc., v-vii.
(2) / 'oj r a Millier, Elltom., fi. l y n c m s ;
Juriue,Monoc.,pag. i5l-i5S,etDesmar.,
Consid., 375-37S.
SECTION DES LOPHYROPES.
2 3 7
La seconde section des branchiopodes, celle des PIITLLOPES
i P h y l l o p a ) , est distinguée , ainsi qne notts l'avons dit,
de la pt-emière, à raison du nombre, des pieds , qui est au
moins de vingt (i) et de la forme lamellaire ou foliacée de
leurs articles. Les yeux sont toujours au nombre de deux , et
quelquefois pédiculés ; plusieurs encore ont tui oeil lisse.
Ces crustacés se distribuent dans deux groupes principaux.
L e s uns (cÎBATOPHTnALiïlES, C é r a i o p h t h a l m n , Lat.) ont dix paires de
p a t t e s a u moins, et v ingt -deux au plus, sans c o r p s vésiculaire à leur base,
e t dont les ant é r i eur e s , j ama i s beaucoup plus longue s que les a u t r e s , m
r a m i f i é e s («). Leur corps est renfermé dans u n test en forme de coquille
b i v a l v e (i), o u n u le), avec les divisions thoraciques , portant chacune une
p a i r e de pattes à découver t . Les yeux sont tantôt sessiles, pet i t s et très
r a p p r o c h é s ; t antôt , et le p lus souvent , situés à l 'ext rémi t é d e d eux pé-
• d i c u l e s mobi les (e). L e s oe u f s sont intér ieurs, o u extérieurs, et renfermés
d a n s nue capsule de la base d e la queue.
Ici les y eu x sont sessiles, immobi l e s . et l e corps cs f r e n f e rmé dans un
t e s t ovale, ayant la forme d 'une coquill e b ivalve; les ovai res sont toujours
i n t é r i e u r s . Tels sont
LES LIMNADIES,
(LIMNAD1.\. Adolp. Brong.) (2)
(Pl. 74, Cg. '•)
Qui se l ient tellement avec les p r é c é d e n s , que la seul e espèce connue
a v a i t été placée p a rmi les daphnies par H e rma n n fils. Le test est bivalve,
(1) Ces animaux représentent, dans la
classes des crustacés, les myriapodes de
celle des insectes.
(2) Dans mon ouvrage sur les familles naturelles
du règne animal, ce sous-genre
compose, avec celui i l ' a p i t s , ma Tamille des
aspidifores ; il se rapproche de celui-ci par
le nombre des pattes, et des dapliuies par
le test.
M 1>I. , 4 , fig. m , ¡(i, 2, în. c t e . (J j Pl. i l . l ig. •
W Pl. 14. lie- ''S' '
(e) Pl. 7/1, llg. 2, 3,