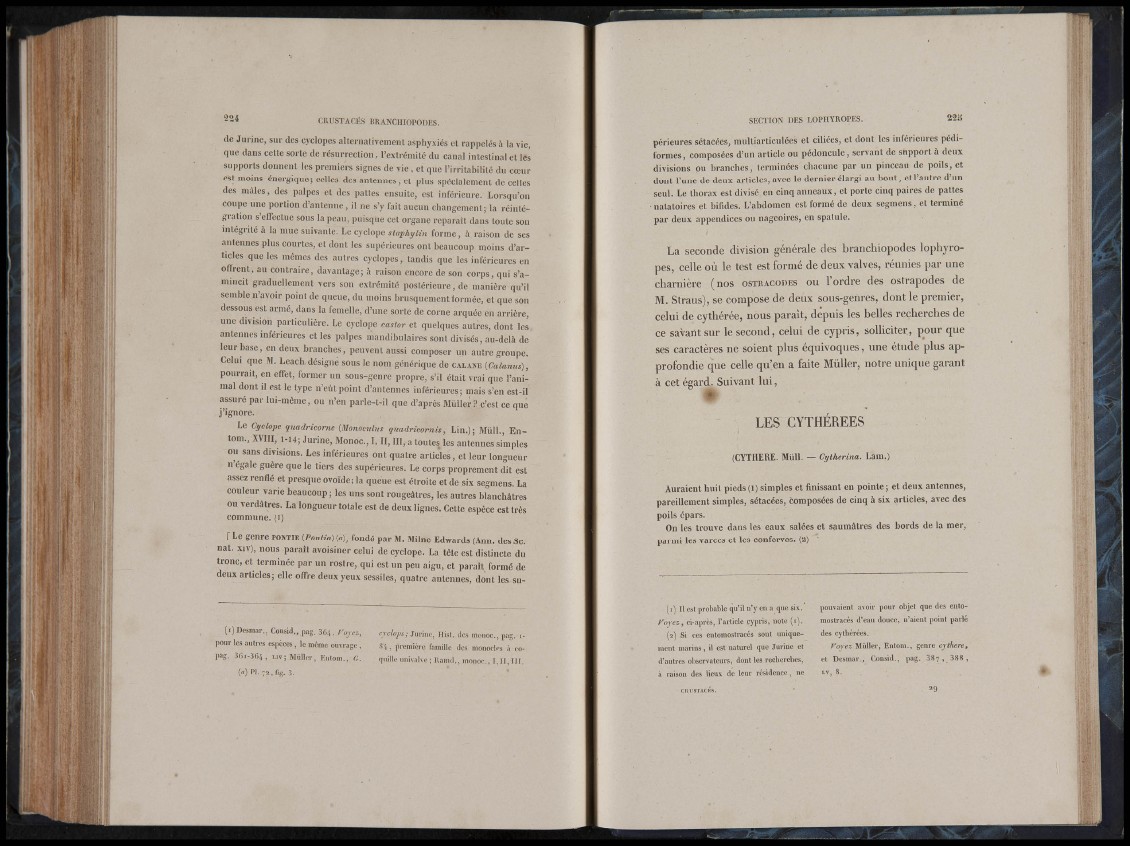
CKIISTAHÉS BRANCHIOPODES.
de Jurine, sur des cvclopes altenialiveineiu asphyxiés cl rappelés h la vie,
que dans celle sorte de résurrection, l'extrémilé du canal intestinal et les
supports donnent les p remier s signes de vie, et que l'irritabililé du coeur
est moins énergique; celles des antennes, et plus spécialement de celles
des miles, des palpes et des pâlies ensuite, est inférieure. Lorsqu'on
coupe une portion d'antenne, il ne s'y tait aucun changeraenl; la réintég
r a t i o n s'effectue sous la peau, puisque cet organe reparait dans toute son
i n t é g r i t é à la mue suivante. Le cyclope sUjihyliit forme, à raison de ses
antennes plus courtes, et dont les supéj-ieurcs ont beaucoup moins d'articles
que les mêmes des autres cyclopes, tandis que les inférieures en
o f f r e n t , au contraire, davantage; ii raison encore de son corps, qui s'amincit
graduellement vers son extrémité postérieure, de manière qu'il
semble n'avoir point de queue, du moins bru.squenicnt lorméc, et que son
dessous est armé, dans la femelle, d'une sorte de corne arquée en arrièi-e,
une division particulière. Le cyclope castor et quelques autres, dmil les
antennes inférieures et les palpes mandibulaires sont divisés, au-delà de
leur base, en deux branches, peuvent aussi composer un autre groupe.
Celui que M. Leach désigné sous le nom générique de CALABE (Calam,,),
p o u r r a i t , en elTet, former un sous-genre propre, s'il était vrai que l'animal
dont d est le type n'eiitpoint d'antennes inférieures; mais s'en est-il
assuré par lui-même, ou n'en parle-t-il que d'après Müller ? c'est ce que
j ' i g n o r e .
Le Cychpe qnadriconu {llonoculiis qmidricornis, Lin.); Müll., Entom.,
XVIII, 1-14; Jur ine , Monoc., I, II, III, a toutes les antennes simples
ou sans divisions. Les inférieures ont quatre arlic'les, et leur longueur
n'égale guère que le tiers des supérieures. Le corps proprement dit est
assez renflé et presque ovoïde; la queue est étroite et de six segmens. La
couleur varie beaucoup; les uns sont rougeâtres, les autres blanchâtres
o u verdâtres. La longueur totale est de deux lignes. Celle espèce est très
commune, (i)
[ Le genr e POBTIE {Poniia) {a), fondé par M. »lilne Edwards (Ann. des Se.
nat. XIV), nous parait avoisiner celui de cyclope. La tète est distincte du
t r o n c , et terminée par un rostre, qui est un peu aigu, et parait formé de
deux articles; elle offre deux yeux sessiles, quatre antennes, dont les su-
( i ) n c s m a r . , Consiil., p g . 304, roycz,
pour les autres espèces, le même ouvrage ,
p-lg. 36.-364, 1.1«; Müller, Enlom., C.
W l'I. T^.fig.
crclojjs; Jurine, Hisl. des miiiioc., pag. i-
.S-'i , première famille des monocles à coquille
nnivalve; lîamd,, monoc., 1, ]1,TÎI.
SECTION DES LOPHYROPES. 22K
périeures sétacées, mulliarticulées et ciliées, et dont les inférieures pcdiformes,
composées d'un article ou pédoncule, servant de support à deux
divisions ou branches, lerminées chacune par un pinceau de poils, et
dont l'une de deux articles, avec le dernier élargi au bout , ell'aulre d'un
seul. Le thorax est divisé en cinq anneaux, cl porte cinq paires de pâlies
natatoires et bifides. L'abdomen est formé de deux segmens, cl terminé
par deux appendices ou nageoires, en spalule.
La seconde division générale des branchiopodes lophyropes,
celle où le test est formé de deux valves, réunies par une
charnière (nos OSTHACODES OU l'ordre des ostrapodes de
M. Straus), se compose de deux sous-genres, dont le premier,
celui de cythérée, nous parait, dépuis les belles recherches de
ce savant sur le second, celui de cypris, solliciter, pour que
ses caractères ne soient plus équivoques, une étude plus approfondie
que celle qu'en a faite Müller, notre unique garant
à cet égard. Suivant lui,
LES CYTHÉREES
(CYTHERE. Müll. — Cythcrina. Lam.)
Auraient hui t pieds (1) s imples et finissant en pointe ; et deux antennes,
pareillement simples, sétacées, composées de cinq à six articles, avec des
poils épars.
On les trouve dans les eaux salées et saumâtres des bords de la mer,
parmi les varecs et les conferves. (2) •
(1) Il est probable qu'il n'y en a que six.
Voyez y ci-après, l'article cypris, note (i).
(2) Si ces entomosiracés sont uniquement
marins, il est naturel que Jurine et
d'autres observateurs, dont les recherches,
à raison des lieux de leur résidence, ne
pouvaient avoir pour objet que des entomostracés
d'eau douce, n'aient point parlé
des cythérées.
Voyez Millier, Entom., genre cythere,
et Desmar., Consid,, pag. 387 , 388 ,