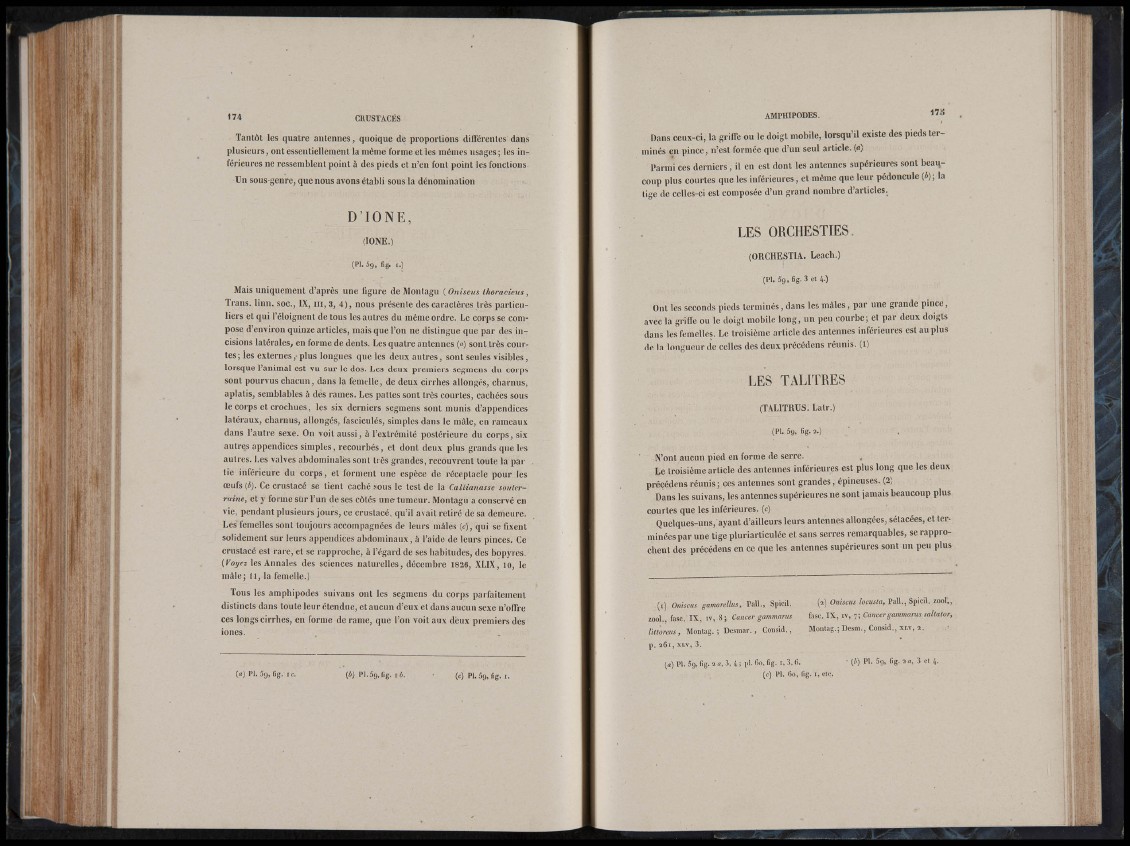
I î î^iJEe
H Iff
m
' 5
'ÎB
t
' 7 4 CRDSTACÉS
T a i i t ô l les quatre antennes, quoique de proportions différentes dans
p l u s i e u r s , ont e s sent iel lement la m ê m e forme et les môme s usages ; les inf
é r i e u r e s ne ressemblent point à des pieds et n 'en font point les fonctions.
TJn sous -genre, q u e nous avons é tabl i sous la dénomination
D ' I O N E ,
(lONE.)
(Pl. 59, fig. I.)
Mais uniquement d'après une figure de Montagu ( Oniscjis thoracicus ,
T r a n s , l inn, soc., IX, m , 3, 4 ) , nous présenle des caractères Irès parlicul
i e r s el qui l'éloignenl de tous les a u t r e s du même o rdre. Le coi-ps s e comp
o s e d'environ quinze art icles, mai s q u e l 'on ne distingue que p a r des inc
i s i o n s latérales, en forme d e dents. Les q u a t r e ant enne s (a) sont très court
e s ; les externes, - p lus longues que les deux aut res, sont seules visibles ,
l o r s q u e l 'animal est vu sur le dos. Les deux premiers segmens du corps
s o n t pourvus c h a c u n , dans la femel le, de deux cirrhes allong»>s, charnus,
a p l a t i s , semblables à des r ame s . Les pat tes sont très cour tes, cachées sous
l e corps et c rochue s , les six derniers segmens sont muni s d'appendices
l a t é r a u x , charnus, allongés, fasciculés, s imples d ans le mâle, en rameaux
d a n s l'autre sexe. On voit aus s i , à l 'ext rémi t é postérieure du corps, six
a u t r e s appendices simples, recourbés, et dont deux plus grands que lis
a u t r e s . Les valves abdomina l e s sont ti è s g r ande s , recouvrent toute la pai"
t i e inférieure du corps, et forment une espèce de réceptacle pour les
oe u f s {é). Ce c rus tacé se tient caché sous le test de la Catiianasse soi/lerruine,
et y forme sur l 'un de ses côtés u n e t ume u r . Montagu a consei 'vé en
vie, pendant plusieurs jour s , ce c rustacé. qu'il avait ret i r é do s a demeure.
Les femel les sont toujours a c compagné e s de leui-s mâles (c), qui se fixent
s o l i d e m e n t sur leurs appendices abdominaux, à l'aide de leur s pinces. Ce
c r u s t a c é est rare, et se r approche , à l 'égard d e ses h abi tude s , des bopyies.
{Voyez les Atmales des sciences naturelles, décembr e 1820, XLIX, 10, le
m â l e ; 11, la femelle.)
T o u s les amphipodes suivans ont les segmens du coi-ps parfaitement
d i s t i n c t s d ans toute l e u r é t endue , et a u c u n d'eux et d ans a u c u n sexe n'oil're
ces longs c i r r h e s , en forme de rame, que l'on voit aux deux premiers des
i o n e s .
(«) Pl. 5i|, li m fi. Si,. Cf. ib. w i'i.59,te.,.
AMPHIPODES, 17B
Dans ceux-ci , la griffe o u le doigt mobi le, lorsqu'il existe des p ieds term
i n é s en pince, n'est formée que d'un seul article, {a)
P a r m i ces d e rni e r s , il en est d o n t les ant enne s supérieures sont beaMc
o n p plus courtes que les inf é r i eur e s , el m ême que leur pédoncul e (i); la
l i g e d e celles-ci est compos é e d 'un g rand nombr e d'articles.
LES ORCHESTIES.
(ORCHESTIA. Leach.)
(Pl. 59, fig. 3 et 4.)
Ont les seconds pieds terminés, dans les ma l e s , p a r une grande pince,
avec la griffe o u le doigt mobi l e long, u n peu courbe; el p a r deux doigts
d a n s les femel les. Le t roisième article des antennes inférieures est a u plus
d e la longueur de celles des d e u x p r é c édens réunis. (1)
LES TALITRES
(TALITKUS. Latr.)
(Pl. 59, fig. 2.)
N ' o n t aucun pied e n forme de serre.
L e troisième a r t icl e des antennes inférieures est plus long que les deux
p r é c é d e n s r é u n i s ; ces ant enne s sont grandes, épineuses. (25
Dans les suivans, les a n t e n n e s s u p é r i e u r e s n e sont jamai s b e a u c o u p plus
c o u r t e s que les inféi-ieures. (c)
Q u e l q u e s - u n s , ayant d'ai l leurs l eur s ant enne s a l longées , sétacées, cl term
i n é e s p a r u n e tige p l u r i a r t i c u l é e et sans serres r ema rquabl e s , se rapproc
h e n t des précédens en ce q u e les antennes supérieures sont un p e u plus
[l) Oiiisms gnmai-clhis, Pali., Spicil.
zool.. fase. IX, IV, S; Cancer gammams
iittorem, Montag.; Desinar., Consid.,
p. 261,.XLV, 3.
(a) Ontsais hcmta, Pall., Spicil. zool.,
läse. IX, IV, 7; Cancergammants saltator,
Montag.; Desm., Consid., xr.v, 2.
(») Pl. 59, fig. 2 «, 3, 4 ; l'I. fi», fig. 1. 3, (i.
(c) I'l. fio, fig. I, ete.
• (i) PI. 5a, fig. ao. 3 ct 4.
h f -
t l