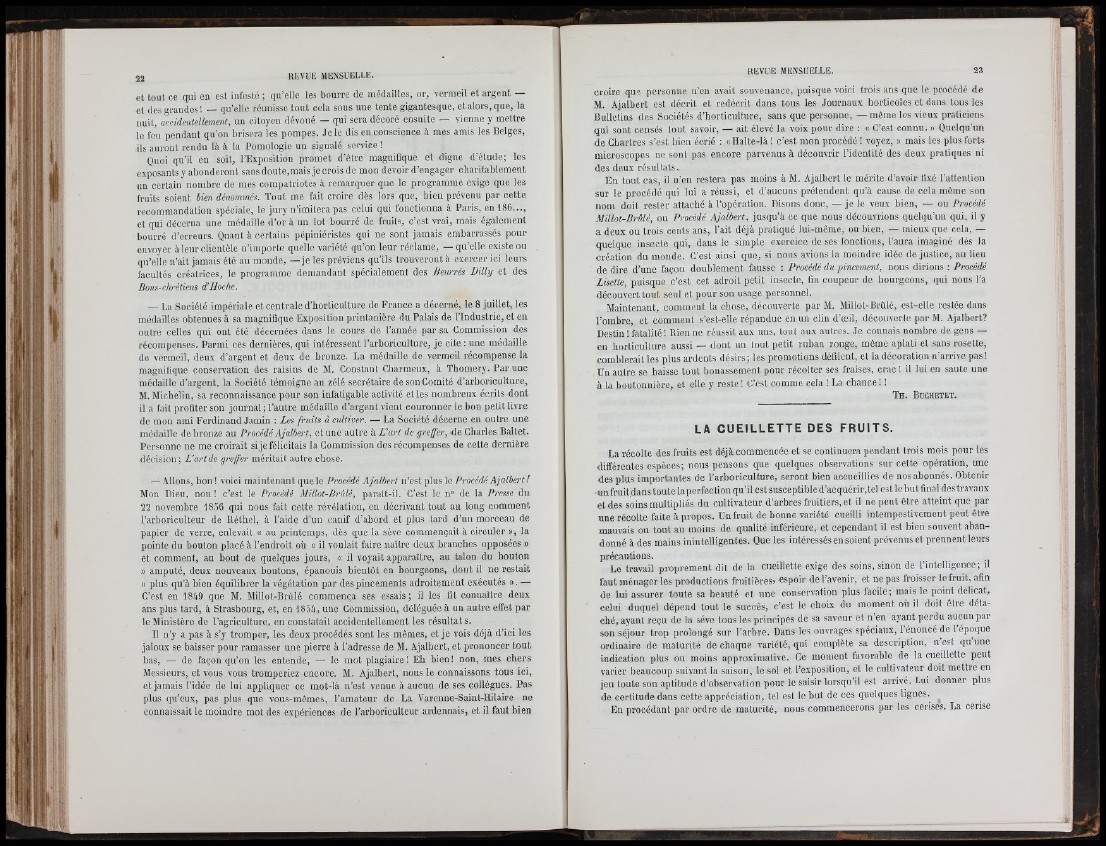
M :
r
| v
m ('V
(U ri.-;:
\Hi î;i f‘1 -,
^ V
I
1
ri' f r i
iI
I,
: -iri
■ I
; : I;;-
! f ü
i : Ü
v i r i
; ■ :.
|ri f;
et tout ce qui en est infesté ; q u ’elle les bourre de médailles, or, vermeil et a rg e n t —
et des grandes ! — q u ’elle réunisse to u t cela sous une lente gigantesque, et alors, q u e , la
n u it, accidentellement, un citoyen dévoué — qui sera décoré en su ite — vienne y m e ttre
le feu p en d an t q u ’on brisera les pompes. Je le dis en conscience à mes amis les Belges,
ils au ro n t ren d u là à la Pomologie un signalé service !
Quoi q u ’il en soit, l ’Exposition p rom e t d ’être magnifique e t digne d ’é tu d e ; les
exposants y abonderont sans d o u te ,m a is je crois dc mon devoir d ’engager ch arita b lem en t
un certain n ombre de mes compatriotes à rem a rq u e r que le p ro g ram m e o.vige que les
fruits soient bien dénommés. Tout me fait croire dès lors que, b ie n prévenu p a r c e tte
recommandation spéciale, le ju ry n ’imite ra pas celui qui fonctionna à Pa ris, en 1 8 6 ...,
e t qui décerna une médaille d ’or à un lot b o u rré de fruits, c ’est v ra i, mais également
b o u rré d ’erreurs. Quant à certains pépiniéristes qui ne sont jam a is embarrassés p o u r
envoyer à leur clientèle n ’importe quelle variété q u ’on le u r ré c lam e, — q u ’elle existe ou
q u ’elle n ’ait jamais été au monde, — je les préviens q u ’ils tro u v e ro n t à ex erce r ici leurs
facultés c ré atric es, le programme deman d an t spécialement des Beurrés Dilly e t des
Bons-chrétiens d’Hoche.
— La Société impériale e t c e n tra le d ’h o rticu ltu re de France a décerné, le 8 juillet, les
médailles obtenues à sa magnifique Exposition p rin tan iè re du Palais de l ’In d u s trie , et on
ou tre celles qui ont été décernées dans le cours de l’année p a r sa Commission des
récompenses. P a rm i ces dernières, qui in té re ssen t l ’a rb o ricu ltu re, je cite : une médaille
de vermeil, deux d ’a rg en t et deux de bronze. La médaille de vermeil récompense la
magnifique conservation des raisins de M. Constant Charmeux, à Thomery. P a r une
médaille d ’a rg en t, la Société témoigne au zélé secrétaire de son C omité d ’a rb o ricu ltu re ,
M. Michelin, sa reconnaissance p o u r son infatigable activité e lle s n om b reu x é crits dont
il a fait profite r son jo u rn a l ; l’au tre médaille d’a rg en t vient c o u ro n n e r le b o n p e tit livre
de mon ami F e rdinand Jam in : Les fru its à cultiver. — La Société décerne en outre une
médaille do b ronze au Procédé Ajalbert, et une au tre à L ’art de greffer, de Charles Baltet.
Pe rso n n e ne me c ro ira it si je félicitais la Commission des récompenses de cette de rniè re
décision ; L 'a r t de greffer m é rita it au tre chose.
— .Allons, bon ! voici m a in te n an t q u e le Procédé A jalbert n ’est plus le Procédé Ajalbert !
Mon Dieu, non ! c’est le Procédé Millot-Bridé, paraît-il. C’est le n» de la Presse du
2'2 novembre 1856 qui nous fait c elte révélation, en décrivant to u t au long com m en t
l’a rb o ricu lte u r de R éthel, à l’aide d ’un c anif d ’abord et plus ta rd d ’un m o rc e au de
papier de verre, enlevait « au p rin tem p s, dès que la sève commençait à c irc u le r », la
pointe du b outon placé à l ’en d ro it où « il voulait faire naitre deux branches opposées »
et comment, au b o u t de quelques jo u rs , « il voyait a pparaître , au talon du b o u to n
» amputé , deux nouveaux boutons, épanouis b ien tô t en bourgeons, d o n t il n e re s ta it
» plus q u ’à bien é q u ilib re r la végétation p a r des p incements a d ro item e n t exécutés », —
C’est en 1849 que M. Millot-Brûlé commença ses essais ; il les fil connaître deux
ans plus tard, à Strasbourg, et, en 1854, une Commission, déléguée à uu a u tre effet p a r
le Ministère de l ’a g ricu ltu re , en consta ta it a cc idente llement les ré s u lta ts .
Il n ’y a pas à s ’y trom p er, les .deux procédés sont les mêmes, et je vois déjà d ’ici les
jaloux se baisser p o u r ramasser une p ie rre à l’adresse de M. Ajalbert, e t p ro n o n c e r to u t
bas, — de façon q u ’on les e n ten d e, — le m o t plagiaire! Eh bien! non, mes c h e rs
Messieurs, e t vous vous tromperiez e ncore. M. Ajalbert, nous le connaissons tous ici,
e t jamais l ’idée de lui ap p liq u e r ce m o t-là n ’est venue à au cu n de ses collègues. Pas
plus qu’eux, pas plus que vous-mêmes, l ’am a teu r de La Varenne-Sainl-Hilaire ne
connaissait le moindre mot des expériences de l’a rb o ricu lteu r ardennais, et il faut b ien
c ro ire que perso n n e n ’en avait souvenance, puisque voici trois ans que le procédé de
M. A ja lbe rt e st d é c rit et red é crit dans tous les Jou rn au x horticoles et dans tous les
Bulletins des Sociétés d’h o rticu ltu re , sans que personne, — même les vieux praticiens
q u i sont censés to u t savoir, — ait élevé la voix p o u r d ire : « C’est co n n u . » Quelqu’un
d e Chartres s ’e st bien écrié : n Halte-là ! c ’est mon procédé ! voyez, » mais les plus forts
microscopes ne sont pas encore parvenus à découvrir l ’id en tité des deux p ra tiq u e s ni
de s deux ré su lta ts.
En to u t cas, il n ’en re stera pas moins à M. Ajalbert lo m é rite d ’avoir fixé l ’attention
su r le p ro c éd é qui lui a réussi, et d ’aucuns p ré ten d en t q u ’à cause de c ela même son
nom d o it re s te r attaché à l ’o p é ra tio n . Disons donc, — je le veux b ien, — ou Procédé
Millot-Brûlé, ou Procédé Ajalbert, ju sq u ’à ce que nous découvrions q u e lq u ’un qui, il y
a deux ou trois cents ans. Fait d é jà p ra tiq u é lui-même , ou bien, — mieux que cela, —
q u e lq u e in sec te qui, dans le simple exercice de ses fonctions, l ’a u ra imaginé dès la
c ré atio n du monde. C’est ainsi q u e , si nous avions la m o in d re idée de ju s tic e , au lieu
de d ire d’une façon d o u b lem en t fausse : Procédé du pincement, nous dirions : Procédé
Lisette, puisque c ’e st c et ad ro it p e tit insecte, fm cou p eu r de bo u rg eo n s, qui nous l ’a
découvert to u t seul et p o u r son usage personnel.
Maintenant, comment la chose, découverte p a r M. Millot-Brûlé, e st-elle restée dans
l ’ombre, et com m en t s ’est-elle rép an d u e en un clin d ’oeil, découverte p a r M. Ajalbert?
Destin ! fatalité ! Rien n e réu ssit aux uns, tout aux autres. Je connais n ombre de gens —
en h o rticu ltu re aussi — d o n t un to u t p e tit ru b an rouge, môme aplati et sans rosette,
com ble ra it les plus a rd en ts d é sirs; les p rom o tio n s défilent, et la d é co ratio n n ’arrive pas!
ü n a u tre se baisse to u t b onassement p our ré co lte r ses fraises, c ra c ! il lui en saute une
à la b o u to n n iè re , et elle y re s le ! C’e st comme cela ! La chanc e ! !
T h . B u c h e t e t .
LA CU E IL L E T T E DES FRUITS.
La récolte des fruits est déjà commencée e t se continuera p e n d an t tro is mois p o u r les
différentes espèces; nous pensons que quelques observations su r c ette opé ra tion, une
d e s plus im p o rtan te s de l ’a rb o ric u ltu re , sero n t bien accueillies de nos abo n n és. Obtenir
■unfruit dans to u te lap e rfe c tio n q u ’il est susceptible d ’a cq u é rir,te l est le b u t final destravaux
e t des soins multipliés du c u ltiv a teu r d ’a rbres fruitiers, et il ne p e u t ê tre a tte in t que p a r
u n e récolte faite à propos, ü n fru it de bonne variété cueilli in tem p e stiv em en t p e u t être
mauvais ou to u l au moins de q u a lité inférieure, et c ep en d an t il est bien souvent abandon
n é à des mains inin te llig en te s . Que les intéressés en soient prévenus e t p re n n en t leurs
précautions.
Le travail p ro p rem e n t d it de la cueillette exige des soins, sinon de l ’inte lligenc e; d
fau t ménager les pro d u c tio n s fruitiè re si espoir de l’avenir, et ne pas froisser le fruit, afin
de lui a ssu re r to u te sa beauté e t u n e conservation plus facile; mais le p o in t délicat,
c elui duquel d épend to u t le succès, c ’est le choix du m om en t où il d o it ê tre détac
h é, ayant re çu de la séve to u s les principes de sa saveur et n ’en ayant p e rd u aucun p a r
son séjour tro p prolongé su r l ’a rb re . Dans les ouvrages spéciaux, l ’énoncé de 1 époque
ord in a ire de m a tu rité de chaque v ariété, qui complète sa d e sc rip tio n , n est qu une
indic a tion plus ou moins approximative. Ce moment favorable de la cueillette p e u t
v a rie r beaucoup suivant la saison, le sol et l’exposition, et le cultiva teur doit m e ttre en
jeu to u te son ap titu d e d ’observ atio n p o u r le saisir lo rsq u ’il est arrivé. Lui d o n n e r plus
d e c e rtitu d e dans c ette a p p ré c ia tio n , tel est le b u t de ces quelques lignes. ^
En p ro c éd an t p a r o rd re de m a tu rité , nous commencerons p a r les cerises. La cerise