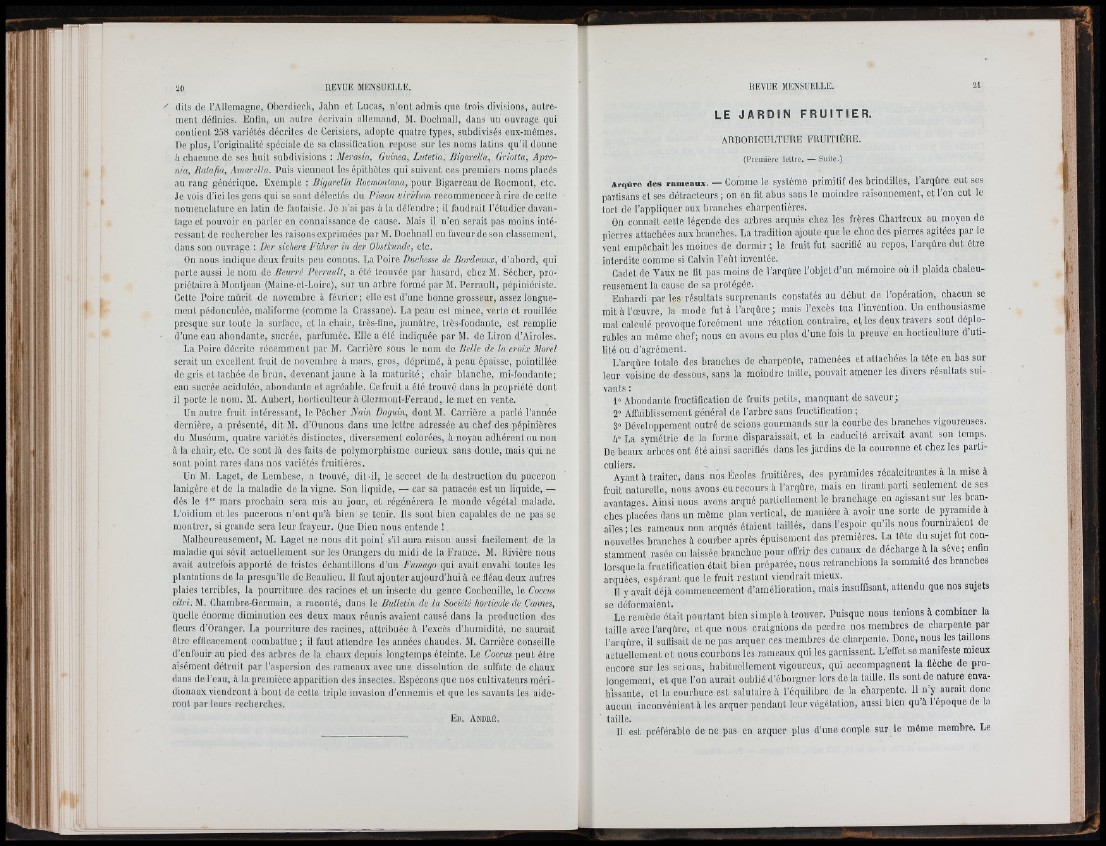
î]
y
' dits de l ’Alleningne, Oberdieck, Jahn et Lucas, n ’ont admis que trois divisions, autrement
définies. Enfin, un aiilro écrivain .nllcraand, M. Doclinall, dans uu ouvrage qui
contient 258 variétés décrites de Cerisiers, adopte quatre types, subdivisés eux-mêmes.
])c plus, l’originalité spéciale de sa classification repose sur les noms latins q u ’il donne
à chacune de ses h u it subdivisions : Merasia, Guinea, Lutetia, liigarella, Griotta, Apronta,
Ratafia, Amarella. Puis viennent les épitliôles qui suivent ces premiers noms placés
au rang générique. Exemple : Rigaretla Rocmontana, pour Bigarreau de Rocmout, etc.
Je vois d’ici les gens qui so sont délectés du Pisum viridum recommencer à rire de cette
nomenclature en latin de fantaisie. Je n ’ai pas à la défendre ; il faudrait I’c tudler d.avan-
tage et pouvoir en p a rle r en connaissance do cause. Mais il n ’en serait pas moins in té ressant
de rocberclier les raisons exprimées p a r M. Dochnall on faveur de son classement,
dans son ouvrage : Der sichere Führer in der Obslkunde, etc.
On nous indique deux fruits pou connus. La Poire Duchesse de Bordeaux, d ’abord, qui
porto aussi le nom de Beurré Perrault, a été trouvée par ha sa rd, chez M. Sécher, p ro priétaire
à Monljean (Mainc-ot-Loirc), sur un a rb re formé p a r M. P e rrau lt, pépiniériste.
Cette Poire m û rit do novembre à fév rie r; elle est d ’une bonne grosseur, assez iongue-
mcnt pédonculée, maliforme (comme la Crassane). La peau est mince, verte et rouillée
presque su r toute la surface, et la chair, très-fine, jaunâtre, très-fondante, est remplie
d ’une eau abondante, sucrée, parfumée. Elle a été indiquée p a r M. do Liron d ’Airoles.
La Poire décrite ré c em m en t par M. Carrière sous le nom de Belle de la croix Morel
serait nn excellent fruit de novembre à mars, gros, déprimé, à peau épaisse, pointillée
de gris et tachée de b run, devenant jaune à la m a tu rité ; chair blanche, mi-fondante;
eau sucrée acidulée, abondante et agréable. Ce fruit a été trouvé dans la propriété dont
il porto le nom. M. Aubcrt, h o rticu lteu r à Clermont-Ferrand, le m e t en vente.
Un autre fruit intéressant, le Pêcher Nain Daguin, dont M. Carrière a parié l ’année
de rn iè re , a présenté, dit M. d ’Ounous dans une le ttre adressée au chef des pépinières
du Muséum, quatre variétés distinctes, diversement colorées, à noyau ad h éren t ou non
à la chair, etc. Ce sont là des faits de polymorphisme curieux sans doute, mais qui no
sont point rares dans nos variétés fruitières.
Un M. Läget, de Lembeso, a trouvé, d it-il, le secret de la de stru ctio n du puceron
lanigère et de la maladie do la vigne. Son liquide, — car sa panacée est un liquide, —
dès le 1 " mars prochain sera mis au jo u r, et régénérera le monde végétal malade.
L’oïdium et les pucerons n ’ont q u ’à bien se tenir. Ils sont bien capables de ne pas sc
m o n trer, si grande sera leur fr.ayeur. Que Dieu nous entende !
Malheureusement, M. Läget ne nous d it point s’il aura raison aussi facilement de la
maladie qui sévit actuellement sur les Orangers du midi de la France. M. Rivière nous
avait autrefois apporté de tristes échantillons d ’un Fumago qui avait envalii toutes les
plantations de la presqu’île de B eaulieu. Il faut a jo u te r aujourd’hui à c eilé a u d e u x autres
plaies terribles, la p o u rritu re des racines et un inSecte du genre Cochenille, le Coccus
citri. M. Chambre-Germain, a raconté, dans le Bulletin de la Société horticole de Cannes,
quelle énorme diminulion ces deux maux réunis avaient causé dans la production des
fleurs d ’Oranger. La p o u rritu re des racines, attribuée à l’excès d ’humidité, ne saurait
être efficacement combattue ; il faut a tten d re les années chaudes. M. Carrière conseille
d ’enfouir au pied des a rbres de la chaux depuis longtemps éteinte. Le Coccus p e u t être
aisément d é tru it par l’aspersion des rameaux avec une dissolution de sulfate de chaux
dans de l'eau, à la première apparition des insectes. Espérons que nos cultivateurs m é ridionaux
viendront à bout do cette triple invasion d ’ennemis et que les savants les aidero
n t par leurs recherches.
E d . A n d r é .
LE JARDIN FRUITIER.
ARBORICULTURE FRUITIÈRE.
(Prcmici-e IcUrc. — S u ite .)
ArqûTc des rameaux. — Comme le système prim itif des brindilles, l’arqûre eu t ses
partisans et ses dé tra c teurs ; on on fit abus sans lo moindre raisonnement, et l’on eut le
to n do l ’appliquer aux liranchos cbarpenlières.
On connaît cette légende des arb re s arqués chez les frères Chartreux au moyen do
pierres attachées aux branches. La tradition ajoute que le choc des pierres agitées p a r le
vent empêchait les moines de d o rm ir; le fru it fut sacrifié au repos, l ’arqûro dut être
interdite comme si Calvin l ’eû t inventée.
Cadet do Vaux ne fit pas moins de l ’arqûro l’objet d ’un mémoire où il plaida chaleureusement
la cause de sa protégée.
Enhardi par les résultats surprenants constatés au début do l ’opération, chacun se
mit à l ’oeuvre, la mode fut à l ’a rq û r e ; mais l’excès tua l’invention. Un enthousiasme
mal calculé provoque forcément une réaction contraire, et les deux travers sont déplorables
au même ch ef; nous en avons eu plus d ’une fois la preuve en h o rticulture d ’utilité
ou d'.agrémont.
L’a rq û re totale des branches de oharpontc, ramonées et attachées la tê te en bas sur
leur voisine do dessous, sans la moindre taille, pouvait amener les divers résultats suivants
:
1» Abondante fructification de fruits petits, m anquant de s av eu r;
2" Affaiblissement général de l ’a rb re sans fructification ;
3« Développement outré de scions gourmands sur la courbe des branches vigoureuses.
h" La symétrie de la forme disparaissait, et la caducité arriva it avant son temps.
De beaux arbres ont été ainsi sacrifiés d.ans les jardins de la couronne et chez les pa rticuliers.
-
Ayant à tra ite r, dans nos Écoles fruitières, des pyramides récalcitrantes a la mise à
fruit naturelle, nous avons eu recours à l ’arqûrc, mais en tiran t pa rti seulement de ses
avantages. Ainsi nous avons arqué pa rlic llement lo branchage en agissant sur les b ra n ches
iilacées dans un même plan vertical, de manière à avoir une sorte de pyramide à
a ile s; les rameaux non arqués é ta ien t taillés, dans l’espoir q u ’ils nous fourniraient de
nouvelles branches à courbe r après épuisement des p remières. La tè te du sujet fut constamment
rasée ou laissée brancbue p our offrir des canaux de décharge à la séve; enfin
lorsque la fructifioation é ta it b ie n p réparée, nous retranchions la sommité des branches
arquées, espérant que lo fruit re s tan t viendrait mieux.
Il y avait déjà commencement d ’am é lio ra tio n , mais insuffisant, a ttendu que nos sujets
se déformaient. . ^ i ■ ,
Le i-oinède é ta it p o u rta n t bien sim p le h trouver. Puisque nous tenions à combiner la
taille avec l ’a rq û re , et que nous craignions de p e rd re nos membres de cliarponle par
l’a rq û re , il suffisait de ne pas a rq u e r ces membres de cliarpeiito. Donc, nous les taillons
a ctuellement o t nous courbons les rameaux qui les garnissent. L’effet se manifeste mieux
encore sur les scions, h ab itu e llem en t vigoureux, qui accompagnent la flèche de p ro longement,
e t que l ’on au ra it oublié d ’cb o rg n e r lors do la taille. Ils sont de nature envah
issante, et la courbure est salutaire à l’équilibre de la charpente. Il n ’y au ra it donc
aucun inconvénient à les a rquer pen d an t leur végétation, aussi bien qu à 1 époque de la
taille.
Il est préférable de ne pas en a rq u e r plus d ’une couple sur le même membre. Le
»'■
r ■ ,i
i l ’ Í