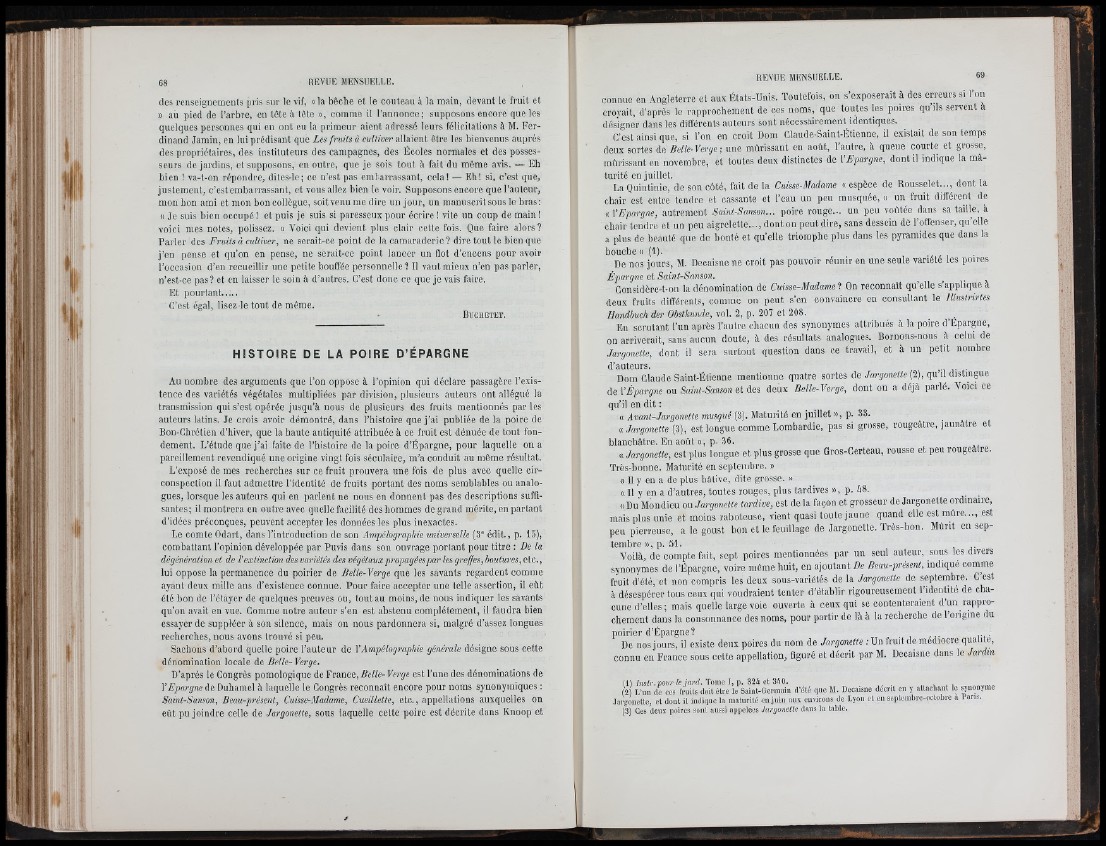
'¡Il
l i í
■l!
I
I r
des renseignements pris snr le vif, nia bêche et le couteau à la main, devant le fruit et
» au pied de l ’a rbre , en tête à lôte », comme il Tannonoe; supposons encore que les
quelques personnes qui en ont eu la prim eu r aient adressé leurs félicitations à M. F e rdinand
Jamin, en Ini prédisant que Les fruits ci cultiver allaient être les bienvenus auprès
des propriétaires, des instituteurs des campagnes, des Écoles normales et des possesseurs
de ja rd in s, et supposons, en outre, que je sois to u t à fait du même avis. — Eh
bien ! va-t-on répondre, dites-le; ce n ’est pas embarrassant, cela! — Eh! si, c ’est que,
ju s tem e n t, c’est embarrassant, et vous allez bien le voir. Supposons encore que l ’auteur,
mon bon ami et mon bon collègue, soit venu me dire un jo u r, un manuscrit sous le bras:
n J e suis bien occupé ! et puis je suis si paresseux pour écrire ! vile un coup de main !
voici mes notes, polissez. » Voici qui devient plus clair celte fois. Que faire a lo rs?
P a rle r des Fruits à cultiver, ne serait-oe p o in t de la cam araderie ? dire tout le bien que
j ’en pense et q u ’on en pense, ne serait-ce po in t lan c er un flot d ’encens pour avoir
l’occasion d’en recueillir une petite bouffée personnelle ? Il vaut m ieux n ’en pas p arler,
n ’est-oe pas? et en laisser le soin à d ’autres. C’est donc ce que je vais faire.
Et p o u rtan t.......
C’est égal, lisez le to u t de même.
BuCIlETIiT.
HISTOIRE DE LA POIRE D’EPARGNE
Au nombre de.s arguments que l’on oppose à l ’opinion qui déclare passagère l ’existence
des variétés végétales multipliées p a r division, plusieurs auteurs ont allégué la
transmission qui s’est opérée jusqu’à nous de plusieurs des fruits mentionnés par les
.auteurs latins. Je crois avoir démontré , dans l ’histoire que j ’ai publiée de la po ire de
Bon-Chrétien d’hiver, que la haute antiquité a ttrib u é e à ce fruit est dénuée de tout fondement.
L’étude que j ’ai faite de l ’histoire de la poire d ’Épargne, p o u r laquelle on a
pareillement revendiqué une origine vingt fois séculaire, m’a conduit au même résultat.
L’exposé de mes recherches su r cc fruit prouvera une fois de plus avec quelle circonspection
il faut admettre l’identité de fruits p o rta n t des noms semblables ou analogues,
lorsque les auteurs qui on p arlent ne nous en d o n n e n t pas des descriptions suffisantes
; il m o n trera en outre avec quelle facilité des hommes de grand mérile, en p a rtan t
d ’idées préconçues, peuvent accepter les données les plus inexactes.
Le comte Odart, dans l’introduction de son Ampélographie universelle (3 ' é d it., p. 15),
combatlanl l’opinion développée p a r Puvis dans son ouvrage p o rtan t pour titr e : De la
dégénération et de l’extinction des variétés des végétaux propagées par les greffes, boutures, e tc .,
lu i oppose la permanence du poirier de Delle-Verge que les savants reg a rd en t comme
ayant deux mille ans d ’existence comme. P o u r faire acc ep te r une telle assertion, il eût
été bon de l’éfayer de quelques preuves ou, tout au moins, de nous in d iq u e r les savants
qu'on avait en vue. Comme no tre au teu r s’en est abstenu complètement, i! fau d ra bien
essayer de suppléer à son silence, mais on nous pardonnera si, malgré d’assez longues
recherches, nous avons trouvé si peu.
Sachons d’abord quelle poire l’a u te u r de VAmpélographie générale désigne sous cette
dénomination locale de Belle-Verge.
D’après le Congrès pomologique de Yvimee,, Belle-Verge est l’une des dénominations de
VEpargne de Duhamel à laquelle le Congrès reconnaît encore pour noms synonymiques :
Saint-Sanson, Beau-présent, Cuisse-Madame, Cueillette, etc., appellations auxquelles on
eût pu jo in d re celle de Jargonette, sous laquelle celte poire est décrite dans Knoop et
connue en Angleterre el aux États-Unis. Toutefois, on s’exposerait à des erreurs si l’on
croyait, d’après le rapprochement de ces noms, que to u te s les poires qu’ils servent à
désigner dans les différents auteurs sont nécessairement identiques.
C’est ainsi que, si l’on en croit Dom Claude-Saint-Étienne, il existait de son temps
deux sortes de Belle-Verge; une mûrissant en août, l’autre, à queue courte et grosse,
mûrissant en novembre, et toutes deux distinctes de l’Epargne, dont il indique la raà-
iurité en juillet.
La Quintinie. de son côté, fait de la Cuisse-Madame a espèce de R ousselet..., dont la
chair est entre ten d re et cassante et l’eau un peu musquée, » un fruit différent de
aXEpargne, autrement Saint-Scmson... poire rouge... un peu voûtée dans sa taille, à
chair te n d re et un peu a ig re le tte ..., d o n t on peut d ire , sans dessein de l’offenser, qu ’elle
a plus de beauté que dc bonté et qu’elle triom p h e plus dans les pyramides que dans la
bouche » {!).
De nos jo u rs , M. Decaisne ne croit pas pouvoir réu n ir en une seule variété les poires
Épargne et Saint-Sanson,
Considère-t-on la dénomination de Cuisse-Madame ? On re co n n aît qu ’elle s applique à
deux fruits différents, comme on p eu t s’en convaincre en consultant le lllustrirtes
Handbuch der Obstkunde, vol. 2, p. 207 et 208.
En scru tan t l’un après l’autre chacun des synonymes a ttrib u é s à la poire d’Epargne,
on arriverait, sans aucun do u te , à des ré sulta ts analogues. Bornons-nous à celui de
Jargonette, dont il sera su rto u t question dans ce travail, et à un p e tit nombre
d’auteurs.
Dom Claude Saint-Étienne mentionne quatre sortes de Jargonette (2), qu il distingue
de l’.éparÿne ou Soe)ii-5anson et des deux Belle-Verge, dont on a déjà parlé. Voici ce
qu’il en d it :
« Avant-Jargonette musqué (3). Maturité on ju ille t », p. 33.
« Jargonette li) , est longue comme Lombardie, pas si grosse, rougeâtre, jau n â tre et
b lan ch âtre. En août », p. 36.
« Jargonette, est plus longue et plus grosse que Gros-Cerleau, rousse et peu rougeâtre.
Très-bonne. Maturité en septembre. »
(( Il y en a de plus hâtive, dite grosse. »
(I II y en a d ’a u tre s, to u te s rouges, plus tardives », p. 48.
« Du Mondieu ou Jargonette tardive, est de la façon et grosseur de J argonette ordinaire,
mais plus unie et moins raboteuse, vient quasi toute ja u n e quand elle est m û re ..., est
peu pierreuse, a le goust bon e t le feuillage de J arg o n ette. Très-bon. Mûrit en septembre
», p. 51.
Voilà, de compte fait, s ep t poires mentionnées p a r un seul auteur, sous les divers
synonymes de l’Épargne, voire même h u it, en a joutant De Beau-présent, indiqué comme
fruit d’été, et non compris les deux sous-variétés de la Jargonette de septembre. C’est
à désespérer tous ceux qui voudraient te n te r d ’établir rigoureusement l’identité de chacune
d ’e lle s; mais quelle large voie ouverte à ceux qui se contenteraient d ’un rapprochem
ent dans la consonnance des noms, pour p a rtir de là à la recherche de l ’origme du
p o irie r d ’Épargne?
De nos jours, il existe deux poires du nom de Jargonette ;U n fruit de médiocre qualité,
connu en France sous cette appellation, figuré et décrit par M. Decaisne dans le Jardin
(1) Insi)'. pour le jard. Tome I, p . 324 e t 3 40.
(2) L ’un de ces fruits doit ê tre le S a in t-G e rm a in d ’été q u e M. Decaisne d é c rit e n y a tta c h a n t le synonyme
J a rg o n e tte , e t do n t il in d iq u e la m a tu rité on ju in au x environs de Lyon et en se p tem b re -o c to b re a 1 a n s .
(3) Ces deux poires seul aussi appelées Jargonette dans la tab le.