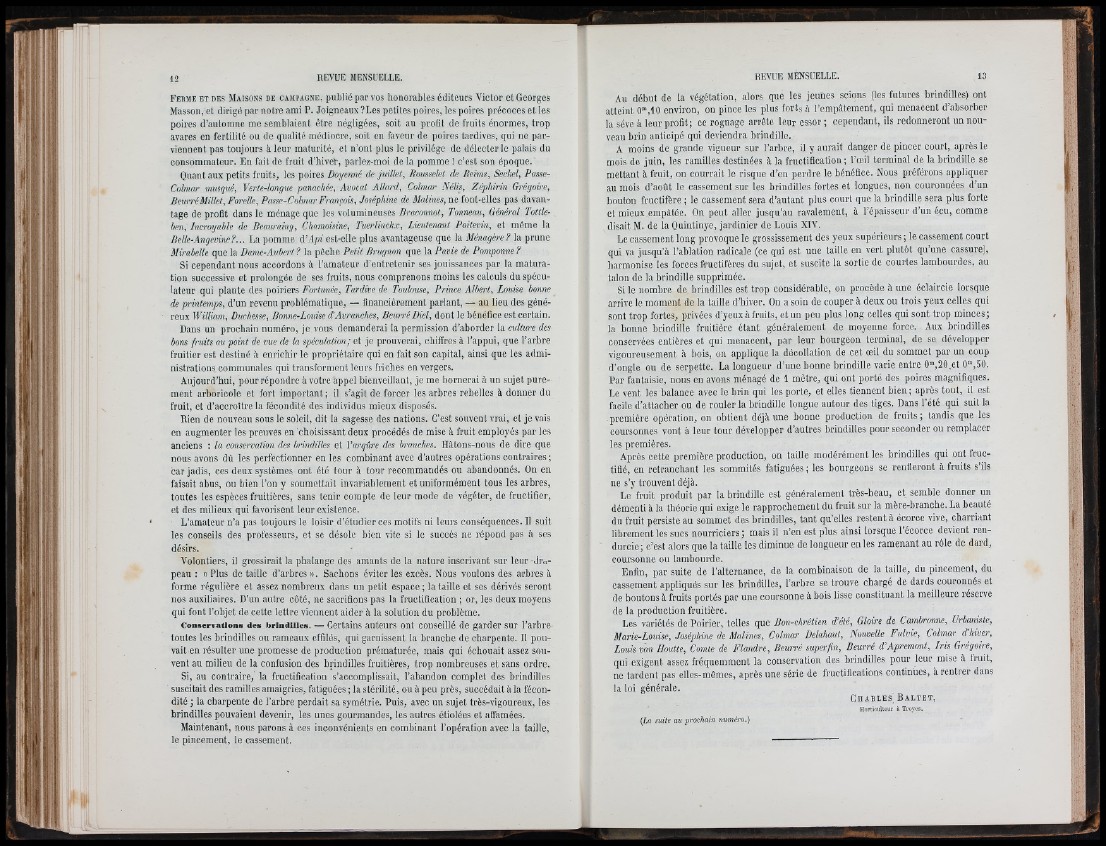
>
■!
Il i
, i
Ui
i l
F e rm e e t d e s M a i s o n s d e c am p a g n e , publié par vos honorables éditeurs Victor et Georges
Masson, et dirigé p.ir n otre ami P. Joigneaux?Les petites poires, les poires précoces et les
poires d ’aulomne me semblaient être négligées, soit au profit de fruits énormes, trop
avares en fertilité ou de qualité médiocre, soit en faveur de poires tardives, qui ne p a rviennent
pas toujours à leur m.iturité, e t n ’ont plus le privilège de délecter le palais du
consommateur. En fait de fruit d ’hiver, parlez-moi de la pomme ! c’est son époque.
Qu.ant aux petits fruits, les poires Boi/enné de juillet, Rousselet de Reims, Seckel, Passe-
Colmnr musqué, Verte-longue panachée. Avocat Allard, Colmar Nélis, Zéphirin Grégoire,
Beurré Millet, Forelle, Passe-Colmar François, Joséphine de Malines, ne font-elles pas davantage
de profit dans le ménage que les volumineuses Braeonnot, Tonneau, Gcnè-al Tottleben,
Incroyable de Beanraing, Chamoisine, Tuerlinckx, Lieutenant Poitevin, e t même la
Belle-Angevine?... La pomme est-elle plus avantageuse que la Ménagère? la prune
Mirabelle que la Dame-Aubert ? la pêche Petit Brugnon que la Pavie de Pomponne ?
Si cependant nous accordons à l ’amateur d ’e n tre te n ir ses jouissances p a r la m a tu ra tion
successive et prolongée de ses fruits, nous comprenons moins les calculs du spéculateur
qui plante des poiriers Fortunée, Tardive de Toulouse, Prince Albert, Louise bonne
de printemjos, d ’un revenu problématique, — financièrement parlant, — au lieu des généreux
William, Duchesse, Bonne-Louise d’Avranches, Beurré Diel, dont le bénéfice est certain.
Dans un prochain numéro, je vous demanderai la permission d’aborde r la eidture des
bons fruits au point de vue de la spéculation; et je prouverai, chiffres à l’appui, que l’arbre
fruitier est destiné à enrichir le p ropriétaire qui en fait son capital, ainsi que les administrations
communales qui transforment leurs friches en vergers.
Aujourd’hui, pour répondre à votre appel bienveillant, je me bornerai à un sujet p u re ment
arboricole et fort im p o rtan t; il s’agit de forcer les arb re s rebelles à donner du
fruit, et d ’accroître la fécondité des individus mieux disposés.
Rien de nouveau sous le soleil, dit la sagesse des nations. C’est souvent vrai, et je v.ais
en augmenter les preuves en choisissant deux procédés de mise à fruit employés p a r les
anciens : la conservation des brindilles et Varqûre des bronches. Hâtons-nous de dire que
nous avons dû les perfectionner en les combinant avec d ’autres opérations contraires ;
car jadis, ces deux systèmes ont été four à to u r recommandés ou abandonnés. On en
faisait abus, ou bien l’on y soumettait invariablement et uniformément tous les arbres,
toutes les espèces fruitières, sans ten ir compte de leur mode de végéter, de fructifier,
et des milieux qui favorisent leur existence.
L’amateur n ’a pas toujours le loisir d ’é ludier ces motifs ni leurs conséquences. Il suit
les conseils des professeurs, e t se désole bien vite si le succès ne répond pas à ses
désirs.
Volontiers, il grossirait la phalange des amants de la nature inscrivant sur leur drapeau
: « Plus de taille d ’arbres ». Sachons éviter les excès. Nous voulons des arbres à
forme régulière et assez nombreux dans un pe tit espace ; la taille et ses dérivés seront
nos auxiliaires. D’un autre côté, ne sacrifions pas la fructification ; or, les deux moyens
qui font l’objet de cette le ttre viennent aide r à la solution du problème.
Conservations des brindilles. — Certains auteurs ont conseillé de garder sur l ’arbre
toutes les brindilles ou rameaux effilés, qui garnissent la branche de charpente. II pouvait
en résulter une promesse de production prématurée, mais qui échouait assez souvent
au milieu de la confusion des brindilles fruitières, tro p nombreuses et sans ordre.
Si, au co n tra ire ,’ la fructification s’accomplissait, l’abandon complet des brindilles
suscitait des ramilles amaigries, fatiguées ; la stérilité, ou ci peu près, succédait à la fécondité
; la charpente de l ’arb re perdait sa symétrie. Puis, avec un sujet très-vigoureux, les
brindilles pouvaient devenir, les unes gourmandes, les autres étiolées et afi'amées.
Maintenant, nous parons à ces inconvénients en combinant l ’opération avec la taille,
le pincement, le cassement.
Au début de la végétation, alors que les jeunes scions (les futures brindilles) ont
atteint 0” ,lü environ, on pince les plus forts à l ’empâtement, qui menacent d’absorber
la séve â leur profit; ce rognage arrête le u r essor ; cependant, ils redonneront un nouveau
b rin anticipé qui deviendra brindille.
A moins de grande vigueur sur l ’arbre, il y aurait danger de pincer court, après le
mois de ju in , les ramilles destinées à la fructification ; l ’oeil terminal de la brin d ille se
mettant à fruit, on courrait le risque d ’on p e rd re le bénéfice. Nous préférons appliquer
au mois d ’août le cassement sur les brindilles fortes e t longues, non couronnées d’un
bouton fructifère ; le cassement sera d ’autant plus court que la brindille sera plus forte
et mieux empâtée. On peut aller ju sq u ’au ravalement, â l’épaisseur d’un écu, comme
disait iM. de la Quintinye, ja rd in ie r de Louis XIV.
Le cassement long provoque le grossissement des yeux supérieurs ; le cassement court
qui va ju sq u ’à l ’ablation radicale (ce qui est une taille en vert p lu tô t qu’une cassure),
liarmonise les forces fructifères du sujet, et suscite la sortie de courtes lambourdes, au
talon de la brindille supprimée.
Si le nombre de brindilles est tro p considérable, on procède à une éclaircie lorsque
arrive le moment de la taille d’hiver. On a soin de couper à deux ou tro is yeux celles qui
sont tro p fortes, privées d ’yeux à fruits, e tu ii peu plus long celles qui sont trop minces;
la bonne brindille fruitière étant généralement de moyenne force. Aux brindilles
conservées entières et qui menacent, p a r leur bourgeon terminal, de se développer
vigoureusement à bois, on applique la décollation de c et oeil du sommet p a r un coup
d ’ongle ou de serpette. La longueur d ’une bonne brindille varie en tre 0»,20,et 0“ ,50.
P a r fantaisie, nous en avons ménagé de 1 mètre, qui ont p o rté des poires magnifiques.
Le vent les balance avec le brin qui les porte, et elles tiennent b ien ; après to u t, il est
facile d’a tta ch e r ou de rouler la brindille longue autour des tiges. Dans l ’été qui suit la
-première opération, on o btient déjà une bonne production de fru its ; tandis que les
coursonnes vont à leu r to u r développer d’autres brindilles pour seconder ou remplacer
les premières.
Après cette première production, on taille modérément les brindilles qui ont fruc-
tifié, en re tranchant les sommités fatiguées ; les bourgeons se renfleront à fruits s ’ils
ne s ’y trouvent déjà.
Le fruit p ro d u it p a r la brindille est généralement très-beau, et semble donner un
démenti à la théorie qui exige le rapprochement du fruit sur la mère-branche. La beauté
du fruit persiste au sommet des brindilles, tan t qu ’elles re sten t à écorce vive, charriant
librement les sucs nourriciers ; mais il n ’en est plus ainsi lorsque l ’écorce devient ren-
d u rc ie ; c ’est alors que la taille les diminue de longueur en les ramenant au rôle de dard,
coursonne ou lambourde.
Enfin, par suite de l’alternance, de la combinaison de la taille, du pincement, du
cassement appliqués sur les brindilles, l ’a rb re se trouve chargé de dards couronnés et
de boutons à fruits portés par une coursonne à bois lisse constituant la meilleure réserve
de la production fruitière.
Les variétés de Poirier, telles que Bon-chrétien d'été, Gloire de Cambronne, Urbaniste,
Marie-Louise, Joséphine de Malines, Colmar Delahaut, Nouvelle Fulvie, Colmar d hiver,
Louis van Houtle, Comte de Flandre, Beurré superfin. Beurré d'Apremont, Iris Grégoire,
qui exigent assez fréquemment la conservation des brindilles pour leur mise à fruit,
ne la rd en t pas elles-mêmes, après une série de fructifications continues, à ren tre r dans
la loi générale.
C d a h l e s ) B a l t e t ,
H o rtifiulteur à Troyes.
{La suite au prochain numéro.)