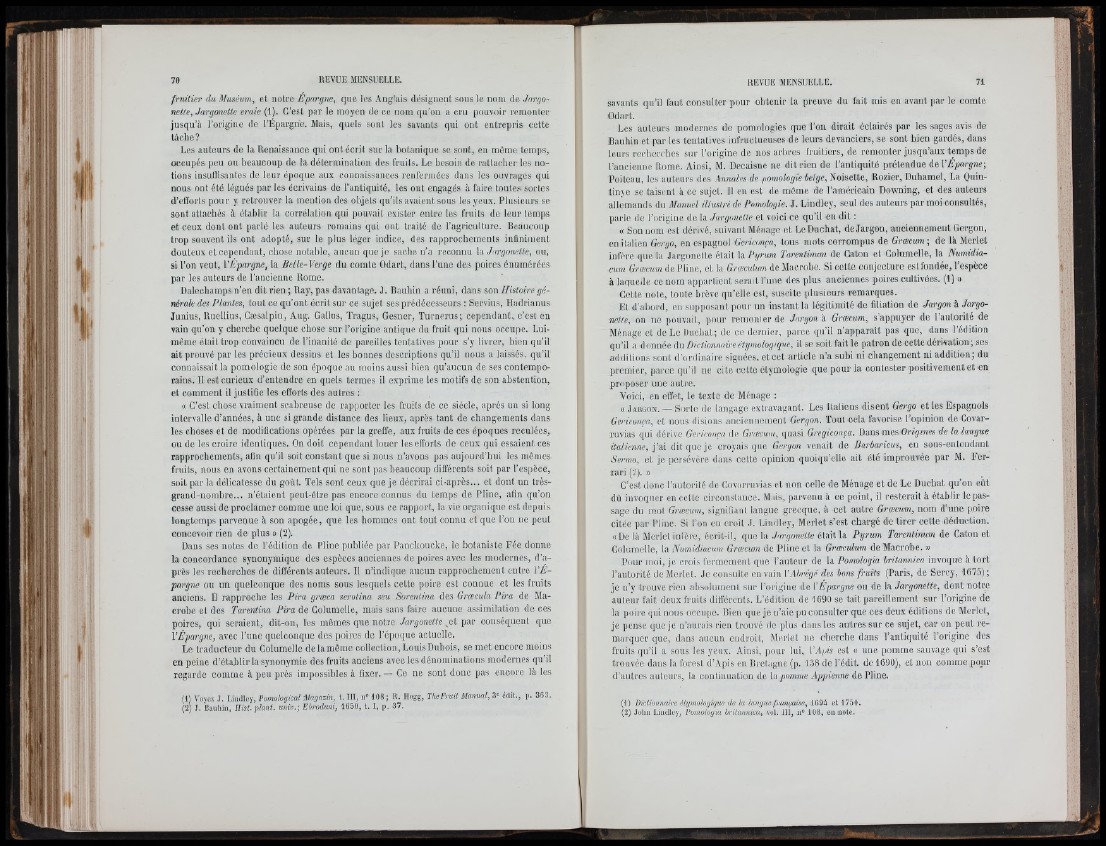
f
fruitier du Muséum, et notre Epargne, que les Anglais tlésigiicnl sons le nom de Jargonette,
Jargonette vraie (1). C’est par le moyen de ce nom q u ’on a cru pouvoir remonter
ju sq u ’à l’origine de TÉpargno. Mais, quels sont les savants qui ont entrepris cette
tâche ?
Les auteurs de la Uenaissanoo qui ont écrit sur la botanique se sont, en même temps,
occupés peu ou beaucoup de la déterniination des fruits. Le besoin de rattacher les notions
insudisantes de leu r époque aux connaissances renfermées dans les ouvrages qui
nous ont été légués par les écrivains de l’antiquité, les ont engagés à faire toutes sortes
d ’eiîorts p o u r y retrouver la mention des objets qu ’ils avaient sous les yeux. Plusieurs se
sont attachés à établir la corrélation qui pouvait exister entre les fruits de leur lemps
et ceux dont ont parlé les auteurs romains qui ont traité de rag ricu llu re. Beaucoup
trop souvent ils ont adopté, sur le plus léger indice, des rapprochcmenis intioiinent
douteux el cependant, chose notable, aucun q u e je sache n’a reconnu la Jargonette, ou,
si l ’on veut, VEpargne, la Belle-Verge du comte Odart, dans l ’une des poires énumérées
par les auteurs de l ’ancienne Rome.
Dalecbamps n’en dit rie n ; Ray, pas davantage. J. Baubin a réuni, dans son Histoire générale
des Plantes, tout ce qu’ont écril sur ce sujet ses prédécesseurs : Servius, ITadrianus
Jiiiüus, Ruellius, Cæsalpin, Aug. Galliis, Tragus, Gesner, T u rn eru s; c ependant, c’est en
vain q u ’on y cherche quelque chose sur l’origine antique du fruit qui nous occupe. Lui-
môme était trop convaincu de l’inanité de pareilles tentatives pour s’y livrer, bien qu’il
ait prouvé par les précieux dessins et les bonnes descriptions q u ’il nous a laissés, q u ’il
connaissait la pomologie dc son époque au moins aussi bien qu’aucun de ses contemporains.
Il est curieux d’entendre en quels termes il exprime les motifs de son abstention,
et comment il justifie les efforts des autres :
« C’est chose vraiment scabreuse de rapporter les fruils de ce siècle, après un si long-
intervalle d ’années, à une si grande distance des lieux, après k n l de changements dans
les choses e t de modifications opérées par la grefl'e, .aux fruils de ces époques reculées,
ou dc les croire identiques. On doit cependant louer les efl’orts de ceux qui essaient ces
rapprochements, afin qu’il soit constant que si nous n ’avons pas a ujourd’hui les mômes
fruils, nous en avons certainement qui no sont pas beaucoup différents soit par l’espèce,
soit par la délicatesse du goût. Tels sont ceux que je décrirai ci-<après... el dont un très-
grand-nombre... n ’étaient peut-être pas encore connus du lemps de Pline, afin qu’on
cesse aussi de proc lame r comme une loi que, sous ce rapport, la vie organique est depuis
longtemps parvenue à son apogée, que les hommes ont tout connu el que l’on ne peut
concevoir rien de plus » (2).
Dans ses notes do l ’édition do Pline publiée par Panckoucke, lo botaniste Fée donne
la concordance synonymique des espèces anciennes de poires avec les modernes, d ’après
les re cherche s dc différents auteurs. Il n ’indique aucun rapprochement entre \ ’È -
pargne ou un quelconque des noms sous lesquels cette poire est connue ot les fruits
anciens. R rapproche les Pira græca serótina seu Sorenlina des Groecula Pira dc Ma-
crobc et des Tarentina Pira de Columelle, mais sans faire aucune assimilation dc ces
poires, qui seraient, dit-on, les mêmes que notre Jargonette _el par conséquent que
l’Épargne, avec l ’une quelconque des poires de Tcpoque aclucllo.
Lo traduc teur du Columelle de la même collection, Louis Dubois, se met encore moins
en peine d ’é ta b lir la synonymie des fruits anciens avec les dénominations modernes qu’il
regarde comme à pou près impossibles à fixer. — Ce ne sont donc pas encore là les
(1) Voyez .T. U iid lc y , Pomological Matjazin, t. III, ii” 1 0 8 ; It. Hogg, TheFruit Manual, 3“ éctit., p. 3 0 3 .
(2) J . Bauliin, Ilist. plant. Univ.; Ehroduni, 1 6 5 0 , t . I , p, 37.
savants qu ’il faut consulter pour obtenir la preuve du fait mis en avant par le comte
Odart.
Lcs auteurs modernes de pomologies que l’on d ira it éclairés par les sages avis de
Baubin et par les tentatives infruetncuses de leurs devanciers, se sont bien gardés, dans
leurs recherches sur l’origine dc nos arlires fruiliers, de rem o n te r jusqu'aux temps de
l’ancieuiie Rome. Ainsi, M. Decaisne ne d it rien de l’antiquité prétendue àeV Épargne-,
Poileau, les auteurs des Annales de pomologie belge. Noisette, Rozier, Duhamel, La Quiii-
tiiije sc taisent à ce sujet. Il en est de même de l ’américain Downing, et des auteurs
allemands dn Manuel illustré de Pomologie. J . Lindley, seul des auteurs p a r moi consultés,
parle de Torigine de la Jargmette el voici ce q u ’il en dit :
« Son nom est dérivé, suivant Ménage et LoDuchat, de Jargon, anciennement Gergon,
en italien Gergo, en espagnol Geriamça, tous mots corrompus de Groecum; de là Merlet
infère que la Jargonelle élait la Pgrum Tarentinam de Caton e t Columelle, la Nurmdia-
cum Groecum de Pline, el la Groecutum de Macrobo. Si celle conjecture est fondée, Tcspèce
à laque,le ce nom apparlienl serait Tniie des plus anciennes poires cultivées. (1) i>
Celte note, loiile brève q u ’elle est, suscite plusieurs remarques.
El d ’abord, en supposant poiii- un instant la légitimité de filiation de Jargon à Jargonelle,
on ne pouvait, pour renioiiler de Jargon à Groecum, s’appuyer de Taulorité de
Ménage et de Le lluchal; de ce dernier, parce qu’il n ’apparaît pas que, dans l ’édition
q u ’il a donnée du Dictionnaire étymologique, il se soit fait le patron de cette dérivation ; ses
additions sont d'o rd in a ire signées, e le c t article n ’a subi ni ohangemciit ni ad d itio n ; du
p remier, pai ce qu’il ne cite celte étymologie que pour la co ntester positivement e t on
proposer une autre.
Voici, en effet, le texte de Ménage ;
« Jahuon. — Sorte de langage extravagant. Les Italiens d isen t Gergo et les Espagnols
Gerironçn,^ et nous disions ancicnneuicnt Gergon. Tout cela favorise 1 opinion de Covar-
ruvias (pii dérive Gericonça ùo Gnecum, ipiasi Gregiconça. Dans mes Origiiies de la langue
italienne.^ j ’ai dit (pic je croyais (jiic Gergon venait de Bai'baricuSy eu sous-entendant
6Vrmo, et je persévère dans cette opinion quoic{u’elle a it été improuvée p a r iM. Ferra
ri (*i). »
C’est donc l’autorité de Cov;irruvias et non celle de Ménage et dc Le Ducliat qu’on eût
dû invoquer en cette circonstance. Mais, parvenu à ce point, il re sterait à établir le passage
du mot Groecum, signiiianl langue greccpie, à c et autre Groecum, nom d’une poire
citée par Pline. Si Ton en croit J. Lindley, Merlet s’est chargé de tirer cette déduction.
«De là Merlet inlère, écrit-il, que la Jargonelle élait la P yrum Tarentinum de Caton et
Columelle, la Numidiacmn Gnecum de Pline el la Groeculum de Macrobe, »
Pour moi, je croi.s l’ermeineut que l’au teu r de la Pomología britannica invoque à to rt
Taulorité dc Meilcl. Je consulte en vain l'Abrégé des bons fruits (Paris, do Sercy, 1675) ;
je n’y trouve rien absolument sur Torigine dc Epargne ou de la Jargonette, dont notre
auleui- fait deux fruits dill’ércnts. L’édition de 16911 se tait pareillement sur Torigine de
la poire qui nous occupe. Rica que je u ’aie pu consulter que ces deux éditions de Merlet,
je pense que je iTaurais rien trouvé de plus dans les autres sur ce sujet, car on peut rè -
inarquor que, dans aucun endroit, Merlet ne cherche dans Tanliquité Torigine des
fruils q u ’il a sous les yeux. Ainsi, pour lui, VApis est « une pomme sauvage qui s ’est
trouvée dans la foresl d ’Apis en Bretagne (p. 138 dc Tédit. de 109Ü), et non comme pour
d ’autres autours, la continuation dc la pomme Appienne de Pline.
(1) Didionnaire étymologique de la langue française, ’1694 e t 1 7 5 0 .
(2) Jo h n Liiulley, Pomología briianniea, vol. 111, n° 1 0 8 , en n ote.