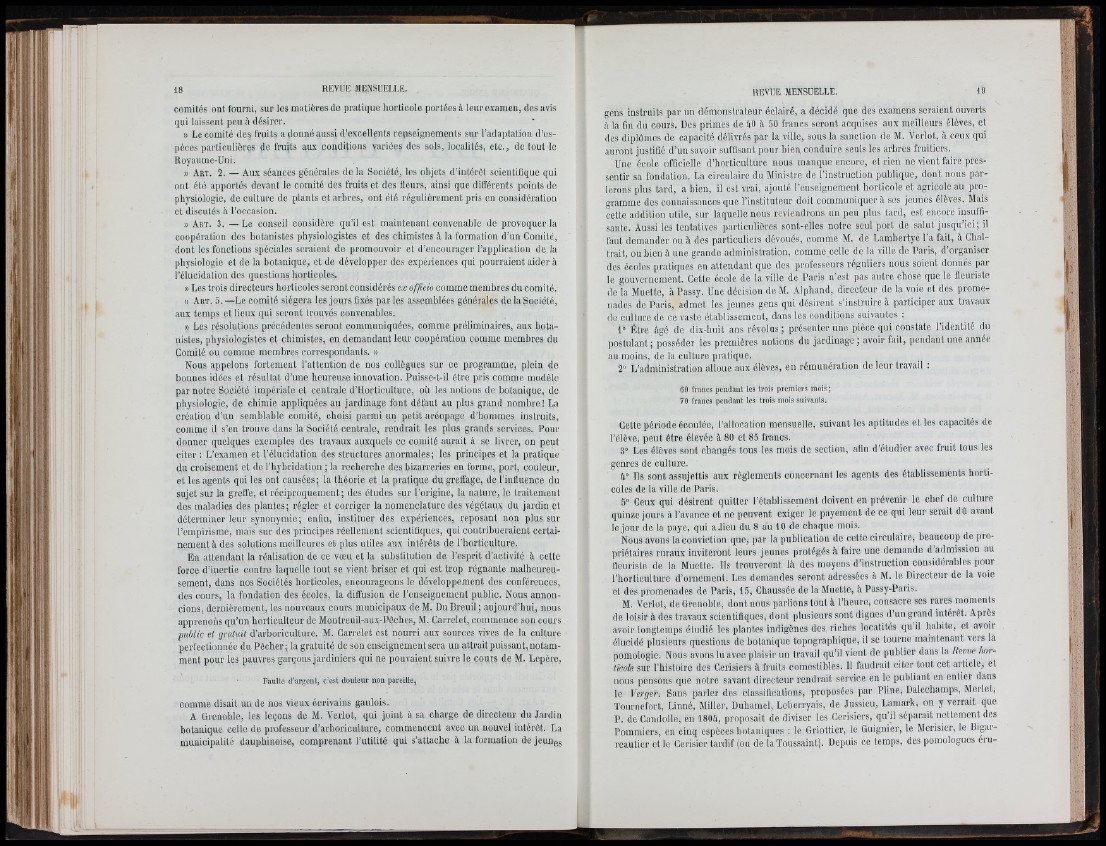
comités ont fourni, sur les m.itières de p ra tique horticole portées à leur examen, des avis
qui laissent peu à désirer.
» Le comité des fruits a (ionné aussi d ’excellents repseignements sur l’adaptation d ’espèces
particulières de fruils aux conditions variées des sols, localités, e tc ., de tout le
Royaume-Uni.
» Art. 2. — Aux séances générales de la Société, les objets d ’inlérét scientifique qui
on t été apportés devant le comité des fruits et des fleurs, ainsi que différents points de
pliysiologio, de culture de plants et a rbres, o n t été régulièrement pris en considération
et discutés à l ’occasion.
» Art. 3. — Le conseil considère q u ’il est m aintenant convenable de provoquer la
coopération des botanistes physiologistes e t des chimistes à la formation d ’un Comité,
dont les fonctions spéciales seraient de promouvoir et d ’encourager l ’application de la
physiologie e t de la botanique, et de développer des expériences qui p o urraient a id e r à
l’éluoidation des questions horticoles.
B Les trois directeurs horticoles seront considérés exofßcio comme m embres du comité.
8 Art. 5. —Le comité siégera les jours fixés p a rle s assemblées générales de la Société,
aux temps et lieux qui seront trouvés convenables.
» Les résolutions précédentes seront communiquées, comme préliminaires, aux botanistes,
physiologistes et chimistes, en demandant leur coopération comme membres du
Comité ou comme membres correspondants. »
Nous appelons fortem ent l ’a tten tio n de nos collègues sur ce programme, plein de
bonnes idées et ré sulta t d ’une heureuse innovation. Puisse-t-il ê tre pris comme modèle
pa r notre Société impériale et centrale d ’HorticuUure, où les notions de botanique, de
physiologie, de chimie appliquées au jardinage font défaut au plus grand nombre! La
création d ’un semblable comité, choisi p a rm i un p e tit aréopage d ’hommes instruits,
comme il s ’en trouve dans la Société centrale, re n d ra it les plus grands services. Pour
donner quelques exemples des travaux auxquels ce comité aurait à se livrer, on peut
citer : L ’examen et l’élucidation des stru c tu re s anormales; les principes et la pratique
du croisement et de l’h ybridation ; la re cherche des bizarreries en forme, port, couleur,
et les agents qui les ont causées; la théorie et la pratique du greffage, de l ’inlluence du
sujet sur la greffe, et réciproquement ; des éludes su r l ’origine, la n a tu re , le tra item en t
des maladies des plantes; régler et co rrig e r la n omenclature dos végétaux du ja rd in el
déterminer leur synonymie; enfin, in s titu e r des expériences, reposant non plus sur
l’empirisme, mais sur des principes réellement scientifiques, qui contribue ra ient certainement
à des solutions meilleures et plus utiles aux intérêts de l ’h o rticulture.
En a tten d an t la réalisation de ce voeu et la substitution de l ’e sp rit d ’activité à cette
force d ’inertie contre laquelle to u t se vient b rise r et qui est trop régnante malheureusement,
dans nos Sociétés horticoles, encourageons le développement des conférences,
des cours, la fondation des écoles, la diffusion de l’enseignement public. Nous annoncions,
dernièrement, les nouveaux cours municipaux dcM. D uB re u il; au jo u rd ’h u i, nous
apprenons q u ’un h o rü cu lleu r de Montreuil-aux-Pècbes, M. Carrelet, commence son cours
public et grcduit d ’arboriculture. M. Carrelet est nourri aux sources vives de la culture
perfectionnée du Pêcher; la gra tuité de son en.seignementsera un a ttra itp u is s a n t,n o tam ment
pour les pauvres garçons ja rd in ie rs qui ne pouvaient suivre le cours de M. Lepère,
Fau lto d ’a rg en t, c’est d o u le u r n o n p a re ille ,
comme disail un de nos vieux écrivains gaulois.
A Grenoble, les leçons de M. Verlot, qui jo in t à sa charge de directeur du Jardin
botanique celle de professeur d ’a rb o ricu ltu re, commencent avec un nouvel intérêt. La
municipalité dauphinoise, comprenant l ’utilité qui s’attache à la formation de jeunes
gens instruits p a r un dém o n stra teu r éclairé, a décidé que des examens seraient ouverts
à la fm du cours. Des primes de 40 à 50 francs seront acquises aux meilleurs élèves, et
des diplômes de capacité délivrés par la ville, sous la sanction de M. Verlot, à ceux qui
auront justifié d ’un savoir suffisant pour bien, conduire seuls les arbres fruitiers.
Une école officielle d ’h o rticu ltu re nous manque encore, el rien no vient faire pressentir
sa fondation. La circulaire du Ministre de l ’in struc tion publique, dont nous p a rlerons
plus ta rd , a bien, il est vrai, ajouté l ’enseignement horticole et agricole au p ro gramme
des connaissances que l’instituteur doit communiquer h ses jeunes élèves. Mais
cette addition utile, sur laquelle nous reviendrons un peu plus ta rd , est encore insulfi-
sante. Aussi les tentatives particulières sont-elles notre seul port de salut jusqu’ic i; il
faut demander ou à dos particuliers dévoués, comme M. de Lambei-tye l ’a fait, à Chal-
trait, ou bien à une grande administration, comme oolle de la ville de Paris, d ’organiser
des écoles pratiques en a tten d an t que des professeurs réguliers nous soient donnés par
le gouvernement. Cette école de la ville de Paris n ’est pas au tre chose que le fleuriste
de la Muette, à Passy. Une décision de M. Alphand, d ire c teu r de la voie et dos promenades
de Paris, admet les jeunes gens qui désirent s’instruire à participer aux travaux
de culture de ce vaste é tablissement, dans les conditions suivantes ;
1° Être âgé de dix-huit ans rév o lu s ; présenter une pièce qui constate l’identité du
postulant ; posséder les premières notions du jardinage ; avoir fait, pondant une année
an moins, de la culture pratique.
2” L ’administration alloue aux élèves, en rému n é ra tio n de leur travail :
60 francs p e n d a n t les tro is p rem ie rs ra o is ;
70 francs p en d a n t les tro is mois suivants.
Cette période écoulée, l’allocation mensuelle, suivant les aptitudes e t les capacités de
l’élève, p e u t ê tre élevée à 80 et 85 francs.
3“ Les élèves sont changés tous les mois de section, afin d ’é tu d ie r avec fruit tous les
genres de culture.
4° Ils sont assujettis aux règlements concernant les agents des établissements h o rticoles
de la ville de Paris.
5“ Ceux qui désirent q u itte r l’établissement doivent en prévenir le chef de culture
quinze jours â l’avance et ne peuvent exiger le payement de ce qui leur serait dû avant
le jo u r de la paye, qui a Jieu du 8 au 10 de chaque mois.
Nous avons la conviction que, par la publication de cette circulaire, beaucoup de p ro priétaires
ruraux inviteront leurs jeunes protégés à faire une demande d ’admission au
fleuriste de la Muette. Us trouveront là des moyens d ’in struc tion considérables pour
l’h o rticu ltu re d ’ornement. Les demandes seront adressées à M. le Directeur de la voie
et des promenades de Paris, 15, Chaussée de la Muette, à Passy-Paris.
M. Verlot, de Grenoble, dont nous parlions tout à l ’heure, consacre ses rares moments
de loisir à des travaux scientifiques, dont plusieurs sont dignes d ’un grand intérêt. Après
avoir longtemps étudié les plantes indigènes des riches localités q u ’il habite, el avoir
élucidé plusieurs questions de botanique topographique, il se tourne m aintenant vers la
pomologie. Nous avons lu avec plaisir un travail q u ’il vient de p u b lie r dans la Revue horlicole
sur l ’histoire des Cerisiers à fruits comestibles. Il faudrait citer to u t cet article, et
nous pensons que no tre savant d ire c teu r ren d ra it service en le p u bliant en en tie r dans
le Verger. Sans p a rle r des classifications, proposées par Pline, Daleobamps, Merlet,
ïo u rn c fo r t, Linné, Miller, Duhamel, Lcberryais, de Jussieu, Lamark, on y verrait que
P. de Candolle, en 1804, proposait de diviser les Cerisiers, q u ’il séparait n e ltcm en t des
Pommiers, en cinq espèces botaniques : le Grioltier, le Guignier, le Merisier, le Bigar-
roauticr et le Cerisier ta rd if (ou de la Toussaint). Depuis ce temps, des pomologues é ru -