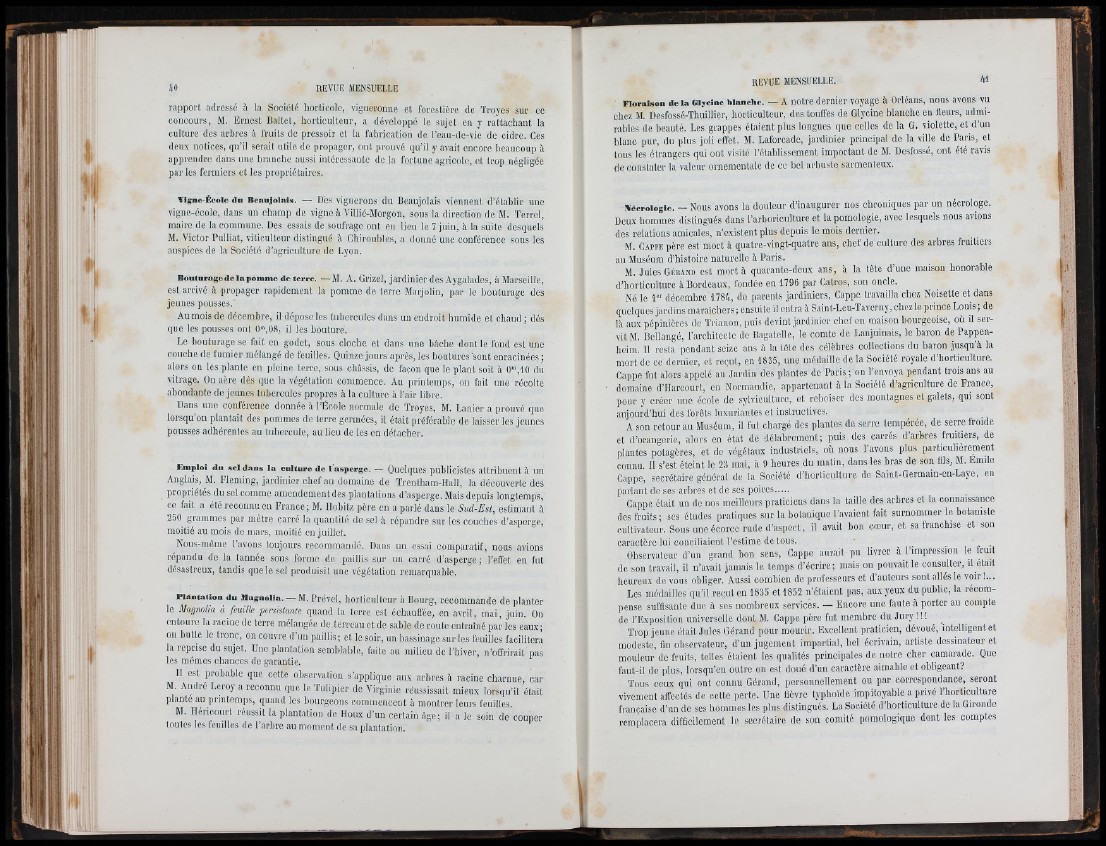
rapport adressé à la Société horticole, vigneronne el forestière de 'J'royes sur ce
concours, M. Ernest Baltet, h o rticu lteu r, a développé le sujet en y ra tta ch an t la
culture des arbres à fruits de pressoir et la fabrication de l ’eau-de-vie de cidre. Ces
deux notices, qu ’il serait utile de propager, ont prouvé q u ’il y avait encore beaucoup à
apprendre dans une branche aussi iiUcrcssaiitc dc la fortune agricole, et trop négligée
par les fermiers et les propriétaires.
r ev u e m en su e l l e . 41
Floraison dc la Glycine iiianeiic. — A notre dernier voyagc à Orléans, nous avons vu
chez M. Desfossé-Thulllier, horticulteur, des touffes de Glycine blanche en fleurs, admirables
de beauté. Les grappes étaient plus longues que celles dc la G. violette, et d ’un
blanc pur, du plus joli effet. M. Laforcade, ja rd in ie r principal de la ville de Paris, et
tous les étrangers qui ont visité l’établissement im portant de M. Desfossé, ont été ravis
dc constater la valeur ornementale do co bel arbusle sarmenteux.
RVi!-
I l
Aignc-Ëcoïc du Beaujolais. — Des vignerons du Beaujolais viennent d ’établir une
vigne-école, dans un champ dc vigne à Villié-Morgon, sous la direction de M. ïe r r e l,
maire de la commune. Des essais do soufrage ont eu lieu le 7 juin, à la suite desquels
M. Victor Piilliat, viticulteur distingué à Chiroubics, a donné une conférence sous les
auspices de la Société d ’agriculture de Lyon.
Bouturage de la pomme dc terre. — M. A. Gi'izel, jardinier des Aygalades, à Marseille,
est arrivé à propager rapidement la pomme do te rre Marjolin, par le bouturage des
jeunes pousses.
A um o isd e décembre, il dépose les tubercules dans un endroit liumide et ch au d ; dès
que les pousses ont 0"',08, il les bouture.
Le bouturage se fait en godet, sous cloche et dans mie bâche dont le fond est une
couche de fumier mélangé de feuilles. Quinze jours après, les boutures sont enracinées ;
alors on les plante en pleine terre, sous châssis, de façon que le plan t soit à 0’",10 du
vitrage. On aère dès que la végétation commence. Au printemps, on fait une récolte
abondante de jeunes tubercules propres à la culture à l’air libre.
Dans une conférence donnée à l ’École normale dc Troyes, M. Lanier a prouvé que
lorsqu’on plantait des pommes de terre germées, il était préférable de laisser les jeunes
pousses adhérentes au tubercule, au lieu de les en détacher.
Fmpioi du sel dans la culture dc l ’asperge. — Quelques publicistes a ttrib u en t à un
Anglais, M. Fleming, ja rd in ie r chef au domaine de Trentham-Hall, la découverte des
propriétés du sel comme amendement des plantations d ’asperge. Mais depuis longtemps,
ce fait a été reconnu en France ; M. llobitz père en a parlé dans le Sud-E st, estimant à
250 grammes par mètre carré la quantité de sel à répandre sur les couches d ’asperge,
moitié au mois de mars, moitié en juillet.
Nous-même l ’avons toujours recommandé. Dans un essai comparatif, nous avions
répandu de la tannée sous forme de paillis sur un carré d ’asperge; l ’eflet en fut
désastreux, tandis que le sel produisit une végétaiion remarquable.
Plantation du Magnolia. — M. Prével, h orticulteur à Bourg, recommande de planter
le Magnolia à feuille persistante quand la terre est échauffée, en avril, m a i, juin. On
entoure la racine de te rre mélangée de terreau et de sable de route ciitramé par les eaux ;
on butte le tronc, on couvre d ’un paillis; et le soir, un bassinage sur les feuilles facilitera
la reprise du sujet. Une plantation semblable, faite au milieu de l ’hiver, n ’offrirait pas
les mêmes chances de garantie.
Il est probable que cette observation s ’applique aux arbres â racine charnue, car
M. André Leroy a reconnu que le Tulipier de Virginie réussissait mieux lorsqu’il était
plante au printemps, quand les liourgeons commencent à montrer leurs feuilles
M. Héricourt réussit la plantation de Houx d ’un certain âge; il a le soin de couper
foules les feuilles de l ’arbre au moment dc sa plantation.
Nécrologie. — Nous avons la douleur d ’inaugurer nos chroniques par un nécrologe.
Deux hommes distingués dans l’a rboriculture et la pomologie, avec lesquels nous avions
des relations amicales, n’existent plus depuis le raois dernier.
M. C a p p e père est m ort â quatre-vingt-quatre ans, chef de culture des arbres fruitiers
au Muséum d’histoire naturelle à Paris.
M. Jules G éra n d est mort â quarante-deux a n s, à la tête d’une maison honorable
d’ho rticu ltu re à Bordeaux, fondée en 1796 par Calros, son oncle.
Né le 1“' décembre 1784, de parents ja rdinie rs, Cappe travailla chez Noisette et dans
quelques jardins maraîchers; ensuite il entra à Sainl-Leu-Taverny, chez le prince Louis; de
là aux pépinières dc Trianon, puis devint ja rd in ie r chef en maison bourgeoise, où il servit
M. Bellangé, l’architecte de Bagatelle, le comte de Lanjuinais, le baron de Pappen-
heim. Il resta pendant seize ans à la lêle des célèbres collections du baron jusqu’à la
m o rt de oc dernier, et reçut, en 1835, une médaille de la Société royale d ’horticulture.
Cappe fut alors appelé au Jard in des plantes de Paris ; on l ’envoya pendant trois ans au
domaine d ’Harcourt, en Normandie, appartenant à la Société d ’agriculture de France,
pour y créer une école de sylviculture, et reboiser des montagnes et galets, qui sont
aujourd’hui des forêts luxuriantes et instructives.
A son re to u r au Muséum, il fut chargé des plantes de serre tempérée, de serre froide
et d ’orangerie, alors en é ta t de d é labrem ent; puis des carrés d ’arbres fruitiers, de
plantes potagères, et de végétaux industriels, où nous l’avons plus particulièrement
connu. Il s’est éteint le 23 mai, à 9 heures du matin, dans les bras de son fils, M. Emile
Cappe, secrétaire général de la Société d’horticulture de Saint-Germain-en-Laye, en
parlant de ses arbres et de ses poires......
Cappe était un de nos meilleurs praticiens dans la taille des arbres et la connaissance
des fruits ; scs études pratiques sur la botanique l ’avaient fait surnommer le botaniste
cultivateur. Sous une écorce rude d ’a sp e c t, il avait bon coeur, et sa franchise et son
caractère lui conciliaient l ’estime de tous.
Observateur d ’un grand bon sens, Cappe aurait pu livrer à l ’impression le fruit
de son travail, il n ’avait jamais le temps d ’é c rire ; mais on pouvait le consulter, il était
heureux de vous obliger. Aussi combien de professeurs et d ’auteurs sont allés le voir !...
Les médailles q u ’il reçut en 1835 et 1852 n ’étaient pas, aux yeux du public, la récompense
suffisante due à ses nombreux services. — Encore une faute à p o rte r au compte
de l’Exposition universelle dont M. C a p p e père fut membre du Jury !! !
Trop jeune était Jules Gérand pour mourir. Excellent praticien, dévoué, intelligent et
modeste, fm observateur, d’un jugement impartial, bel écrivain, artiste dessinateur et
mouleur de fruits, telles é taient les qualités principales de notre cher camarade. Que
faut-il de plus, lorsqu’en outre on est doué d ’un caractère aimable e t obligeant?
Tous ceux qui ont connu Gérand, personnellement ou par correspondance, seront
vivement affectés de cette perte. Une fièvre typhoïde impitoyable a privé l’horticulture
française d ’un de ses hommes les pins distingués. La Sociélé d ’horticulture de la Gironde
remplacera difficilement le secrétaire de son comité pomologique dont les comptes
F .
m m