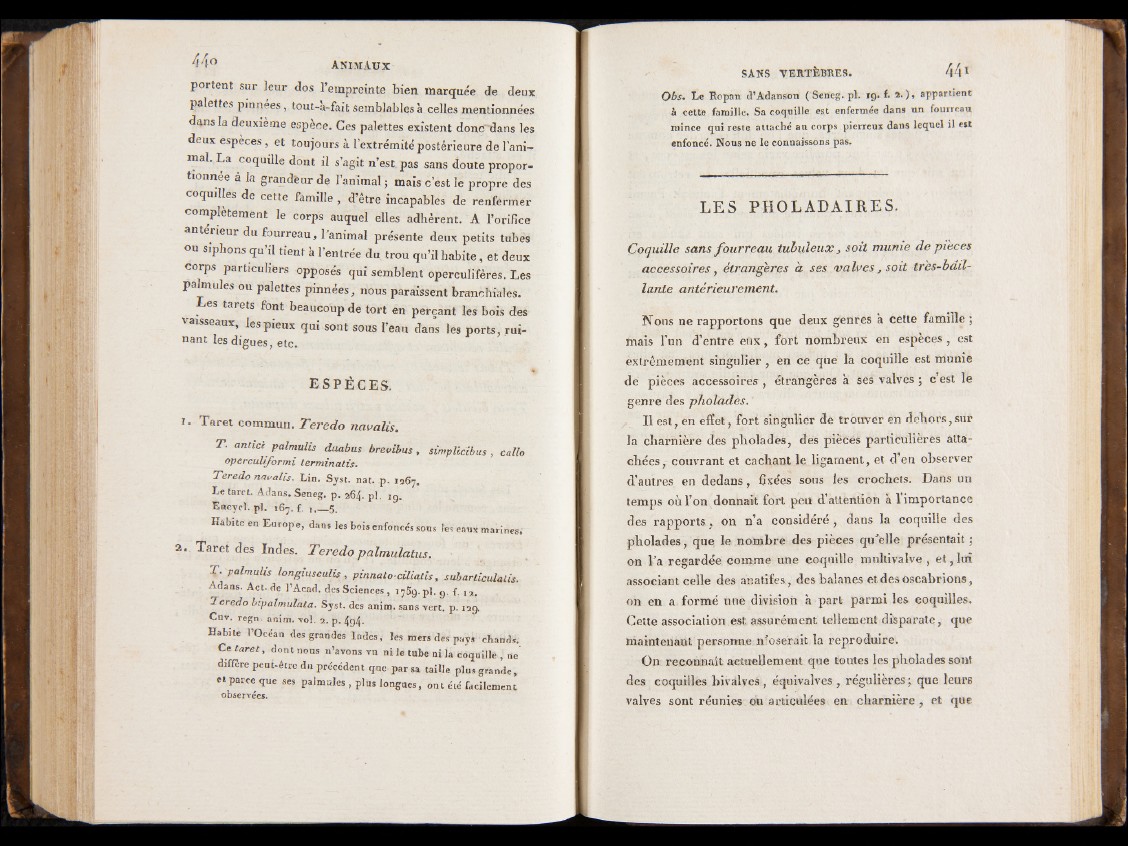
portent sur leur dos l’empreinte bien marquée de deux
palettes pinnees, tout-a-fait semblables à celles mentionnées
d^nsla deuxième espèce. Ces palettes existent domfdans les
eux espèces, et toujours a 1 extrémité postérieure de l'animal.
La coquille dont il s’agit n’est pas sans doute proportionnée
à la grand'eur de l’animal ; mais c’est le propre des
coquilles de cette famille , d’être incapables de renfermer
complètement le corps auquel elles adhèrent. A l’orifice
ntéiieur du fourreau, 1 animal présente deux petits tubes
ou siphons qu il tient à l’entrée du trou qu’il habite , et deux
corps particuliers opposés qui semblent operculifères. Les
palmules ou palettes pinnées, nous paraissent branchiales.
te s tarets font beaucoup de tort en perçant les bois des
vaisseaux, les pieux qui sont sous l’eau dans les ports, .ruinant
les digues, etc.
E S P È C E S . i.2
i. Taret commun. Teredo navalis.
T. anticc palmulis duabus brevibus, simplicibus, callo
operculiformi terminatis.
Teredo navalis. Lin. Syst. nat. p. 1267.
Le taret. Adans. Seneg. p. 264. pl. Ig.
Eaeycl. pl. 167. f. 1._5.
Habite en Europe, dans les bois enfoncés sous tes eaux marines.
2. Taret des Indes. Teredo palmulatus.
T . palmulis longiusculis, pinnato-cüiatis, subarticulalis.
Adans. Act. de l ’Acad. des Sciences , 1759. pl. 9. f 12.
Teredo bipalmulata. Syst. des anim. sans vert. p. 129.
Cnv. regn. anim. vol. 2. p. 494.
Habite l ’Océan des grandes Indes, les mers des pays chauds.
Ce taret, dont nous n’avons vn ni le tube ni la coquille , rie
diffère peut-être du précédent que par sa taille plusgrande,
et parce que ses palmules , plus longues, ont été facilement
observées.
O b s . Le Ropan d’Adanson ( Seneg. pl. 19. f. 2. ) , appartient
h cette famille. Sa coquille est enfermée dans un fourreau
mince qui reste attaché au corps pierreux dans lequel il est
enfoncé. Nous ne le connaissons pas.
LES PHOLADAIRES.
Coquille sans fourreau tubuleux, soit munie de pièces
accessoires y étrangères a ses valves , soit très-baillante
antérieurement.
Nous ne rapportons que deux genres a cette famille ;
mais l’un d’entre eux, fort nombreux en espèces , est
extrêmement singulier, en ce que la coquille est munie
de pièces accessoires, étrangères a ses valves ; c est le
genre des pholades. '
Il est, en effet, fort singulier de trouver en dehors,sur
la charnière des pliolades, dés pièces particulières attachées,
couvrant et cachant le ligament, et d’en observer
d’autres en dedans, fixées sous l e s crochets. Dans un
temps où l’on donnait fort peu d’attention à l’importance
des rapports, on n’a considéré , dans la coquille des
pholades, que le nombre des pièces quelle présentait ;
on Ta regardée comme une coquille multivalve , e t , lui
associant celle des an a tife s , des balanes etdesoscabrions,
on en a formé nue division à part parmi les coquilles.
Cette association est assurément tellement disparate, que
maintenant personne n'oserait la reproduire.
On reconnaît actuellement que toutes les pholades sont
des coquilles bivalves, équivalves , régulières; que leurs
valves sont réunies ou articulées en charnière , et que