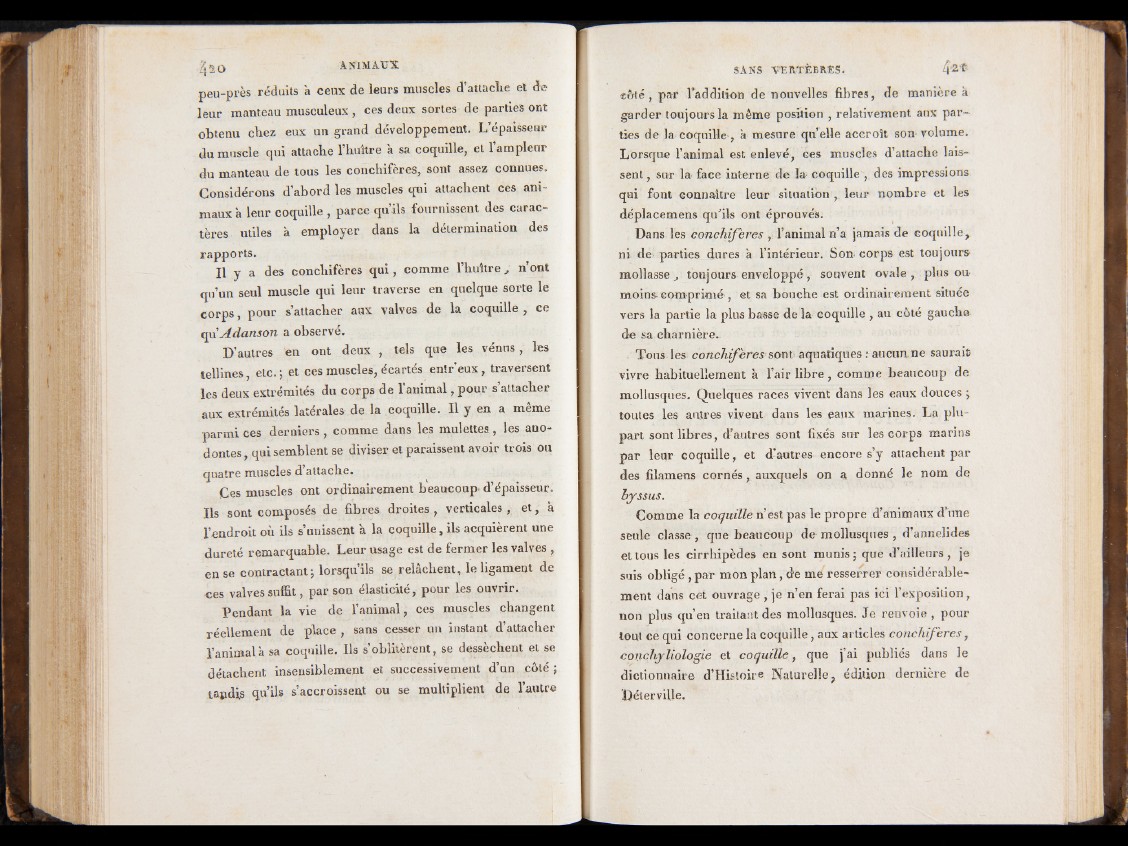
peu-près réduits à ceux de leurs muscles d’atiache et de
leur manteau musculeux , ces deux sortes de parties ont
obtenu chez eux un grand développement. L'épaisseur
du muscle qui attache l'huître à sa coquille, et l’ampleur
du manteau de tous les conchifères, sont assez connues.
Considérons d’abord les muscles qui attachent ces animaux
a leur coquille , parce qu’ils fournissent des caractères
utiles à employer dans la détermination des
rapports.
Il y a des conchifères qui , comme l’huître £ n’ont
qu’un seul muscle qui leur traverse en quelque sorte le
corps, pour s’attacher aux valves de la coquille , ce
qu'Adanson a observé.
D’autres en ont deux , tels que les vénns, les
tellines, etc.; et ces muscles, écartés entr’eux, traversent
les deux extrémités du corps de 1 animal, pour s attacher
aux extrémités latérales de la coquille. Il y en a même
parmi ces derniers , comme dans les mulettes, les ano-
dontes, qui semblent se diviser et paraissent avoir trois ou
quatre muscles d attache.
Ces muscles ont ordinairement beaucoup- d’épaisseur.
Ils sont composés de fibres droites , verticales, e t, à
l’endroit où ils s’unissent a la coquille, ils acquièrent une
dureté remarquable. Leur usage est de fermer les valves ,
en se contractant; lorsqu’ils se relâchent, le ligament de
ces valves suffit, par son élasticité, pour les ouvrir.
Pendant la vie de l’animal, ces muscles changent
réellement de place , sans cesser un instant d’attacher
l’animal à sa coquille. Ils s’oblitèrent, se dessèchent et se
détachent insensiblement et successivement d’un côté ;
tandis qu’ils s’accroissent ou se multiplient de l’autre
eôté , paT l’addition de nouvelles fibres, de manière à
garder toujours la même position , relativement aux parties
de la coquille, à mesure quelle accroît son'volume.
Lorsque l’animal est enlevé, ces muscles d’attache laissent,
sur la face interne de la- coquille , des impressions
qui font connaître leur situation , leuF nombre et les
déplacemens qu’ils ont éprouvés.
Dans les conchifères , l’animal n’a jamais de coquille^
ni de parties dures à l’intérieur. Son corps est toujours
mollasse,, toujours enveloppé, souvent ovale, plus ou
moins comprimé, et sa bouche est ordinairement située
vers la partie la plus basse de la coquille , au côté gauche
de sa charnière-
Tous les conchifères som aquatiques r aucun ne saurait
vivre habituellement à l’air lib re , comme beaucoup de
mollusques. Quelques races vivent dans les eaux douces j
toutes les autres vivent dans les eaux marines. La plupart
sont libres, d’autres sont fixés sur les corps marins
par leur coquille, et d’autres encore s’y attachent par
des filamens cornés, auxquels on a donné le nom de
hjssus.
Comme la coquille n’est pas le propre d’animaux d’une
seule classe , que beaucoup de mollusques , d’annelides
et tous les cirrhipèdes en sont munis ; que d’ailleurs, je
suis obligé, par mon plan, de me resserrer considérablement
dans cet ouvrage , je n’en ferai pas ici l’exposition,
non plus qu’en traitant des mollusques. Je renvoie , pour
tout ce qui concerne la coquille, aux articles conchifères,
conchyliologie et coquille, que j’ai publiés dans le
dictionnaire d’Histoire Naturelle ? édition dernière de
*D éternué.