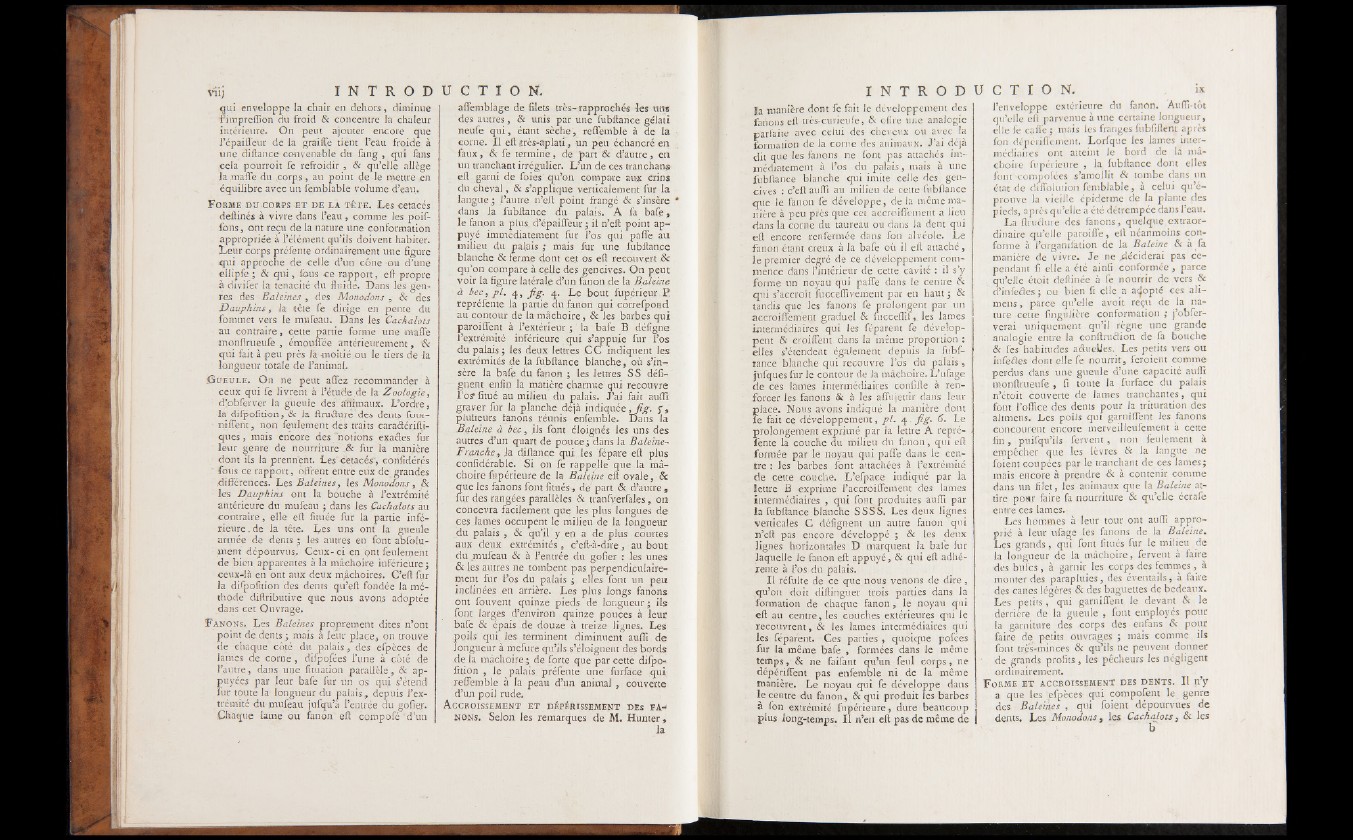
gui enveloppe la chair en dehors, diminue
fimpreffion du froid & concentre la chaleur
intérieure. On peut ajouter encore que
i’épaifleur de la graine tient l’eau froide à
une diftance convenable du fang , qui fans
cela pourroit fe refroidir , & qu’elle allège
ia înafTe du ,corps , au point de le mettre ;en
équilibre avec un femblable volume d’eau.
Forme du corps et de la te te. Les cétacés
deftinés à vivre dans l’eau, comme les poif-
fons, ont reçu de la nature une conformation
appropriée à l’élément qu’ils doivent habiter.
Leur corps préfente ordinairement une figure
qui approche de -celle d’un cône eu d’une
ellipfe; 8c q u i, fous c e rapport, eh propre
à divifer la ténacité du fluide. Dans lès genres
des Baleines , des Monodons , 8c des
Dauphins 9 la tête fe dirige en pente du
fommet vers le mufeau. Dans les Cachalots
au contraire, cette partie forme une maffe
monflrueufe , émouffée antérieurement, 8c
qui fait à peu près là moitié ou le tiers de la
longueur totale de l ’animal.
G ueule. On ne peut aflez_ recommander à
ceux qui fe livrent à l’étude de la Zoologie,
d!obferver la gueule des atfimaux. L’ordre,
la difpofition, 8c la ftruéhlre des dents four-
niffent, non feulement des traits caraétérifti-
qu e s , mais encore des notions exa&es fur
leur genre de nourriture 8c fur la manière
dont ils la pren-n'ent. Les' cétacés, confidérés
' fous ce rapport, offrent entre eux de grandes ,
différences. Les Baleines, les Monodons, 8c
les Dauphins ont la bouche à l’extrémité
antérieure du mufeau ; dans les Cachalots au
contraire, elle eft fituée fur la partie inférieure,
de la tête. Les uns ont la gueule
armée de dents ; les autres en font abfolu-
ment dépourvus. C eu x -c i en ont feulement
de bien apparentes à la mâchoire inférieure ;
ceux-là en ont aux deux mâchoires. C ’eft fur
la difpofition des dents qu’eft fondée la méthode
diftributive que nous avons adoptée
dans cet Ouvrage.
Fanons. Les Baleines proprement dites n’ont
point de dents ; mais à leur place, on trouve
de chaque côté du palais, des .efpèces de
lames de corne, difpofées l’une à côté de
l’autre, dans une fituation parallèle, & appuyées
par leur bafe fur un os qui s’étend
fur toute la longueur du palais, depuis l’extrémité
du mufeau jufqu’à l’entrée du gofiçr.
Chaque lame ou fanon eft compofé ' d’un
affemblage de filets très-rapprochés les uns
des autres, 8c unis par une fubftance gélati
neufe q u i, étant sèche, reffembie à de la
corne. J1 eft 5très-aplati, un peu éçhancré en
faux, 8c fe termine, de part 8c d’a u t r e e n
un tranchant irrégulier. L ’un de ces tranchans
eft garni de foies ' qu’on compare au# Crins
du cheval, 8c s’applique verticalement fur la
langue ; l ’autre n’eft point frangé 8c s’insère
dans la fubftance du palais. A fa bafe,
le fanon a plus, d’épaiffeur ; il n’eft point appuyé
immédiatement fur l’os qui paffe au
milieu du palais ; mais fur une fùbftance
blanche 8c ferme dont cet os eft recouvert ,8c
qu’on compare à cglle des gencives. On peut
voir la figure latérale d’un fanon .de la Baleine
à bec, p l. 4., fig. 4. Le bout fiipèrieur P,
repréfente la partie du fanon qui correfpond
au contour de la’mâchoire , 8c les barbes qui
paroiffent à l’extérieur ; la bafe B défigne
l’extrémité inférieure qui s’appuie fur l’os
du palais ; les deux lettres C C indiquent les
extrémités de la fubftance blanche, où s’insère
la bafç du fanon ; les lettres SS défî-
gnent enfiq la matière charnue qui recouvre
l ’o? fitué au milieu du palais. J’ai fait aufli
graver fur la planche déjà in d iq u é e ,^ , y ,
plufieurs fanons réunis enfemble,. Dans la
Baleine à bec, ils font éloignés les tins des
autres d’un quart de pouce; dans la Baleine-
Franche., la diftance qui les fépare eft plus
confidérable. Si on fe rappelle que la mâchoire
fupérieure de la BalfineeSi oyale, 8c
que les fanons font fitué$\, de part 8c d’autre,
fur des rangées parallèles 8c tranfverfales, on
concevra facilement que les plus longues de
ces lames occupent le milieu de la longueur
du palais , 8c qu’il y en a de plus courtes
aux deux extrémités , c’efl-à-dire, au bout
du jmufeau & à l’entrée du gofier : les unes
8c les antres ne tombent pas perpendiculairement
fur l’os du palais ; elles font un peu
inclinées en arrière. Les plus longs fanons
ont fouvent quinze pieds de longueur ; ils
font larges d’environ quinze pouçes à leur
bafe 8c épais de douze à treize lignes. Les
p pii s qui. les terminent diminuent auffi de
longueur à mefure qu’ils s’éloignent des bords
.de la mâchoire de forte que par cette difpo-
fîtion , le palais préfente une furface qui
reffembie à la peau d’un animal , couverte
d’un poil rude.
A ccroissement et dépérissement des faj
nons. Selon les remarques de M. Hunter,
la
îa manière dont fe fait le développement des
fartons eft tfès-curieufe, 8c ofire une analogie
parfaite avec celui des cheveux ou avec la
formation de la corne des animaux. J’ai déjà
dit que les fanons ne font pas attachés immédiatement
à l’os du palais, mais à une
fubftance blanche qui imite celle des gencives
: c’eft auffi au milieu de cette fubftance
que le fanon fe développe, de la même manière
à peu près que cet accroiffement a lieu
dans la corne du taureau ou dans ia dent qui
eft encore renfermée dans fon alvéole. Le
fanon étant creux à la bafe où il eft attaché,
le premier degré de ce développement commence
dans l’intérieur de cette cavité : il s’y
forme un noyau qui paffe dans le centre &
qui s’accroît fucceffivement par en haut ; 8c
tandis que les fanons' fe prolongent par un
accroiffement graduel 8c fu c c e ffifle s lames
intermédiaires qui les féparent fe développent
8c eroiffent dans la même proportion :
elles s’étendent également depuis la fub ftance
blanche qui recouvre l’os du palais ,
jùfques fur le contour de la mâchoire. L ’ufage
de ces lames intermédiaires confifte à renforcer
les fanons & à les affujettir dans leur
place. Nous avons indiqué la manière dont
le fait ce développement, p l. 4 , fig. 6. Le
prolongement exprimé par la lettre A repréfente
la couche du milieu du fanon, qui eft
formée par le noyau qui paffe dans le centre
: les barbes font attachées à {’extrémité
de cette couche. L ’efpace indiqué par la
lettre B exprime l’accroiffement des lames
intermédiaires , qui font produites aufli par
la fubftance blanche S S S S . Les deux lignes
verticales C défignent un autre fanon qui
n’eft pas encore d é v e l o p p é 8c les deux
lignes horizontales D marquent la baie fur
laquelle le fanon eft appuyé, 8c qui eft adhérente
à l’os du palais.
Il réfulte de ce que nous venons de d ire ,
qu’on doit diftinguer trois parties dans 1a
formation dé chaque fanon, le noyau qui
eft au centre, les couches extérieures qui le
recouvrent, 8c les lames intermédiaires qui
les féparent. - Ces parties , quoique pofées
fur la même bafe , formées dans le même
temps, 8c ne faifant qu’un feul corps, ne
dépériffent pas enfemble ni de la même
manière. Le noyau qui fe développe dans
le centre du fanon, 8c qui produit les barbes
a fon extrémité fupérieure, dure beaucoup
plus long-temps. I l n’en eft pas de même de
l’enveloppe extérieure du fanon. Auffi-tôt
qu’elle eft parvenue à une certaine longueur,
elle fe caffe ; mais les franges fubfifteni après
fon dépéiiflèment. Lorfque les lames intermédiaires
ont atteint le bord de la mâchoire
fupérieure , la, fubftance dont elles
font compofées s’amollit 8c tombe dans un
état de diffoluiion femblable, à celui qu’éprouve
la vieille épiderme de la plante des
pieds, après qu’elle a été détrempée dans l’eau.
La ftruâure des fanons, quelque.extraordinaire
qu’elle paroiffe, eft neanmoins conforme
à l’organifation de la Baleine 8c à fa
manière de vivre. Je ne „déciderai pas cependant
fi elle a été ainfi conformée, parce
qu’elle étoit deflinée à fe nourrir de vers &
d’infedes; ou bien fi elle a adopté ces ali-
mens, parce qu’elle avoit reçu de la nature
cette fingulière conformation ; j’obfer-
verai uniquement qu’il règne une grande
analogie entre la conftrudion de fa bouche
8c fes habitudes adueJJes. Les petits vers ou
infeétes dont elle fe nourrit, feroient comme
perdus dans une gueule d’une capacité auffi
monflrueufe , fi toute la furface du palais
n’étoit couverte de lames tranchantes, qui
font l’office des dents pour la trituration des
aiimens. Les poils qui garniffent les fanons
concourent encore merveilleufement à cette
fin , puifqu’ils fervent, non feulement à
empêcher que les lèvres & la langue ne
foient coupées par le tranchant de ces lames;
mais encore à prendre 8c à contenir comme
dans un filet, les animaux que la Baleine attire
pour faire fa nourriture 8c qu’elle écrafe
entre ces lames.
Les hommes à leur tour ont auffi approprié
à leur ufage les fanons de la Baleine.
Les grands, qui font fitués fur le milieu de
la longueur de la mâchoire, fervent à faire
-des bufes , à garnir les corps des femmes , à
monter des parapluies, des éventails, a faire
des canes légères 8c des baguettes de bedeaux.
Les petits , qui garniffent le devant 8c le
derrière de ia gueule , font employés pour
la garniture des corps des enfans 8c pour
faire de petits ouvrages ; mais comme ils
font très-minces & qu’ils ne peuvent donner
de grands profits, les pêcheurs les négligent
ordinairement.
F orme et accroissement des dents. Il n’y
a que les efpèces qui composent le genre
des Baleines , qui foient dépourvues de
dents. Les Mono do ns , les Cachalots, 8c les