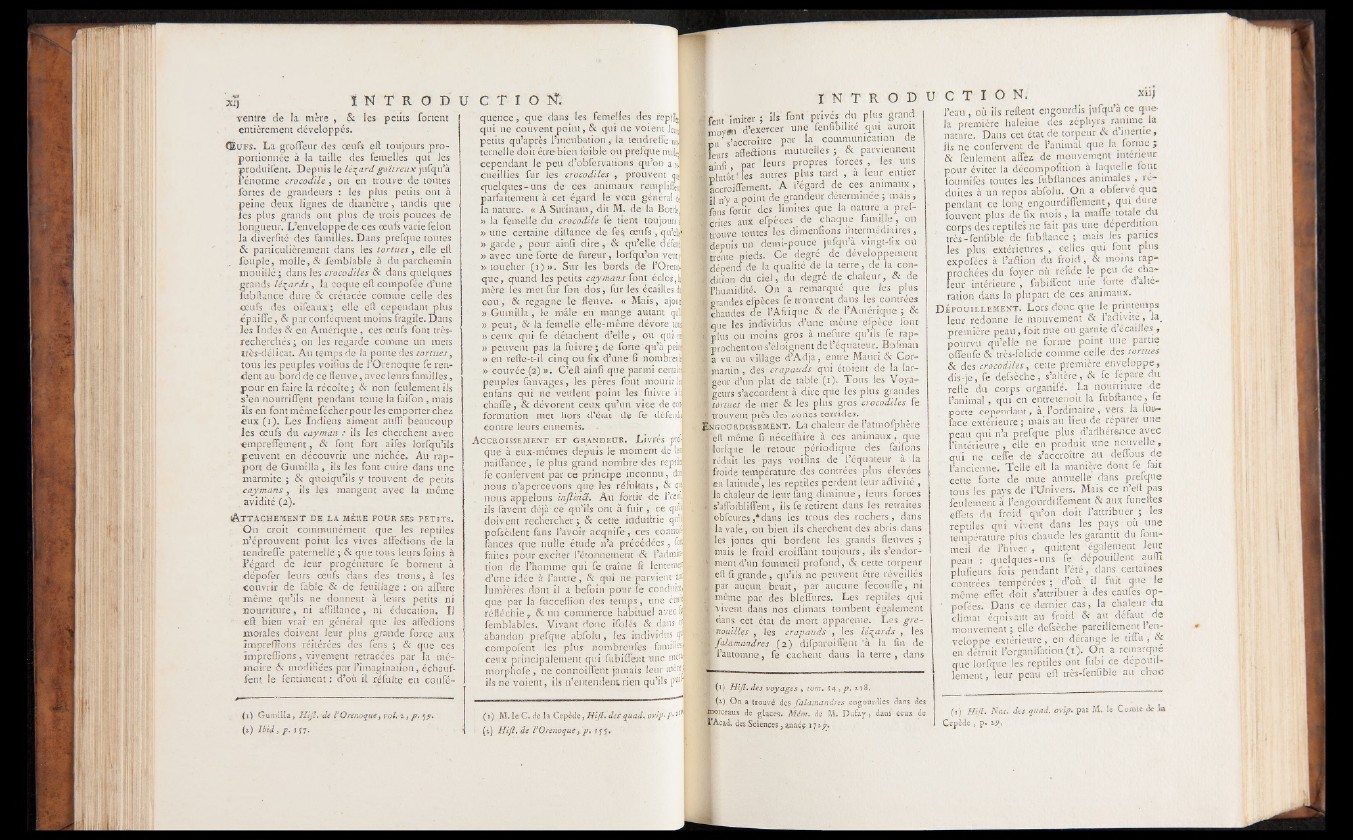
ventre de la mère , & les petits forcent
entièrement développés.
(Eues. La grofleur des oeufs eft toujours proportionnée
à la taille des femelles qui les
produifent. Depuis le lézard goitreux jufqu’à
l ’énorme crocodile , on en trouve de toutes
fortes de grandeurs : les plus petits ont à
peine deux lignes de diamètre, tandis que
les plus grands ont plus de trois pouces de
longueur. L’enveloppe de-ces oeufs varie félon
la diverfité des familles. Dans prefque toutes
8c particulièrement dans les tortues, elle eft
fouple, molle, & femblable à du parchemin
mouillé ; dans les crocodiles 8c dans quelques
grands lézards, la coque eft compofée d’une
îubftance dure & crétacée comme celle des
oeufs des oifeaux'; elle eft cependant plus
épaifle, 8c par conféquent moins fragile. Dans
les Tndes 8c en Amérique, ces oeufs font très-
recherchés; on les regarde comme un mets
très-délicat. A u temps de la ponte des tortues,
tous les peuples voifins de l ’Orenoque fe rendent
au bord de ce fleuve, avec leurs familles,
pour en faire la récolte; 8c non feulement ils
s’en nourri fient pendant toute la faifon , mars
ils en font même fécher pour les emporter chez
eux ( i) . Les Indiens aiment atiiïï beaucoup
les oeufs du cayman : ils les cherchent ayec
•emprefiement, 8c font fort aifes lorfqu’ils
peuvent en découvrir une nichée. Au rapport
de Gumilla, ils les font cuire dans Une
marmite ; & quoiqu’ils y trouvent de petits
caymaris, ils les mangent avec la même
, avidité (2).
A ttachement de la mère pour ses petits.
On croit communément que les reptiles
n’éprouvent point les vives afledions de la
tendrefle paternelle ; & que tous leurs foins à
l ’égard de leur progéniture fe bornent à
dépofer leurs oeufs dans des trous, à les
couvrir de fable & de feuillage : on affure
même qu’ils ne donnent à leurs petits ni
nourriture, ni affiftance, ni éducation. Il
eft bien vrai' en général que les affeâions
morales doivent leur plus grande force aux
împreflions réitérées des fens ; & que ces
împreflions, vivement retracées par la mémoire
8c modifiées par l’imagination, échauffent
le fentiment : d’où il réfulte en confé-
(ï ) Gumilla, Hijl. de VOrenoque, vol, a , p. 19.
{%) Ibid, p- 117;
quence, que dans les femelles des repri(e!
qui ne couvent point, 8c qui ne voient le«ti
petits qu’après l’in cu b a tionla tendrefle 1113.
ternelle doit être bien foible ou prefque nulle,
cependant le peu d’obfervations qu’on a re.
cueillies fur les crocodiles , prouvent
quelques-uns d e ces animaux remplifleJ
parfaitement à cet égard le voeu général <jj
la nature. « A Surinam, dit M. de la Bordel
» la femelle du crocodile fe tient toujours I
»une certaine diftance de fes. oeufs, qu’elle!
» garde , pour ainfi d ire , 8c qu’elle défenl
» avec une forte de fureur, lorfqu’on veutl
»toucher ( 1 ) ». Sur les bords de l’OreiicJ
que, quand les petits caymans font éclos,il
mère les met fur fon dos, fur les écailles du
c o u , 8c regagne le fleuve. « Mais, ajoute
» Gumilla, le mâle en mange autant qu’t
» peut, & la femelle elle-même dévore tous
».ceux , qui fe détachent d’e lle , ou qui ni
» peuvent pas la fuivre ; de forte qu’à peinf
» en refte-t-il cinq OU fîx d’une fi nombrenfî
» couvée (2) ». C’eft ainfi que parmi certains
peuples fauvages, les pères font mourir le
enfans qui ne veulent point les fuivre à
chafîe, 8c dévorent ceux qu’un vice de conformation
met hors d’état de fe défendis
contre leurs ennemis. -
Accroissement et grandeur. Livrés prelj
que à eux-mêmes depuis le moment de leiia
naiffançe, le plus grand nombre des reptile
fe confervent par ce principe inconnu , dom
nous n’apercevons que les réfiikats, 8c que
nous appelons in jim et. Au fortir de l’oeuf,
ils favent déjà ce qu’ils ont à fuir , ce qu'l
doivent rechercher-; 8c cette induftrie qu’il
pofsèdent fans l’avoir acqnife, ces conrroifj
lances que nulle étude n’a précédées, fon
faites pour exciter l’étonnement 8c l’adiniul
tion de l’homme qui fe traîne fi lentement
d’une idée à l’autre, 8c qui ne parvient aul
lumières dont il a befoin pour fe conduirel
que par la fnccefiïon des temps, une énitl
réfléchie, 8c un commerce habituel avec M
femblables. Vivant donc ifolés 8c dans il
abandon prefque abfolii, les individus qu|:
compofent les plus nombreufes famillesj
ceux principalement qui fubiflent une nietal
morphofe , ne connoiffent jamais leur merel
ils ne voient , ils n’eii tendent rien qu’ils pull| *1
i fe n t - imiter; Ils'font privés du plus grand
imov#n d’exercer une fenfibthte qui auroit
I e u s’accroître par la communication de
H leu r s affeaions mutuelles ; & parviennent
■ Èjl| par ' leurs propres forces , les uns
»plutôtîles autres plus tard , à leur entier
■ Iccroilfement. A l’égard de ces animaux,
f i l 11’y a point de grandeur déterminée ; mais,
■ fans fortir des limites que la nature a pref-
crùes aux efpcc.es de chaque famijie, on
B t to iiv e toutes les dimenfions'intermédiaires,
::î depuis un demi-pouce jufqu’à vingt-fix ou
aJ trente pieds. Ce -degré de développement
»dépend de la qualité de la terre, de la con-
B d iu o n du c ie l, du degré de chaleur, & de
■ l’humidité. On à remarqué que les plus
.eü grandes efpèces fe trouvent dans les contrées
Bchaudes de l’Afrique & de^ l’Amérique ; &
» q u e les individus d’une même efpcce font
'H plus ou moins gros à mefure qu’ils fe rap-
« prochentou s’éloignent de l’équateur. Bofman
a vu au village d’A d ja , entre Mauri & Cor-
Imartin, des crapauds qui étoient dé la lar-
l.geur d’un plat de table (i). Tous les Voya-
rgeurs s’accordent à dire que les plus grandes
hortues de mer & les plus gros crocodiles fe
^trouvent près des zones torrides.
Engourdissement. La chaleur de l’atmofphère
même fi néceffaire à ces animaux, que
lorfque le retour périodique des faifons
réduit lès pays voifins de l’équateur à la
froide température des contrées plus élevées
en latitude, les reptiles perdent leur aâïvité ,
jla chaleur de leur fang diminue, leurs forces
: s’afFoiblilfent, ils fe retirent dans les retraites
jobfcures ,* dans les trous des rochers , dans
j la yafe, ou bien ils cherchent des abris dans
jles joncs qui bordent les,grands fleuves;
(mais le froid croiffant toujours, ils s'endorment
d’un fommeil profond, & cette torpeur
- J eft f i grande , qu’ils ne peuvent être réveillés
I par aucun bruit,- par aucune fécoulfe, ni
• même par des blelfures. Les reptiles qui
’vivent dans nos climats tombent également
dans ce-t état de mort apparente. Les gre-
inouillçs , les crapauds , .les lézards , les
sfalamatidres (2 ) difparoiuent 'à la fin de
l l ’automne, fe cachent dans la terre, daiis
(1) M.le C. de la Cepècîe, Hijl. des qüad, ovip-P' ** I
(1) Hijl, de l ’Orenoque, p. in»
■ d (1) Hijl. des voyages , tom. 14 , p. zï8.
V (1) On a trouvé des falamandres engourdies dans des
ânorceaux de glaces. Mém. de M. Dufay, dans ceux de
1 Acad, des Sr.1P.nr#*C cmnpp tnt etl’eau
, où ils relient engourdis jufqu’à ce que-
la première haleine des zéphyrs ranime la
nature. Dans cet état de torpeur & d inertie,
ils ne confervent de l’animal que la forme ;
& feulement alfez de mouvement intérieur
pour éviter la décompofition à laquelle font
foumifes toutes les fubftances animales , réduites
à un repos abfolu. On a obfervé que
pendant ce long engourdiffement, qui dure
fouveut plus de fix mois, la mafiV totale du
corps des reptiles ne fait pas une déperdition
très - fenfible de fubflance ; mais les parties
les plus extérieures , celles qui font plus
expofées à l’aétion du froid, & moins rapprochées
du foyer où réfide le peu de chaleur
intérieure , fubilfent une forte d altération
dans la plupart de ces animaux.
D épouillement. Lors donc que le printemps
leur redonne le mouvement & l’activité, la.
première peau, foit nue ou garnie d’écailles ,
pourvu qii’elle ne forme point une partie
offeufe & tres-folide comme celle des tortues
& des crocodiles, cette première enveloppe,
dis-je, fe defsèche, s’altère, & fe fépare du
relie du corps organifé. La nourriture de
l’animal, qui en entretenoit la fubftance, fe
porte cependant, à l’ordinaire, vers la fun~
face extérieure ; mais au lieu de réparer une
peau qui n’a prefque plus d’adhérance avec
l’intérieure , elle en produit une nouvelle,
qui ne celfe de s’accroître au delfous de
l’ancienne. Telle efl ia manière dont, fe fait
cette forte de mue annuelle' dans prefque
tous les pays de l’Univers. Mais ce n’êlt pas
feulement à l’engourdiifement & aux funelles
effets du froid qu’on doit l’attribuer ; les
reptiles qui vivent dans les pays ■ où une
température plus chaude fes garantit du fommeil
de l’hiver , quittent également leur
peau : quelques-uns fe dépouillent aufiî
plufieurs fois pendant l’été, dans certaines
contrées tempérées ; d’où il fuit que le
même effet doit s’attribuer à des caufes op-
' pofées. Dans ce dernier ca s, la chaleur du
climat équivaut au froid àc au defaut de
mouvement ; elle defsèche pareillement l’enveloppe
extérieure , en dérange le tiffu , &
en détruit l’organifation ( i) . On a remarqué
que lorfque les reptiles ont fubi ce dépouillement
, leur peau efl très-fenfibie au choc
(,) Hijl. Hat. des qtiad. ovip. par M. le Comte de la