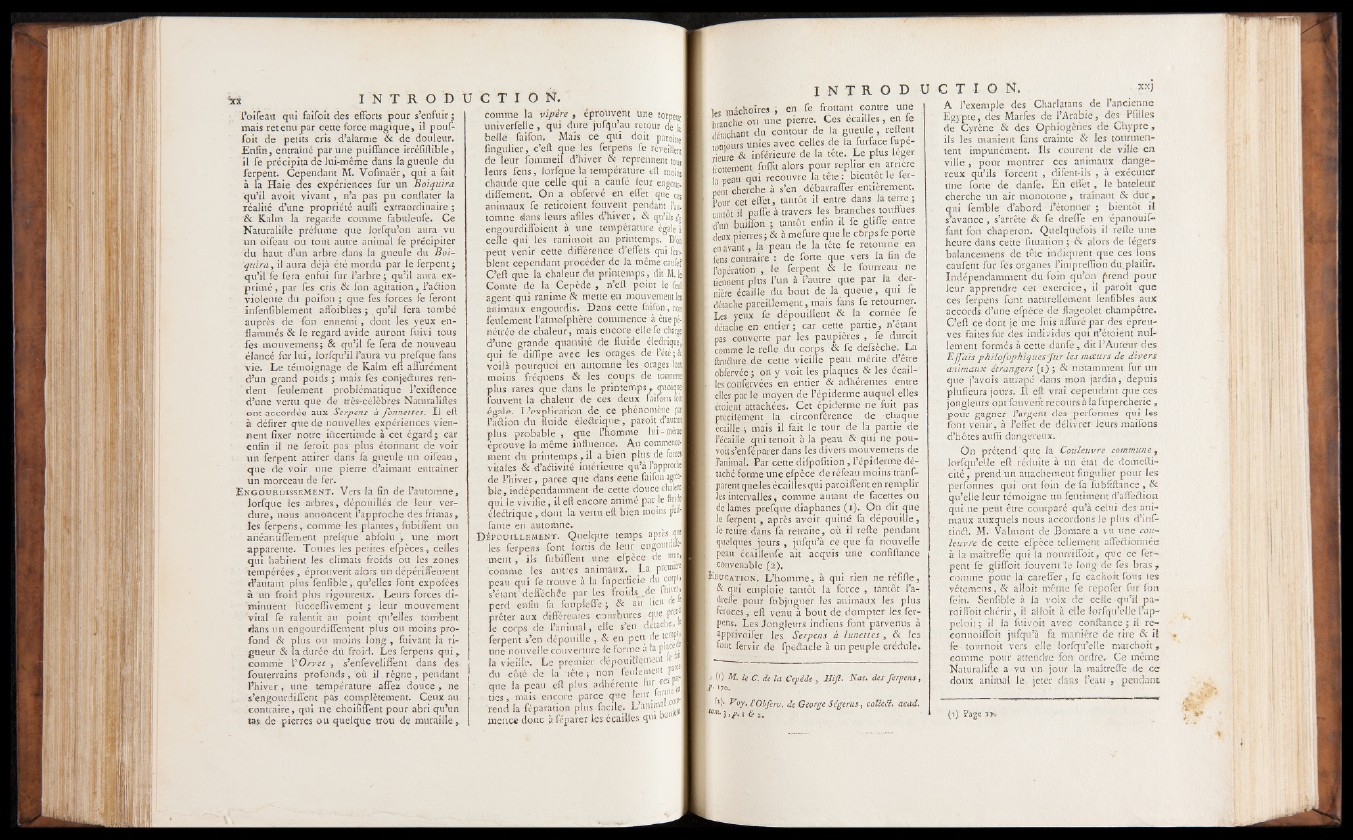
M I N T R O D
l’oifeau qui faifoit des efforts pour s’enfuir;
mais ret enu par cette force magique, il pouf-
foit de petits cris d’alarme & dé douleur.
Enfin, entraîné par une puiffance irréfifiible,
i l fe précipita de lui-même dans la gueule du
ferpent. Cependant M. Vofmaër, qui a fait
à fa Haie des expériences fur un Boiquira
qu’il avoit vivant , n’a pas pu confiater la
Téalité d’une propriété auiïi extraordinaire ;
& Kalm la regarde comme fabuleufe. Ce
Naturalifie prélume que lorfqu’on aura vu
un oifeau ou tout autre animal fe précipiter
du haut d’un arbre dans la gueule du Boiquira,
il aura déjà été mordu par le ferpent;
qu’il fe fera enfui fur l’arbre; qu’il aura exprimé,
par fes cris & fon agitation, l’aâion
violente du poifon ; que fes forces fe feront
infenfiblement affaiblies ; . qu’il fera tombé
auprès de -fon ennemi , dont les. yeux enflammés
8c le regard avide auront fuivi tous
fes mouvemens; 8c qu’il fe fera de nouveau
élancé fur lu i, lorfqu’il l’aura vu prefque fans
vie. Le témoignage de Kalm eft affurément
d’un grand poids ; mais fes conjeâures rendent
feulement problématique l ’exiflence
d’une vertu que de très-célèbres Naturaliftes
ont accordée aux Serpens à fonnettes. Il efl
à défîrer que de nouvelles expériences viennent
fixer notre incertitude à cet égard; car
enfin il ne feroit pas plus étonnant de voir
un ferpent attirer dans fa gueule un oifeau,
que de voir une pierre d’aimant entraîner
un morceau de fer.
Engourdissement. Vers la fin de l’automne,
lorfque les arbres, dépouillés de leur verdure,
nous annoncent l’approche des frimas,
les ferpens, comme les plantes, fubiffent un
anéantiffement prefque abfolu ; une mort
apparente. Toutes les petites efpèces, celles
qui habitent Jes climats froids ou les zones
tempérées, éprouvent alors un dépériffement
d’autant plus fenfible , qu’ellès font expofées
à un froid plus rigoureux. Leurs forces diminuent
Tucceffîvèment > leur mouvement
vital fè ralentit au point qu’elles tombent
dans un engourdiffement plus ou moins profond
8c plus ou moins lo p g , fuivànt la rigueur
8c la durée dit froid. Les ferpens qui ,
comme VOrvet , s’enfe'veliflent dans des
fouterrains profonds, où il règne, pendant
l’hiver, une température affez douce , ne
s’engourdiffent pas complètement. Ceux au
.‘contraire, qui ne' c-hoififfent pour abri qu’un
tas de pierres ou quelque trou de muraille
C T I O N,
comme la vipère , éprouvent Une torpeur
univerfelle, qui dure jufqu’au retour dë la
belle faifon. Mais ce qui doit paroîtreI
fingulier, c’eft que les ferpens fe réveillent
de leur fommeil d’hiver 8c reprennent tous
leurs fens, lorfque la température eft moins
chaude que celle qui a caufé leur engour.l
diffement. On a obfervé en effet , que ccs
animaux fe retiroient fouvent pendant l’au-|
tomné dans leurs afiles d’hiver, & qu’ils sV|
engourdiffoient à une température égale à
ceüe qui les ranimoit au printemps. D’oàl
peut venir cette différence d’effets qui feni-1
blent cependant procéder de là mêmecaufe?
C ’eft que la chaleur du printemps, dit M. le
Comte de la Cepède , n’eft point le leul
agent qui ranime 8c mette en mouvement les
animaux engourdis. Hans cette faifon, non
feulement ratmofphère commence à être pénétrée
de chaleur, mais encore elle fe charge
d’une grande quantité de fluide éledrique,
qui fe diffpe avec les orages de l’été ; &l
voilà pourquoi en automne les orages font
moins fréquens 8c les coups de tonnerre!
plus rares que dans le printemps ^ quoique
fouvent la chaleur de ces deux faifons foit
égale. L ’explication de ce phénomène par
l’adion du fluide éledrique-, paroît d’autant
plus probable * que l’homme lui-même
éprouve la même influence- Au commence*
ment du printemps , il a bien plus de forces
vitales 8c d’adivité intérieure qu’à l’approche
de l’hiver, parce que dans cette fai fon agréab
le , indépendamment de cette douce chaleur
qui le vivifie, il eft encore animé par lé .W
éledrique , dont la vertu eft bien moins puiH
faute en automne*
D épouillement. Quelque temps, après que
les ferpens -font îortis de leur engourdir
ment , ils fubiffent une efpèce de mm
'comme les autres animaux. La premicrej
peau qui fe trouve à la fuperficie du corps>1
s’étant' defféchée par les froids^de. i*1,ver’|
perd enfin fa foupteffc ; 8c au h,etl e J
prêter aux différentes courbures que pren
le corps de L’animal, elle s’en détache,
ferpent s’en dépouille ,. & en peu de tefflp^
une nouvelle couverture fe forme a fa p^ce.
la vieille. Le premier dépouillement le
du côté de la tête ; non ' feulement P
que la peau eft plus adhérente fur eeSP,J
• ties, mais-encore parce que Leur _
rend la féparàtion plus facile. L’anima
jïiencc doue à féparer les écailles qiU 130 j
les mâchoires ; en fe frottant contre une
branche ou une pierre. Ces écailles, en fe
détachant du contour de la gueule, relient
toûiours unies avec celles de la furface fupé-
rieure & inférieure de la tête. Le plus leger
frottement, fuffit alors pour replier en arrière
la peau qui recouvre la tête : bientôt le ferpent
cherche à s’en débarraffer entièrement.
Pour cet effet, tantôt il entre dans la terre;
tantôt il paffe à travers les branches touffues
d’un buiffon ; tantôt enfin il fe gliffe entre
! deux pierres; & à mefure que le corps fe porte
en avant, la peau de la tete fe retouine en
. fens contraire : de forte que vers la fin de
r l’opération , le ferpent 8c le fourreau ne
tiennent plus l’un à l’autre que par la der-
. uière écaille du bout de la queue, qui fe
•• détache pareillement, mais fans fe retourner.
Les yeux fe dépouillent 8c la cornée fe
détache en entier ; car cette partie, n’étant
pas couverte par les paupières , fe durcit
i‘ comme le refte du corps 8c fe defseche. La
ftrudure de cette vieille peau mérite d’être
[ obfervée ; oti y voit les plaques 8c les écailles
confervées en entier 8c adhérentes entre
elles par le moyen de l’épiderme auquel elles
| étoient attachées. Cet épiderme ne fuit pas
I précilément la circonférence de -chaque
I écaille -, mais il fait le tour de la partie de
[ l’éçaiile qui tenoit à la peau 8c qui ne pou-
: voit s’en féparer dans les divers mouvemens de
l’animal. Par cette difpofition, l’épiderme dé-
[ taché forme une efpèce deréfeau moins transparent
que les écailles qui paroiffenten remplir
I les intervalles, comme autant de facettes ou
[ de lames prefque diaphanes ( i) . On dit que
1 le ferpent , après avoir quitté fa dépouille,
, fe retire dans fa retraite, où il refte pendant
I quelques jours , jufqu’à ce que fa nouvelle
peau ccailleufe ait acquis une confiftance
| convenable (2).
pDUGATioN. L ’homme, à qui rien ne réfifte,
j & qui emploie tantôt la force , tantôt l’a-
| drelîe pour fnbjuguer les animaux les plus
| féroces, eft venu à bout de dompter les ferpens.
Les Jongleurs indiens font parvenus à .
1 apprivoifer les Serpens à lunettes , 8c les
1 font fervir de fpeclacle à un peuple crédule*
MO M. le C. de la Cepède , Hijl. Nar. des ferpens,
I ■ b). Voy. CObferv, de George Ségerus, colleci, auid.
A l’exemple des Charlatans de l’apcienne
Egypte, des Marfes de l’Arabie, des Pfilles
de Cyrène 8c des Ophiogènes de Chypre ,
ils les manient fans crainte 8c les tourmentent
impunément. Ils courent de ville en
ville , pour montrer ces animaux dangereux
qu’ils forcent , difent-ils , à exécuter
une forte de danfe. En effet , le bateleur
cherche un air monotone > traînant 8c dur ,
qui femble d’abord l’étonner ; bientôt iL
s’avance, s’arrête 8c fe dreffe en épanouif-
fant fon chaperon. Quelquefois il refte une
heure dans cette fituation ; 8c alors de légers
balancemens de tête indiquent que ces Ions
caufent fur fes organes l’impreffron du.plaifir.
Indépendamment du foin qu’on prend pour
leur apprendre cet exercice, il paroît que
ces ferpens font naturellement fenfibles aux
accords d’n ne efpèce de flageolet champêtre.
C ’eft ce dont je me fuis affuré par des épreuves
faites fur des individus qui n’étoient nullement
formés à cette danfe, dit l ’Auteur des
EJfais p kilofophiques fu r les moeurs de divers
animaux étrangers (1) ; 8c notamment fur un
que j’avois attrapé dans mon jardin, depuis
plufieurs jours. Il eft vrai cependant que ces
: jongleurs ont fou vern recours à la fupercherie ,
pour gagner l’argent dés perfonnes qui les
font venir, à l’effet de délivrer leurs maifons
d’hôtes aufli dangereux.
On prétend que la Couleuvre commune,
lorfqu’elle eft réduite à un état de domefti-
citè , prend un attachement fingulier pour les
perfonnes qui ont foin de fa fubfiftance , &
qu’elle leur témoigne un fentirrrent d’affeétion
qui ne peut être comparé qu’à celui des animaux
auxquels nous accordons le plus d’inf-
tinéh M. Valmont de Bomare a vu une cou-*
leuvre de cette efpèce tellement affedionnée
à la maître ffê qui la nourriffoit, que ce ferpent
fe gliffoit fouvent le long de fes b ras,
comme pour la careffer, fe cachoit fous (es
vête me ns, & aîloit même fe repofer fur fon
fein. Senfible à la voix de celle qu’il pa-
rorffoit chérir, i! alloit à elle lorfqu’ëlle l’ap-
pejoit; il la fuivort avec confiance ; il re-
connoiffoit jufqu’à fa manière de rire 8c il
fe tournoit vers elle- lorfqu’eile marchoit,
comme pour attendre fon ordre. Ce même
Naturalifie a vu un jour la maîtreffe de ce
doux animal le jeter dans l’eau , pendant
(t). Page i».-