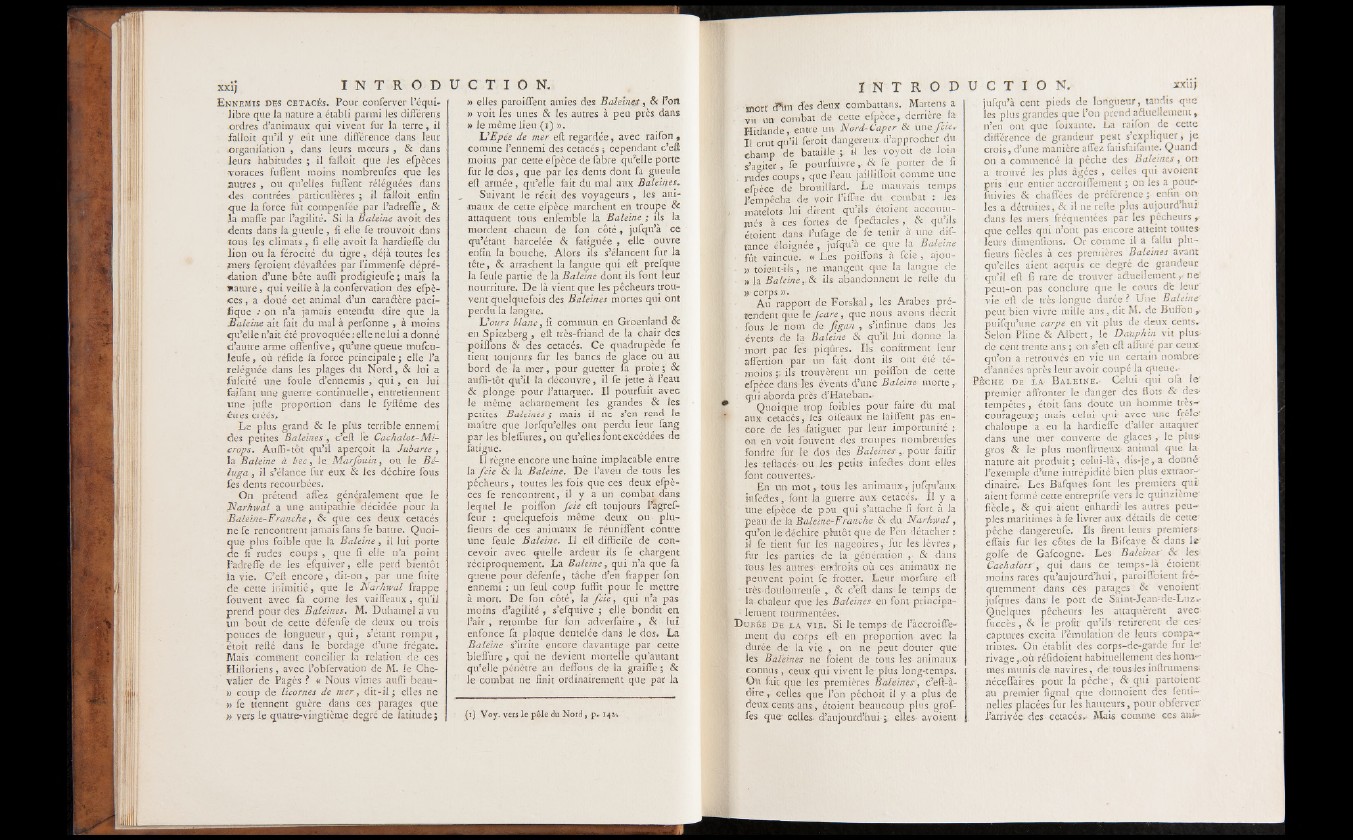
Ennemis des Cétacés. Pour conferver l’équi-
Jibre que la nature a établi parmi les différens
ordres d’animaux qui vivent fur la terre, il
falloit qu’il y eût une différence dans leur
,organifation , dans leurs moeurs , & dans
leurs habitudes ; il falloit que les efpèces
voraces fuflent moins nombreufes que les
.autres , ou qu’elles fuflent réléguées dans
des contrées particulières ; il falloit enfin
que la force fût compenfée par l’adrefîe, &
la ma fie par l’agilité. Si la Baleine avoit des
dents dans la gueule, fi elle fe trouvoit dans
tous les climats, fi elle avoit la hardiefle du
lion ou la férocité du tigre, déjà toutes les
tners feroient dévaflées par l’immenfe déprédation
d’une bête auffi prodigieufe ; mais la
»attire , qui veille à la confervation des efpèces
, a doué cet animal d’un caradère pacifique
.* on n’a jamais entendu dire que la
Baleine ait fait du mal à perfonne , à moins
qu’elle n’ait été provoquée; elle ne lui a donné
d’autre arme offenfive, qu’une queue mufcu-
leufe, où réfîde fa force principale; elle l’a
reléguée dans les plages du Nord, & lui.a
fufcité une foule d’ennemis , ' qui , en lui
faifant une guerre continuelle, entretiennent
une jufte proportion dans le fyfiême des
êtres créés,. .
L e plus grand & le plus terrible ennemi
des petites Baleines, c’eft fe Cachalot-NLi-
tcrops. Aufli-tôt qu’il aperçoit la Jubarte ,
la Baleine à bec, le Marfouin, ou le Béluga
il s’élance fur eux & les déchire fous
fes dents recourbées.
On prétend afîez généralement que le
Narhwal a une antipathie décidée pour la
Baleine-Franche, & que ces deux cétacés
ne fe rencontrent jamais fans fe battre. Quoique
plus foible que la Baleine, il lui porte
de fi rudes coups , que fi elle n’a point
l’adrefle de les efquiver, elle perd bientôt
la vie. C ’efl encore, dit-on, par une fuite
de cette inimitié , que le Narhwal frappe
fou vent avec fa corne les vai fléaux, qu’il
prend pour des Baleines. M. Duhamel a vu
un bout de cette défenfe de deux ou trois
pouces de longueur, q u i, s’étant rompu,
- étoit reflé dans le bordage d’une frégate.
Mais comment concilier la relation de ces
Hifloriens, avec l’obfervation de M. le Chevalier
de Pagès ? « Nous vîmes auffi beau-
» coup de licornes de mer, d it- il; elles ne
» fe tiennent guère dans ces parages que
ï> vers le quatre-vingtième degré de latitude ;
» elles parodient amies des Baleines, & Toit
» voit les unes & les autres à peu près dans
» le même lieu ( i) ».
UEpée de mer efl: regardée, avec raifon ,
comme l’ennemi des cétacés ; cependant c’eft
moins par cette efpèce de fabre qu’elle porte
fur le d o s , que par les dents dont fa gueule
efl armée, qu’elle fait du mai aux Baleines•.
Suivant le récit des voyageurs , les animaux
de cette efpèce marchent en troupe 8c
attaquent tous enfemble la Baleine ; ils la
mordent chacun de fon cô té , jufqu’à ce
qu’étant harcelée St fatiguée , elle ouvre
enfin la bouche. Alors ils s’élancent fur la
tête, 8c arrachent la langue qui efl: prefque
la feule partie de la Baleine dont ils font leur
nourriture. De là vient que les pêcheurs trouvent
quelquefois des, Baleines mortes qui Ont
perdu la langue.
JJ ours blanc y fi commun en Groenland 8c
en Spitzberg 9 efl très-friand de la chair des
poillons 8c des cétacés. Ce quadrupède fe
tient toujours fur les bancs de glace ou au
bord de la mer, pour guetter la proie ; 8c
auffi-tôt qu’il la découvre, il fe jette à l’eau
8c plonge pour l’attaquer. Il pourfuit avec
le même acharnement les grandes 8c les
petites Baleines $ mais il ne s’en rend le
maître que iorfqu’eiles ont perdu ieur fang
par les bleffùres, ou qu’elles font excédées de
fatigue.
Il règne encore une haine implacable entre
la fc ie 8c la Baleine. De l’aveu de tous les
pêcheurs , toutes les fois que ces deux efpèces
fe rencontrent, il y a un combat dans
lequel Je poiflbn fc ie efl: toujours l’agref-
feur : quelquefois même deux ou plu-
fieurs de ces animaux fe réunifient contre
une feule Baleine. Il efl difficile de concevoir
avec quelle ardeur ils fe chargent
réciproquement. La Baleine y qui n’a que fa
queue pour défenfe, tâche d’en frapper fon
ennemi : un feul coup fuffit pour le mettre
à mort. De fon côté, la f c i e , qui n’a pas
moins d’a gilité, s’efquive ; elle bondit en
l’air , retombe fur fon adverfaire , & lui
enfonce fa plaque dentelée dans le dos. La
Baleine s’irrite encore davantage par cette
blefîùre, qui ne devient mortelle qu’autant
qu’elle pénètre au deflbus de la graille ; 8c
le combat ne finit ordinairement que par la
(i) Voy. vers le pôle du Nord, p. 141*
Wîorr éftur des deux combattans. Martens a
vu un combat de cette efpèce, derrière la-
Hitlande,-entre uiv Nord-Caper 8c unefeie*
Il crut qu’il feroit dangereux- d’approcher du
champ de bataille-;, il les. voyoit de loin
s’agiter , fe p o u r fu iv r e 8c fe porter de fi
. rudes coups, que l’eau jailliflok comme une
efpèce de brouillard. L e mauvais temps
l’empêcha de voir l’iflue du combat : les
matelots lui dirent qu ils etoient accoutumés
à ces fortes de fpedacles ^ & qu’ils
étoient dans- l’ufage de fe tenir à' une distance
éloignée , jufqu’à ce que la Baleine
■ fût vaincue. « Les poiffons à fc ie , ajou-
- » toient-ils, ne mangent que la langue de
» la Baleine r 8c iis abandonnent le relie du
» corps ».
Au rapport de Forsfeal, les Arabes prétendent
que 1 Q'Jcare, que nous avons décrit
• fous le nom de figan , s’infînue dans les
évent* de la- Baleine 8c qu’il lui donne la
mort par fes piqûres. Ils confirment leur
afîertion par un fait dont iis ont été témoins
;; ils trouvèrent un poiflbn de cette
efpèce dans lès évents d’une Baleine morte,-
qui aborda près d’Hateban.»
Quoique trop foibles pour faire dit mai
aux cétacés, les oifeaux ne laifieht pas encore
de les »fatiguer par leur importunité :•
©n en voit fouvent des troupes nombreufes
fondre' fur le dos des B a le in e s pour faifîr
les teftacés- ou les petits infeétes dont elles
font couvertes,.
En un mot, tous les animaux, jufqu’âux
infeétes, font la guerre aux cétacés.- Il y a
une efpèce de pou qui s’attache fi fort à la
peair de la B'aleine-F r anche 8c du Narhwal,
qu’on le"déchire plutôt que de l’en détacher *•
il fe tient fur les nageoires,- fur les lèvres r
for les parties- de la génération ,- 8c dans
tous les autres' endroits où ces animaux ne
peuvent point fe frotter. Leur morfure efl-
très-douloureufe , 8c c’èfl: dans le temps de
la chaleur ç\uq \zs Baleines-en font principalement
tourmentées.
D urée de la vie. Si le temps- de Fàccroifle-
ment du corps efl- en proportion avec la
durée de la vie on ne peut douter que
les Baleines ne foient de tous les animaux
connus , ceux qui vivent le-plus long-temps.
On fait que les premières Baleines', c’éft-à-
dire r celles que l’on pêchoit il y a plus de
deux cents ans-, étoient beaucoup plus grof-
fes que- celles» d’aujourd’hui-^ elles» ayoient
jufqu’à cent pieds de longueur, tandis que
les plus grandes que l’on prend actuellement
n’en ont que foixante. La raifon de cette
différence de grandeur peut s’expliquer, je
crois, d’une manière aflez fadsfaifante. Quand
on a commencé la pêche des Baleines, on>
a trouvé les plus âgées , celles qui avoient
pris eur entier accroiflement ; on les a pour-
fuivies 8c chaffées de préférence ; enfin ouïes
a détruites, 8c il ne relie plus aujourd’hui'
dans les mers fréquentées par les pêcheurs 9
que celles qui n’ont pas encore atteint toutes-
leurs dimenfions. Or comme il a fallu plu-
fieurs fiècles à ces premières Baleines avant
qu’elles aient acquis ce degré de grandeur
qu’il efl fi rare de trouver aétuellement y ne’
peut-on pas conclure que le cours de leur
vie efl: de très-longue durée ? Une Baleine'
peut bien vivre mille ans, dit M. de Buffon^
puifqu’une carpe en vit plus de deux cents.-
Selon Pline & A lb e r t, le Dauphin vit plus»
de cent trente ans ; on s’en efl: aflùré par ceux
qu’on a retrouvés en vie un certain nombre:
d’années après leur avoir coupé la queue.-
Pêche de la Baleine.» Celui qui ofa le ’
premier affronter le danger des flots & des»
tempêtes, étoit fans doute un homme très-'
courageux; mais celui qui- avec une frêle-
chaloupe a eu la hardiefle d’aller attaquer
dans une mer couverte de gla ces , le plus-1
gros 8c le plus monftrueux- animal que la-
nature ait produit ; celui-là, dis-je,-a donné'
l’exemple d’une intrépidité bien plus extraordinaire.
Les Bafqües font les premiers qui'
aient formé cette entreprife vers le quinzième'
fiècle, 8c qui- aient enhardi-’ les autres peu--
pies maritimes à fe livrer aux-détails de cetter
pêche dangereufe. fis firent leurs premiers-
effais fur les côtes de la Bifcaye 8c dans le'
golfe de Gafcogne. Les Baleines 8c les;
Cachalots’y qui dans Ce temps-là étoient
moins rares qu’aujourd’hui', paroifîbient fréquemment’
dans cès parages 8c venoiènt-
jufqües dans' le port de Sa in t-Jean - dë-L u z
Quelques pêcheurs- les attaquèrent avec-
foccès 8c le profit qu’ils' retirèrent de' ces-
captures excita l’émulation* de leurs compa-''
triotes. Oh établit dès corps-de-garde for le-’
rivage ,<,où*réfidoient habituellement des hom-*
mes munis de navires, de tous les inftrumens^
néceflaires pour la pêche-, &■ qui partoient
an premier lignai que dbunoient dès fentî*»
nelles placées fur les hauteurs, pour obfervec
l ’arrivée- des- cétacés^ Mais comme ces an k