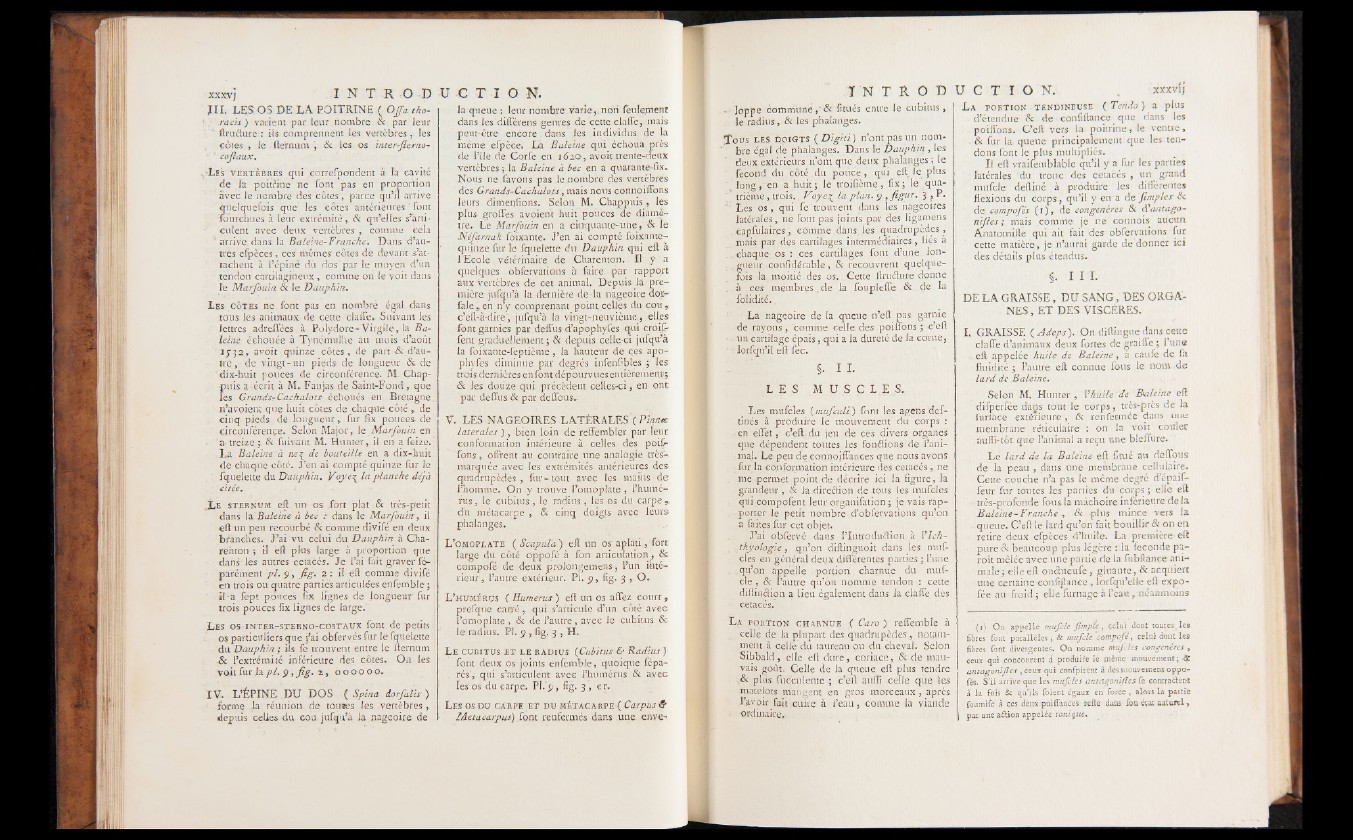
Ï I L LES OS DE LA. POITRINE ( Offa tho-
'■ racis ) varient par leur nombre & par leur
ftruéture .* ils comprennent les vertèbres, les
, cotes , lé ftemum , 6c les os ïnter-fierno-
^ ' cofiaux.
. L es vertebres qui- correspondent à la cavité
de la poitrine ne font pas en proportion
avec le nombre des côtes, parce qu’il arrive
quelquefois que les côtes antérieures ‘ font
fburchues à leur extrémité, & qu’elles s’articulent
avec deux vertèbres- comme cela
arrive, dans la Baleine-Franche. Dans d’autres
efpëces, ces mêmes' côtes de devant s’attachent
à l’epiné du dos par le moyen d’un
tendon cartilagineux , comme on le voit dans
le Marjbuin8c leDauphin.
Les côtes ne. font pas en nombre égal dans
tous les animaux de cette dafle* Suivant les
lettres adreiïees à Polydore- V irgile, la Baleine
échouée à Tÿnémulhe au mois d’août
IJ32;,. avoit;quinze côtes, de part ie d’autre
, de vingt-un pieds de longueur & de
dix-huit pouces de circonférence. M. Chap-
-puis a écrit à M.. Faujas dé Saint-Fond, que
les GrandsrCachalots échoués en Bretagne,
n’avaient que huit côtes de chaque cô té ,. de
cinq, pieds dé lo n g u e u r fu r fix pouces de
circonférence. Selon Major y le Marfouin en
- a- treize; 8c fuivant M. Hnnter, il en a feize.
La Baleine a neg_ de bouteille en a dix-huit
de chaque côté.. J’en ai'compté quinze fur le
fquelette du Dauphin. Voye^ la planche déjà
citée»
L e sternum eft un- os Jôrt plat & très-petit
dans la Baleine à bec ? dans le Marfouin:, il
eft un peu recourbé & comme divifé en deux
branches. J’ai vu celui du Dauphin à Cha-
réhton -, il eft plus large à proportion que
dans'lès autres cétacés. Je î’ài fait graver fé-
pàrément pi. p , fig . 2 : il éft comme divifé
en trois ou quatre parties articulées ënfemble;
il a fept pouces fix lignes de Jongûeur fur
trois pouces fix lignes de large.
L es os-inter- sterno-costaux font de petits'
os particuliers que j’ai obfer vés fur le fquelptte
du Dauphin; ils fe trouvent entre le fternum
•& l’extrémité inférieure des côtes.. On les
voit fur la pl. p , fig . 2 , o o o o o o »
I V L ’ÉPINE D U D O S ( Spitia. ior fa lis)
- forme la réunion de toutes les vertèbres ,
depuis celles du cou jufqu’à la nageoire de
la queue : leur iiombïe' varie ,,non feulement
dans les’differens genres de cette d a lle , mais
peut-être encore dans les individus de la
même efpèce. Là Baleine qui échoua près
de l’ile de Corfe en 162 a, avoit trente-deux
vertèbres y la Baleine à bec en a quarante-fix.
Nous ne favons pas le nombre des vertèbres
dès Grands-Cachalots, mais nous connoiffbns
leurs dimeqfions. Selon M. Chappuis , les
plus- greffes a voient huit pouces de diamètre.
Le Marfouin en a cinquante-u ne, & le
Néfârnak foixante. J’én ai compté foixante-
quinze fur le fquelette dit Dauphin qui eft à
l ’Ecole . vétérinaire de Charenton. I l . ÿ a
quelques obfervàtions à faire par rapport
aux vertèbres de cet animal. Depuis la première
jufqu’à la dernière dé 4a nageoire dor-
fale5. en 11’y comprenant point celles du cou
c’eft-à-dire, jufqu’à la vingt-neuvième,,, elles
font garnies par defîus d’apophyfes qui crôifr
fent graduellement; 8c depuis celle-ci jufqu’à
la foixante-feptième, la hauteur de ces apo-
phyfes diminue par degrés infenfibles , les;
trois dernières- en font dépourvues entièrement?;;
& les douze qui précèdent celles-ci, en ont
par defîus 8c par defîcus..
V. LES NAGEOIRES LATÉRALES ( Pîmm.
latérales ) , bien loin de réffembler par leur
conformation intérieure à celles des poifi*
fons * offrent au contraire une analogie très-,
marquée avec les extrémités antérieures des
quadrupèdes , fur - tout aveç les mains de*
. l’homme. On y trouve l’omoplate , l’humérus,,
le cubitus, le radius , les os du carpe,,
du métacarpe ,, 8c cinq doigts avec leurs
phalanges.
L’omoplate ( Scapulaj eft un os aplati, fort
large du côté oppofé à fon articulation? 8c
compofé- de deux proiongemens-, l’un intérieur
, l’autre extérieur. Pi. p ,. fig. 3 , 0 >
L ’humerus ( Humérus ) eft un os afîe^ court »
prefque carré, qui s’articule d’un côté avec-
l’omoplate, & de l’autre, avec le cubitus 8c
le radius. Pl. p , fig. 3 , H.
L e cubitus et le radius {Cubitus & Radius }
font deux os joints enfemble, quoique fépa-
rés'ÿ qui s’articulent avec l’humérus 8c avec
les os du carpe. Pl. p , fig. 3 , cr.
L es os du carpe et du métacarpe ( Car pus #
lAetacarpus) font renfermés dans une enve-
- • loppe éommüne y 8c fitués entre le cubitus,
. le radius, & les phalanges.
Jfous les doigts ( Digiti ) n’ont pas un nombre
égal de phalanges. Dans le Dauphin , les
deux extérieurs n’oni que deux phalanges ; le
■ fécond du côté du pouce, qui eft, le plus
long, en a,huit; le troifième , fix; le qua-
^ trième, trois., Voyeg_ la plan, p 9figur. 3 > P*
0 Lés os, qui fe trouvent dans les nageoires
latérales, ne font pas joints par des ligamens
. caplulaires , comme .dans, les quadrupèdes ,
mais par des cartilages intermédiaires., lies a
. chaque, os : ces cartilages font d’une lon-
. , gueur confidérable, 8c recouvrent quelquefois
la moitié des os. Cette, firudure donne
... à . ces membres de la fouplefîe 8c. de la
folidité.,
La nageoire de la queue n’eft pas garnie
de rayons, 'comme celle des poifîbns ; c’eft
■ un cartilage épais, qui a la dureté de la corne,
■ ~ lorfqu’il eft fec.
§. I I.
L E S M U S Ç L E S.
Les mufcles ( mufculi) font les agens def-
tinés à produire le mouvement du corps :
: en effet,- c’eft, du jeu de ces divers organes
que dépendent toutes les fondions de l’animal.
Le pe,u de connoifîances que nous avons
. . fur la conformation intérieure des cétacés , ne
. me permet point de décrire ici la figure, la
grandeur , 8c. la.diredion de-tous les mufcles
qui compofent leur organifation ; je vais rapporter
le petit nombre d’obfervations qu’on
. a faites fur cet objet.
J’ai obfervé dans l’Introdudion à Ylch-
yhyologie, qu’on diftingiioit dans les mufcles
en général deux différentes parties ; l’une
, qu’on appelle portion charnue du nui fiel
e , 8c l ’autre qu’ôu nomme tendon cette,
diftindion a lieu également dans la clafîe des
cétacés;
L a portion charnue ( Caro ) reffemble à
celle de la plupart des quadrupèdes, notamment
à celle du taureau ou du cheval. Selon
Sibbald, elle eft dure, coriace, 8c de mauvais
goût. Celle de la queue eft plus tendre
plus fucculente ; c’eft atiffi celle que les
matelots mangent en gros morceaux, après
î l’avoir fait cuire à l’eau, comme la viande
ordinaire.
L a portion tendineuse ( Tendo ) a plus
d’étendue 8c de confiftance que dans les
poifîbns. C ’eft vers la poitrine, le ventre,
■ 8c fur la queue principalement que les tendons
font le plus multipliés. .
Il eft vrailemblable qu’il y a fur les parties
latérales du tronc des cétacés , un grand
mufcle deftiné à produire les différentes
flexions du corps, qu’il y en a de fimples 8c
de. compofés ( 1 ) , de congénères 8c fantago-
nifies ; mais .comme je ne connois aucun
Anatomifte qui ait fait des obfervàtions fur
cette matière, je n’aurai garde de donner ici
des détails plus étendus.
§. I I L
DE L A G R A IS SE , DU S A N G , DES O R G A NES,
E T DES VISCÈRES.
I. GRAISSE {Adeps). On diftingue dans cette
clafîe d’animaux deux fortes de graifîe ; l’une
-, eft appelée huile.de Baleine, à caufe de fa
fluidité ; l’autre eft connue fous le nom de
lard de Baleine..
Selon M. Humer , Yhuile de Baleine eft
difperfée dans toutrle corps, très-près de la
furface extérieure y 8c renfermée dans une
membrane réticulaire : on la voit couler
. aufîi-tôt que l’animal a reçu une blefîure.
Le lard de là Baleine eft fi tué au defîous
de la peau , dans une membrane cellulaire.
Cette couche n’a pas le même degré d’épaif-
feur fur toutes les parties du corps; elle eft
très-profonde fou s. la mâchoire-inférieure delà
Baleine-Franche^ & plus mince vers la
queue.' C ’eft le lard qu’011 fait bouillir & on en
• retire deux efpèces d’huile. La première-eft
pure &.beaucoup plus légère : la feçonde pa-
roît mêlée avec une partie de la fubftançe animale;
elle eft onctueufe, gluante, 8c acquiert
une certaine confiftance,, îorfqii’elle eft expo-
fée au froid ; elle fumage à fieau, néanmoins
.(ï) On appelle mufcle ß-mple, çelui dont toutes, les
fibres font parallèles} & mufcle compofé, celui dont les
fibres font divergentes. On nomme mufcles. congénères ,
ceux qui concourent d produire le même mouvement; 8C
antagonifl.es , ceux qui eonfpirent a des mouvemens oppo-
fés. S’il arrive que les mufcles antagonifles fe contractent
a la fois & qu’ils (oient égaux en force, alors la partie
foumife à ces deux pui{Tances selle dans fou état naturel >
par une aélion appelée tonique.