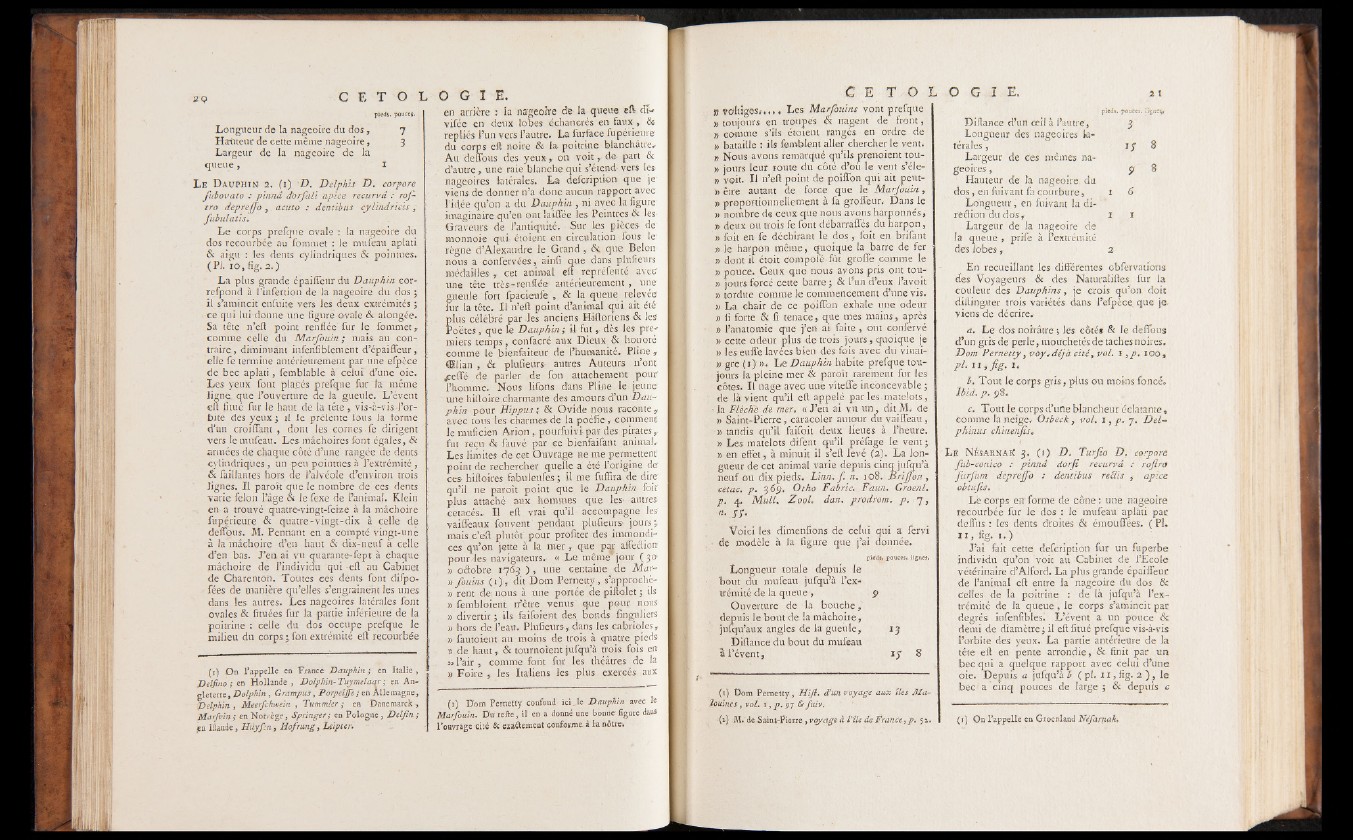
pieds, pouces«
Longueur de la nageoire du dos, 7
Hauteur de cette même nageoire, 3
Largeur de la nageoire de la
queue, 1
L e Dauphin 2 . ( 1 ) D . Delphis D . corpore
fubovato ; pinnâ d'orfalï îipice recurvâ rof-
tro deprejjo, acuto : dentibus cylindricis '
fubulatis.
Le corps prefque ovale : la nageoire du ;
dos recourbée au fommet : le mufeau aplati
& aigu : les dents cylindriques & pointues. ’
( P I . 1 0 , f i g . 2 . )
La pins grande épaifTeur du Dauphin cor- ;
refpond à Tinfertion de la nageoire du dos ;
il s’amincit enfuite vers les deux extrémités; .
ce qui lui donne une figure ovale & alongée. |
Sa tête n’eft point renflée fur le fommet r 1
comme celle du Marfouin ; mais au contraire
, diminuant infenfiblement d’épaiffeur,
elle fe termine antérieurement par une efpcce !
de bec aplati, femblable à celui d’une oie.
Les yeux font placés prefque fur la même
ligne, que l’ouverture de la gueule. L ’évent ;
eft fitué fur le haut de la tête > vis-à-vis-l’or- !
bite des yeux ; il fe préfente fous ia forme ‘
d’un croiffant , dont les cornes fe dirigent !
vers le mufeau. Les mâchoires font égaies, 8c
armées de chaque côté d’une rangée de dents !
cylindriques, un peu pointues à l’extrémité,
8c faillantes hors de l’alvéole d’environ trois
lignes. I l parok que le nombre de ces dents j
varie félon l’âge & le fexe de Panimaî. Klein ;
en a trouvé quatre-vingt-feize à la mâchoire
fupérieure 8c quatre-vingt-dix à celle de
défions. M. Pennant en a compté vingt-une
à la mâchoire d’en haut 8c dix-neuf à celle
d’en bas. J’en ai Vu quarante-fept à chaque
mâchoire de l’individu qui-eft au Cabinet
de Charentôii. Toutes ces dénis font difpo-
' fées de manière qu’elles s’engrainent les unes
dans les autres. Les nageoires latérales font
ovales 8c fîtuées fur la partie inférieure de la
poitrine : celle du dos occupe prefque le |:
milieu du corps ; fon extrémité eft recourbée L
(1) On l’appelle en France Dauphin ; en Italie, *
Delfino ; en Hollande , Dolphin- Tuymelaar ; en Angleterre
, Dolphin, Grampus, Porpeijje ; en Allemagne,
Delphin , Meerfchwein , TummUr ; en Danemarck ,
Marfvin; en Norvège, Springer; en Pologne , Delfin;
en IÛande, Hùyfzn, Hofrung, Leipter.
en arrière :■ la nageoire (te la queue «A eft-
vifée en deux lobes échancrés en faux , &
repliés l’un vers l’autre. La furface fupérieure
du corps éft noire & ia poitrine blanchâtre.
A u deffous des y eu x , on v o it , de- part &
d’autre, une raie blanche qui s’étend'vers les
nageoires latérales. La defcription que je
viens de donner n’a donc aucun rapport avec
l ’idée qu’on a du Dauphin , ni avec la figure
imaginaire qu’en ont laiffée les Peintres & les'
Graveurs de l’antiquité. Sur les pièces de
monnoie qui étoient eu circulation fous Je1
règne d’Alexandre le Grand , de que Belon
nous a confervées, ainfi que dans plufieurs
médailles-, cet animal eft repréfenté avec*
une tête très-renflée- antérieurement une-
gueule fort fpacieufe , & la queue relevée
fur la tête. Il n’eft point: d’animal, qui ait été-
plus célébré par -les anciens Hiftoriens & les
Poètes, que le Dauphin ; il fut , dès. les premiers
temps , confacré aux Dieux honore
comme le bienfaiteur de ^humanité. Pline ,
(Elian , & plufieurs- autres Auteurs n’ont
(Pefle de parler de fon attachement pour'
l’homme. Nous liions dans Pline-'.-le- jeune
une hiftoke charmante des amours d’un Dauphin
pour Hippus; & Ovide nous raconte,
avec tous les charmes de la poéfie , .comment
le muficien A-rion p.ourfuivi-par des pirates,
fut reçu & fauve par ee bienfaifant animal.
Les limites de cet Ouvrage ne me permettent'
point de rechercher quelle a été l’origine de’
ces hifto-ires fabuleufes-; il me fuffira de dire’
qu’il ne paroît point que le Dauphin foit
plus attaché aux hommes que les- autres
cétacés. I l eft . vrai qu’il accompagne les
vaiffeaux forment' pendant plufieurs- jours J
mais c’eft plutôt' pour profiter des immondices
qu’on jette à la mer , que par affeflion-
pour/ies- navigateurs. « Le même jour ( 3° ’
, >> oâobre 1765 ) , une centaine de Mar-
» fouins ( 1 ) , dit Dont Pernetty, s’approchè-
» rent de: nous à une portée.de piftolet ; ils
» fembloient n’être venus' que pour nous
» divertir ; ils faifoien-t des bonds finguliers
» hors de l’eau. Plufieurs-, dans les cabrioles,
» fautoient au moins de trois à quatre pieds
-s de haut, & tournoient jitfqu’à trois fois en
» l’air , comme font fur les théâtres de la
» Foire , les Italiens les plus exercés aux
(1) Dont Pernetty confond' ici.le Dauphin avec le
Marfouin. Du refte, il en a donné une bonne figure dan*
l ’eavrage cité & esaâeaient conforme, à la nêtre.
» voltiges».. 1. Les Marfouins vont prefque
» toujours en troupes & nagent de front,
» comme s’ils étoient rangés en ordre de
» bataille : ils fembleqt aller chercher le vent.
» Nous avons remarqué qu’ils prenoient tou-
» jours leur route du côté d’ôù le vent s’éle-
» voit. I l n’eft point de poiffon qui ait peut-
)> être autant de forGe que le Marfouin,
» proportionnellement à fa gfoffeur, Dans le
» nombre de ceux que nous avons harponnés,
K deux ou trois fe font débarraffés du harpon,
» foit en fe déchirant le dos , foi-t en brifant
t> le harpon même, quoique la barre de fer -
i> dont il étoit dompofé fût greffe comme le
» pouce. Ceux que nous avons pris ont tou-
» jours forcé cette barre ; & lten d’eux l’avoit
» tordue comme le commencement d’une' vis.
» La- chair de ce pbiffon exhale une odeur
» fi forte & fi tenace, que mes mains, après
» l’anatomie que j’efi ai faite , ont conlervé
» cette odeur plus de trois Jours, quoique je
» les euffe lavées bien des fois avec du yinai-
» gre ( i ) ». Le Dauphin habite prefque toujours
la pleine mer & paroît rarement fur les
côtes. Il nage avec une vîteffe inconcevable ;
de là vient qu’il eft appelé par les . matelots,
- la Fléchie de mer. « J’en ai vn Un, dit M, de
» Saint-Pierre, caracoler autour du vaiffeau,
» tandis qu’il faifoit deux lieues à l’heure.
» Les matelots difent qu’il préfage le vent j
» en effet, à minuit il s’eft levé (2). La longueur
de cet animal varie depuis cinq jufqu’à
neuf ou dix pieds. Linn. f . n. 108. Brijfon ,
cétac. p . 36p. Otko Fabric. Faun. Groenl.
p . 4 , M u ll, Z o o l. dan. prodrom. p . j 7 ,
n-.SSVoici
les dimenfions de celui qui a leryi
de modèle à ia figure que j’ai donnée.
pieds, pouces, lignes.
Longueur totale depuis le
bout du mufeau jufqu’à l’extrémité
de la queue , p
Ouverture de la bouche,
depuis le bout de la mâchoiie,
jusqu’aux angles de la gueule, 13
Diftance du bout du mufeau
à l’évent, l y 8
( 1) Dom Pernetty, Hijl. i'un voyage aux lies Ma-
fouines , vol. 1, p. 97 & fuiv.
■ (1) M. de Saint-Pierre, voyage à Vile de France, p. 51.
pieds, pouces.
Diftance d’un oeil à l’autre , 3
Longùeur des nageoires latérales
, 1 f
Largeur de Ces mêmes nageoires
, p
Hauteur de fa nageoire, du
dos j en fuivant fa courbure, 1 6
Longuèür, en fuivant la di-
redioii dit dos y 1 1
Largeur de la nageoire de
la q.ueué , prife à l’extrémité
des lobes y 2
lignes
8
En recueillant les differentes obfervatioTis
des Voyageurs 8c des Naturaliftès fur la
couléur des Dauphins, je crois qu’on doit
diftinguer trois variétés dans l’efpèce que je-
viens de décrire*
à. L e dos noirâtre' ; les coté* & le dcffbus
d’un gris de perle, mouchetés de taches noires*
Dom Pernetty, vôy< déjà cité, vol. 3 , p . 100,
pi. U , f ig . 1.
b. Tout le corps gris, plus ou moins foncé*
Ibid. p. çSé
c. Tout le corps d’une blancheur éclatante 9
comme la neige* Osbeck, vol. 1 , p. 7. D e l-
phinus chiiienjis*
L e NÉsARNÀ# 3. (1) D . Turfeo D. corpore
fub-conico : pinnâ dorji recurvâ : roJîrO
furfiim dèprejjo ; dentibus redis , apîce
obtujis. >
Le corps eir forme de cône : une nageoire
recourbée fur le dos : le mufeau aplati pac
deffiis : les dents droites 8c émoufîees. (PI*
n . f i g . i . ) -
J’ai fait cette defeription fur un fuperbe
individu qu’on voit au Cabinet de l’Ecole
vétérinaire d’Alford. La plus grande épaiffeur
de l’animal eft entre la nageoire du dos 8c
Celles de la poitrine : de là jufqu’à l’extrémité
de la queue, le corps s’amincit pac
degrés infenfiblesi L ’évent a un pouce 8c
demi de diamètre; il eft fitué prefque vis-à-vis
l’orbite des yeux. La partie antérieure de la
tête eft en pente arrondie, 8c. finit par un
bec qui a quelque rapport avec celui d’une
oie. Depuis a jufqu’à b ( pl. 1 1 , fig. 2 ) , le
bec a cinq pouces de large ; 8c depuis c
(1) On l’appelle en Groenland Néfarnak•