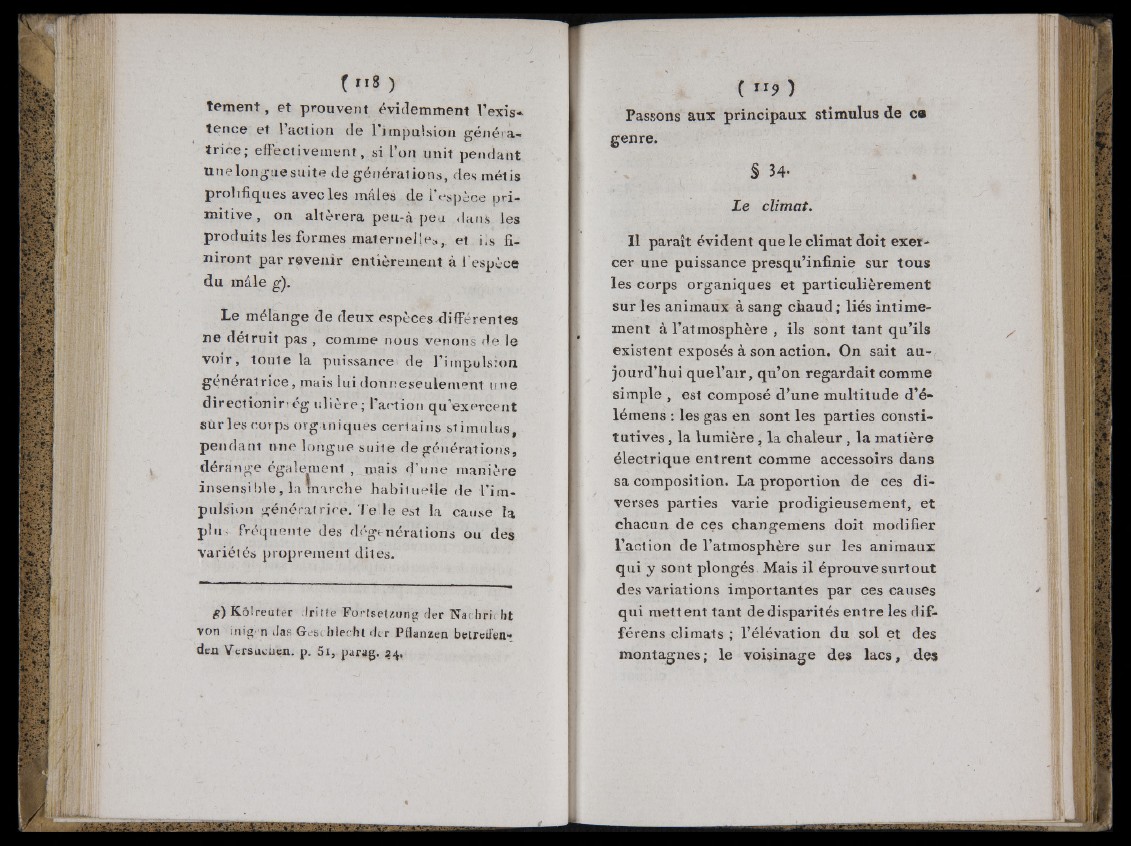
tement, et prouvent évidemment l ’exis»
tence et 1 action de 1 impulsion généia-
trire; effectivement, si l’on unit pendant
Unelonguesuite de générations, des métis
prolifiques avec les mâles de l ’espèce primitive
, on altérera peu-à peu dans les
produits les formes maternellet,et iis finiront
par revenir entièrement à l'espèce
du mâle g).
Le mélange de deux espèces différent es
ne détruit pas , comme nous venons de le
voir, toute la puissance de l ’impulsion
généralrice, mais lui donneseulenient une
direction inég ulière; l’action qu’exercent
sur les corps organiques certains stimulus,
pendant une longue suile de générations,
dérange également , mais d’une manière
insensible, la marché habituelle de l ’impulsion
génératrice. Je le est la cause la
plus fréquente des dégenérations ou des
variétés proprement dites.
g) Kölreuter dritte Fortsetzung der Nachricht
von inig al das Geschlecht der Pflanzen betretenden
Versucüen. p. 5i , parag. 24.
Passons aux principaux stimulus de ce
genre.
§ 34- . |
Le climat.
Il paraît évident que le climat doit exercer
une puissance presqu’infinie sur tous
les corps organiques et particulièrement
sur les animaux à sang chaud ; liés intimement
à l’atmosphère , ils sont tant qu’ils /
existent exposés à son action. On sait aujourd’hui
que l’air, qu’on regardait comme
simple , est composé d’une multitude d’é«
lémens : les gas en sont les parties constitutives
, la lumière, la chaleur , la matière
électrique entrent comme accessoirs dans
sa composition. La proportion de ces diverses
parties varie prodigieusement, et
chacun de ces çhangemens doit modifier
l ’action de l ’atmosphère sur les animaux
qui y sont plongés. Mais il éprouve surtout
des variations importantes par ces causes *
qui mettent tant de disparités entre les dif-
férens climats ; l ’élévation du sol et des
montagnes; le voisinage des lacs, des