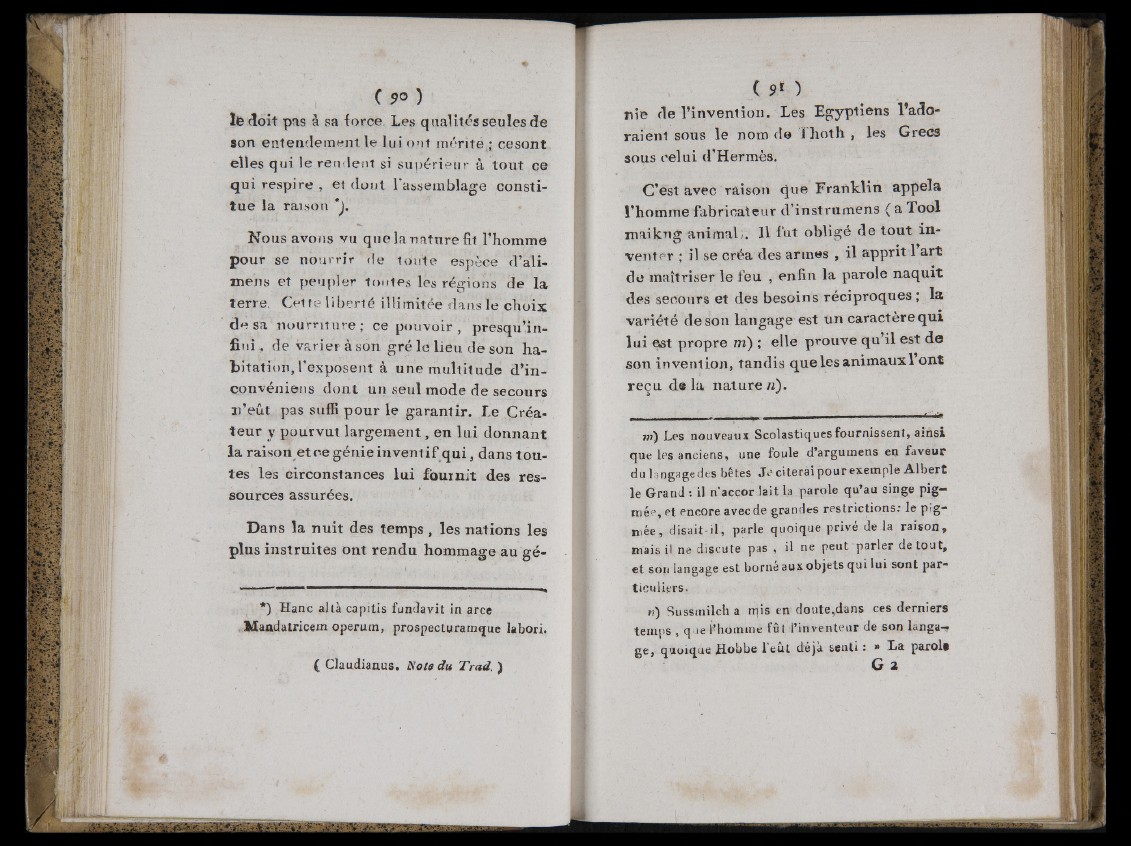
Ifedoit pas à sa force Les qualités seules de
son entendement le lui ont mérite ; cesont
elles qui le rendent si supérieur à tout ce
qui respire , et dont l ’assemblage constitu
e la raison *J,
Nous avons vu que la nature fit l’homme
pour se nourrir de tcmte espèce d’ali-
mens et peupler tonies les régions de la
terre. Celte liberté illimitée dans le ch o ix
de sa nourriture ; ce pou voir, presqu’in-
fini , de varier à son gré le lieu de son habitation,
l'exposent à une multitude d’in-
convéniens dont un seul mode de secours
n ’eût pas suffi pour le garantir. Le Créateu
r y pourvut la rg em en t, en lu i donnant
la ra iso n e t ce génie in v en tif q u i, dans tou tes
les circonstances lu i fournit des ressources
assurées.
Dans la n u it des temps , les nations les
plus instruites ont rendu hommage au gé-
*) Hanc alla capitis fundavit in aree
Mandatricem operum, prospecturarnque labori.
( Claudianus. Rote du Trad. )
c $n
nie de l’invention. Les Egyptiens l ’adoraient
sous le nom de Thoth , les Grecs
sous celui d’Hermès.
C ’est avec raison que Franklin appela
l ’homme fabricateur d’instrumens ( a Tool
maikng animal;. 11 fut obligé de tout in venter
; il se créa des armes , il apprit 1 art
de maîtriser le feu , enfin la parole naquit
des secours et des besoins réciproques ; la
variété de son langage est un caractère q u i
lu i est propre ni) ; elle prouve qu’il est do
son invention, tandis que les animaux 1 ont
re çu de la nature n).
m) Les nouveaux Scolastiques fournissent, ainsi
que les anciens, une foule d’argumens eu faveur
du langage des bêtes Je citerai pour exemple A lb e r t
le Grand : il n’accordait la parole qu’au singe p ig -
mée, et encore avec de grandes restrictions: le pig-
niée, disait- il, parle quoique privé de la raison,
mais il ne discute pas , il ne peut parler de tout ,
et son langage est borne aux objets qui lui sont particuliers.
k) Sussmilch a mis en doute,dans ces derniers
temps , que 1-homine fût l’ inventeur de son langa-r
g e , quoique f lobbe l e u t déjà senti î * L a parois
G 2